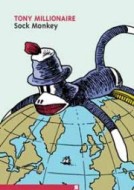- Millionaire Tony
Sock Monkey, Rackham. ISBN : 2858153841
Des hachures noires poussent comme du lierre à
la surface du papier; elles sont nées de la torpeur alcoolique d'une
après-midi perdue dans une grande maison victorienne ; quelques objets
de décoration (un lustre lourd, une maquette de trois-mâts),
des jouets trainant, des animaux vivants dans la promiscuité de la
chaleur domestique et l'hallucination, lentement, peut entraîner un
monde de colifichets et de parasites dans les plus extravagants récits
fantastiques...
Le temps du récit est pris dans une étrange gelée, le
dessin condamné à un éternel âge de la gravure
illustrative, ce XIXème siècle dont il emporte sournoisement
les clichés dans des contes immoraux et saugrenus.
Tony Millionaire ravit les lecteurs de Lewis Carroll qui désespéraient
secrètement de voir leur auteur abandonner enfin son public enfantin
et il enchante tous ceux qui fuient comme la peste le monde des évidences
: bienvenue dans celui de l'inadéquation, de la dérogation aux
règles, de l'inattendu.
L.L. de Mars
Si Sock Monkey ranime, par le biais d’un trait évoquant l’âge d’or de la gravure, les fastes d’une Amérique bourgeoise du XIXème siècle vue à hauteur d’enfant, on ne saurait y reconnaître pour autant le simple produit d’une nostalgie béate. Le tableau d’époque se révèle en effet sourdement contaminé par les décennies d’histoire (graphique mais pas seulement) qui auront suivi l’apogée de la civilisation du progrès. Sock Monkey joue ainsi d’une indécision essentielle, faisant mine d’être tiraillé en son cœur entre passé et présent, enfance et âge adulte, candeur et discernement, espoir et affliction. Cette tension dynamique telle que la suscite et l’entretient Millionaire, propre d’ordinaire au souvenir dans sa version la plus duelle et la plus mélancolique, permet à l’auteur d’exciter les mécanismes de la mémoire individuelle et collective sans en devenir le serviteur ou bien la proie.
Chaque récit – ce volume en compte quatre – nous invite en sa case inaugurale à pénétrer l’intérieur d’une demeure bourgeoise, à chaque fois différente. Les architectures sont toujours accueillantes, paisibles, radieuses mais non dénuées d’ambiguïté : l’inquiétante étrangeté n’épargne pas les maisons de poupée grandeur nature, les enclos utopiques, les paradis sous cloche du temps passé. Les planches offrent un découpage discrètement savant, maîtrisé jusqu’à l’effacement. Deux masses, l’une rayée, l’autre noire, Oncle Gabby et M. Corbeau, jouets d’enfant, singe-chaussette et oiseau-peluche, y déambulent, y glissent, y grimpent, y chutent, s’incarnent protagonistes remuants et loquaces. Le duo parcourt un univers aux propriétés singulières : ce dernier fluctue autant qu’il est figé. L’enfance est ainsi faite, les souvenirs aussi, essence double, paradoxale, fluide et minérale. Les aventures se succèdent, miniatures épiques, mais rien ne change jamais. C’est l’éternel présent que ce temps-là, celui que l’on ne veut pas quitter et celui que l’on ne peut pas fuir – le monde de Sock Monkey est une prison dorée.
La vie foisonne de manière insolite en ces pages, puisque essentiellement composée d’animaux qui causent (fourmis, souris, geai bleu, chauve-souris) et d’objets qui s’animent (jouets et reliques). A l’occasion, on pourra cependant croiser deux jambes d’adulte, une main armée d’un balai, un enfant colérique aux lourdes anglaises : des spectres humains s’ébattent à la périphérie de ce monde. Un de ces fantômes, le plus important d’entre tous sans doute, reste invisible : l’être qui invente, s’invente, les histoires auxquelles nous assistons, l’être qui anime Oncle Gabby et M. Corbeau (toujours eux, dans chaque maison-récit, présences immuables), l’être qui chamboule les maisons de poupées et fait voguer les modèles réduits de navires. Pourquoi supposer cette présence ? C’est que parfois singe-chaussette et corbeau-peluche paraissent adopter, sous le trait d’un Millionaire aussi précis que subtil dans ses effets, des postures un peu roides, des attitudes qui simulent la vie plus qu’elles ne la respirent. Comme si nos deux héros venaient d’être déposés là, contre un mur, sur une marche, dans l’herbe, épaves sans conscience révélant subrepticement leur condition d’objets inertes. Le libre arbitre présumé des habitants de ce monde se charge alors d’équivoque, et tout paraît régi par la volonté d’une main invisible et d’une voix ventriloque. On en vient à concevoir, dissimulée dans l’entre-deux des cases, une petite fille aux boucles blondes régnant sur ce micro-univers infini…
Petite fille que l’on ne s’étonnera pas de découvrir, copie conforme de celle que l’on s’était figuré, en ouverture du quatrième récit. Ann-Louise, s’appelle-t-elle, Boucle d’Or impériale et simili d’Alice. Alors quoi ? Oncle Gabby et M. Corbeau, de simples choses dont les contorsions et les culbutes obéissent au bon vouloir d’une maîtresse de cinq ans ? On sera bien en peine de l’assurer : la relation entre les objets et leur propriétaire supposée est des plus troubles. C’est que nous ne sommes pas ici dans l’univers de Toy Story, où les jouets ont une vie propre indubitable, ni dans celui de Calvin et Hobbes, où le tigre révèle fréquemment sa nature de peluche subordonnée. Bien plutôt, Sock Monkey distille, autour de la question du sujet, un fantastique qui ne se résout pas – nouvel élément d’indécision, nouvelle tension, essentielle, qui vient s’ajouter à celle énoncée en ouverture.
Et la question, parce qu’irrésolue, est bien sûr centrale. Elle influe en effet de beaucoup sur la lecture des événements. Sock Monkey relate-t-il les dérives perverses d’une petite fille de la bourgeoisie du XIXème qui, d’oiseau ligoté en souris mutilée, de peluche suppliciée en fourmilière éventrée, décline les appétits de fantaisies morbides, les désirs de destruction totale qui hantent non seulement son jeune âge mais aussi sa classe et son époque ? Ou bien ces événements sont-ils, tout simplement, le fait accidentel de deux peluches venues à la vie, aussi innocentes que maladroites ? Ces questions sans réponses, ce fantastique qui ne se résout pas, c’est aussi l’impossibilité pour le lecteur de déterminer avec exactitude le quotient d’horreur niché au creux de Sock Monkey. Fables pour enfant aussi cruelles que cocasses, pochades burlesques à tendance dépressive, chroniques immorales à la secrète ascendance sadienne ? Manière courante de résorber la tension, d’aucuns choisiront d’en rire…
Jérôme LeGlatin