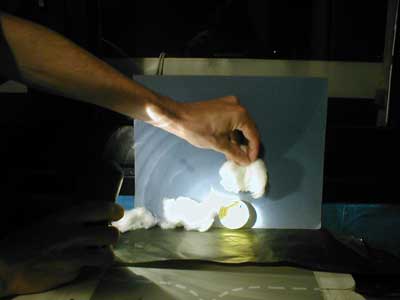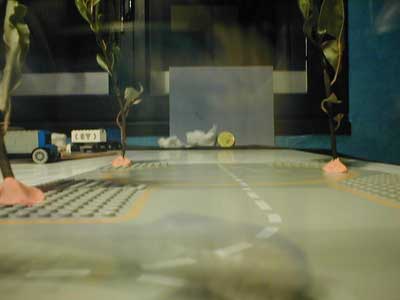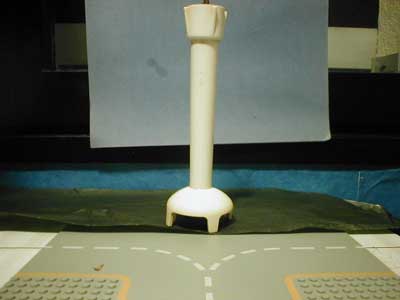 |
074021 Après Cergy-Pontoise, prendre la nationale 14 en direction de Rouen. En prenant de l'essence au supermarché de Gisors, sur le chemin du travail, le ciel bas se prête admirablement à des considérations pas très réjouissantes. Le parking de ce supermarché fait grise mine, les troènes qui le bordent sont tous atteints de lèpre, une ordure de papiers gras et d'emballages dépecés jonche le sol et les taillis, les graffittis étouffent les murs, tout est l'abandon et les indications de volume et de somme à payer, même lumineuses, peinent à se rendre lisibles sous l'épaisse couche de crasse qui couvre les pompes. La guérite de la caisse a été refaite il y a un an à peine, la précédente avaient des allures de bidonville, la nouvelle est pareillement promise à la jachère. C'est ici que je prends mon essence, non que je me plaise à y faire la queue qui y est souvent longue, mais c'est ici que l'essence est la moins chère. Et aujourd'hui plus qu'un autre jour je réalise qu'habituellement, je ne regarde pas ce que j'ai sous les yeux, l'abandon à la saleté de cette pompe annexe, je dois sûrement détourner le regard, comme nous apprenons à le faire de la misère, de celle qui est à notre seuil et qui dérange notre confort douillet. Nombreux sont ces espaces de la ville qui sont régulièrement sacagés et pour lesquels on se plait souvent à souligner que ceux-là même qui les ont endommagés, souvent en les rendant inutilisables à tous, ne feraient pas de même chez eux. "Quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend on a raison de penser ce qu'on pense". Dans le cas du parking du supermarché de Gisors, c'est la gérance même du supermarché qui est assez vandale pour nous infliger le spectacle désolé de ce parking en friche. D'ailleurs en y pensant bien ces espaces de vie intermédiaire, là où nul ne pourrait dire qu'il a vécu quoi que ce soit de notable, moments de la vie que nous oublions au moment même où ils se produisent, descendre de la voiture, prendre un chariot, faire ses courses, vider les courses dans le coffre, rapporter le chariot, démarrer et repartir chez soi, tant de tâches accomplies dans la précipitation de vouloir s'en échapper au plus vite, ces espaces de vie, où la vie n'est pas donc, se sont dégradés sans que nous nous en soyons aperçus. Cette dégradation fut lente. Lentement, nous avons appris à ne plus voir cette laideur repoussante. La course au profit veut sûrement cela. Elle nous habitue au fait que le maintien des prix et de la qualité des marchandises se fait au prix d'une négligence accrue de ce qui lui est périphérique. Au même titre que dans la ville nouvelle où je travaille, je vois des facades de sociétés, certaines notables, dans ce qu'elles ont pignon sur rue et que leurs noms vous diraient toutes quelque chose, certaines de leurs façades, donc, portent encore en janvier 2003 les stygmates hérités de la tempête de décembre 1999. L'intensité du commerce est telle que nul n'a le temps de réparer la devanture, nous continuons à vous servir pendant les travaux. Nous avons appris à ne plus voir ces carreaux brisés, ces bâches devenues fort sales qui cachent la misère vraiment, nous ne les voyons plus et finalement n'ouvrons plus les yeux qu'arrivés de retour dans notre cocon, notre maison, hâvre de proreté et d'ordre. Sur le chemin du travail, je ne vois plus la périphérie de Gisors sur laquelle l'implantation sauvage de hangars et de supermarchés égrenne de ces structures à charpente métalique qui sont autant de verrues dans le paysage. Je ne vois plus en haut de la montée sur l'aire de repos où souvent est stationnée une cammionette de prostituée, des ordures et des ordures qui débordent de la seule et modique poubelle prévue pour receuillir seulement les papiers gras d'une famille qui se serait arrêtée là pour une courte halte. Plus loin je ne vois plus le village-rue que tous traversent à pleine vitesse et dont les murs des maisons qui bordent le route portent la saleté de la route jusqu'à hauteur d'homme. Je ne vois pas non plus la chaussée défoncée au rond-point, plus loin, au retour du travail de nuit c'est pourtant là que je m'arrête à chaque fois pour couper la route au sommeil. Et quand je traverse Cergy, sur l'autoroute, je ne vois plus ces immeubles mal conçus, mal dessinés, mal construits, ces quartiers qui n'en sont pas, tout juste une succession de rond-points, en s'approchant encore de Paris, les voies se font plus larges, je ne vois pas d'avantage les rambardes crasseuses, autour de Paris, les tunnels noircis au gaz d'échappement, je ne les vois plus, arrivant à Noisy-le-Grand, je ne vois pas davantage l'immeuble de Riccardo Bofill totalitaire dans la bruine, sale surtout, et dont on a le sentiment qu'il se delitte sûrement de partout. Les trottoirs qui le jouxtent n'ont pas été bitumés jusqu'au bout. Là les graffittis crient plus fort. En arrivant au travail j'apprends que les réseaux du monde entier essuient le feu d'une attaque virale. Ce n'est pas encore cette semaine que la façade sera refaite. Comme je ne la vois plus, je ne vais pas m'en plaindre. (26 janvier 2003) |
|
|
074623 Ces lignes extraites d'Espèces d'espaces de Georges Perec:"Cela n'aurait évidemment aucun sens s'il en était autrement. Tout a été étudié, tout a été calculé , il n'est pas question de se tromper, on ne connait pas de cas où il ait été décelé une erreur, fût-elle de quelques centimètres, ou même de quelques millimètres. Pourtant je ressens toujours quelque chose qui ressemble à de l'émerveillement quand je songe à la rencontre des ouvriers français et des ouvriers italiens au milieu du tunnel du Mont Cenis." Et quand je conduisais ce matin sur l'autoroute et ses tunnels déserts, j'entendais l'écho de cette voix qui ne pouvait pas être la mienne tellement elle me parvenait de loin, comme de l'autre tronçon d'un tunnel qui ne serait pas encore percé de part en part et dont justement de grossières erreurs de calcul et d'appréciation auraient conduit à ce que les deux tronçons ne se joignent pas, ma voix dans un micro, hier soir, au cours d'une lecture d'Espèces d'espaces de Georges Perec. (premier février 2003) |
|
|
074807
|
|
|
075003 Bifurquer ensuite vers Dieppe et Gisors. Le matin de bonne heure, toujours dans cette lutte inégale entre le sommeil envahissant et le conducteur dans la lune qui traverse les grandes plaines du Vexin, résistant tant mal que bien à la tentation de tout abandonner, je décide de m'arrêter là où je ne m'arrête jamais, là où d'habitude je n'ai même pas un regard pour les alentours apparemment condamnés au desert sans accident, au beau milieu d'une de ces étendues agricoles sans vie, à la faveur d'un chemin de terre qui oblique depuis la route. L'air est un peu mobile, l'endroit désert, il fait humide, je me suis éloigné de la route, une centaine de mètres, du coup les voitures qui filaient sur la longue ligne droite glissent sans le vacarme coutumier telles des navettes d'un autre temps. Au loin les nuages gorgés d'eau se fondent les uns dans les autres, toutes grisailles confondues, la lumière grise de l'aube pluvieuse est incertaine, la nuit retomberait derrière cette aube baclée que nul ne trouverait à redire. Au delà de Gisors, dans la vallée de l'Epte, les nuages sont au plus bas recouvrant tout d'un crachin qui ne tardera pas à m'envelopper, si je m'éternise ici, et rien ne m'en empêche vraiment. Ce paysage de plaine offre décidément le spectacle d'une grande monotonie. A l'approche des nuages lestés de pluie, le vent se lève sans grande conviction, je ferme les yeux et je me vois soudain en pleine mer (lors de mes incessants va et vients entre Portsmouth et le Havre), curieux quand même cette sensation marine au beau milieu de la plaine, de la terre, la fatigue rend ivre. Et le soir, je relis les notes des jours précédents de ce bloc-notes et je me morfonds de tant de médiocrité: que tout ceci est mal écrit, sans relief, l'image même de la plaine pluvieuse, il faudrait rayer tout cela d'un trait, gommer tous les laborieux reliefs et faire table rase, donner à entendre le silence de ce dimanche matin déchiré de temps en temps par le passage épisodique de voitures filantes chuintant sur l'asphalte humide. Le silence demande cependant un courage que je n'ai pas, que je n'aurais jamais: je suis cet agité sempiternel qui tourne et retourne la tête aux quatre coins de l'oreiller à la recherche d'une fraîcheur toujours plus évasive, je remonte dans mon automobile et fais le bout de chemin restant en baillant et en braillant à tue-tête Baby you can drive my car pour me tenir éveillé.(6 octobre 2002) |
|
|
075255 Je viens de retrouver le petit fichier 16062002.txt écrit sur le bord de la route sur l'ordinateur portable du travail, précisément à cet endroit: Et puis ce matin, à l'aube, en rentrant très prudemment, luttant contre l'invasion du sommeil au volant, je me suis arrêté de nombreuses fois sur le côté, en marge de la route, une faible ondée mouillait les blés blondissants en silence(16 juin 2002). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |