Fragment III - La fabrique
Je serai conduit assez rapidement à découvrir la grande salle qui a été consacrée comme espace de travail collectif ; c’est un habillage neutre, qui s’avilirait jusqu’au bureaucratique si les poutres immenses n’étaient pas apparentes (I).
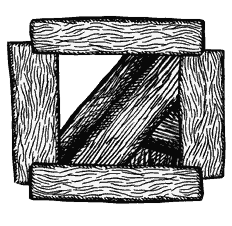 Il y a là quelque chose comme le début d’une agitation, mais c’est encore dans l’image d’une organisation à faire, un travail qui se justifie d’être un travail. Alex (Baladi) et Jonathan (Larabie) sont déjà partis dans le train de ce qu’on appellera plus tard l’accordéon, une subtile machine narrative inventée par Andréas. L’exaltation de Jonathan à décrire l’avancée de ces premiers travaux à plusieurs mains tranche un peu avec l’atmosphère légèrement éteinte qui plane encore ici. Il essaie de m’expliquer ce qu’ils sont en train de foutre en me montrant le jeu des cases alternées, émaillant ses descriptions d’une pluie de « manifestement » : rien, sans doute, n’est assez manifeste pour lui dans mon regard. Je n’y comprends que dalle, il me fout la trouille quand il est énervé comme ça... Il y a là quelque chose comme le début d’une agitation, mais c’est encore dans l’image d’une organisation à faire, un travail qui se justifie d’être un travail. Alex (Baladi) et Jonathan (Larabie) sont déjà partis dans le train de ce qu’on appellera plus tard l’accordéon, une subtile machine narrative inventée par Andréas. L’exaltation de Jonathan à décrire l’avancée de ces premiers travaux à plusieurs mains tranche un peu avec l’atmosphère légèrement éteinte qui plane encore ici. Il essaie de m’expliquer ce qu’ils sont en train de foutre en me montrant le jeu des cases alternées, émaillant ses descriptions d’une pluie de « manifestement » : rien, sans doute, n’est assez manifeste pour lui dans mon regard. Je n’y comprends que dalle, il me fout la trouille quand il est énervé comme ça...
Jean-Christophe (Menu) met au propre un premier projet de travail permutatif
collectif auquel nous serons tous conviés à participer. Je me sens pour l’instant bien peu préparé à me donner à ça ; je n’avais pas jusqu’ici voulu voir — trop intéressé par la perspective d’un déplacement, et je pourrai dire plus tard d’un déplacement complet — à quel point la nature oubapienne de ce projet était importante pour ses organisateurs. Je n’ai a priori pas tellement de goût pour l’Oubapo (II); j’allais écrire que je n’en ai pas plus pour l’Oulipo, mais c’est mal formulé, imprécis... Mes relations à l’écriture sous contrainte sont au moins aussi complexes que celles, ambiguës, que j’entretiens avec le jeu d’une manière générale. Je crois tout simplement que l’apparition de la contrainte dans le champ des formulations m’agace à rendre spécifique ce que je crois être, au fond, au travail dans toute oeuvre d’art. Le dégager en le formulant m’apparait en fait aussi grossier qu’une étiquette de prix laissée sur un cadeau. D’autre part, même si j’étais toujours très heureux de recevoir les étranges fascicules de toutes sortes — des numéros de La dragée haute aux recueils de bizarreries du dessin potentiel — que m’expédiait Noël Arnaud, j’avais toujours un mal de chien a excéder l’amusement. Je n’ai jamais pu m’empêcher de voir, assis sur l’épaule de Perec, un petit Perec complaisant riant de ses bonnes farces, et donc
jamais pu le lire sereinement. Et pourtant je suis fou de joie lorqu' un bref retranchement de la lecture m'offre cette vive petite vue aérienne survolant le plan d'une nouvelle de Balzac tel qu'il apparait en pleine lumière au détour d'une phrase. Et pourtant je fais absolument mienne la déclaration de Nabokov dans ses cours : « style et structure sont l'essence d'un livre, les grandes idées ne sont que foutaises ». Et pourtant, je m’obstine à précéder tous mes travaux, qu’ils soient graphiques ou d’écriture, d’un jeu de contraintes écrites si violentes, de plans métrés jusqu’à l’absurde, que je dois admettre être travaillé par la mise en lumière, moi-aussi, des machineries. C’est sans doute un jeu salutaire que d’arracher le masque de mysticisme imbécile dont on recouvre généralement la création des oeuvres.
Je ne sais pas à quel moment exactement je me suis senti assez libéré de mes propres habituels impératifs pour m’abandonner à ces exercices que j’avais condamnés si vite et trop fermement... Mais ces jeux à plusieurs mains se sont révélés fécondants là où je m’attendais à les trouver asséchants, et assez riches pour se poursuivre dans mon travail et le changer là où je les imaginais forclos par nature.
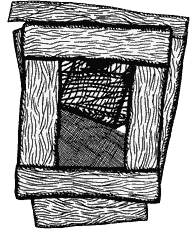 Je n’écrirai jamais assez précisément pour rendre justice à ce qui, dans le jeu des décloisonnements, s’est déroulé ici. Ce qui a réuni les différents dessinateurs de cette résidence est bien moins le siège d’une cohérence intellectuelle, d’une cohérence de manifeste, d’une homogénéité plastique, narrative, que, tout simplement, les goûts d’un homme ; il n’a aucune raison, lui, d’être arrêté par ces inhibitions qui constituent, souvent fâcheusement, le jeu des territoires. Je n’écrirai jamais assez précisément pour rendre justice à ce qui, dans le jeu des décloisonnements, s’est déroulé ici. Ce qui a réuni les différents dessinateurs de cette résidence est bien moins le siège d’une cohérence intellectuelle, d’une cohérence de manifeste, d’une homogénéité plastique, narrative, que, tout simplement, les goûts d’un homme ; il n’a aucune raison, lui, d’être arrêté par ces inhibitions qui constituent, souvent fâcheusement, le jeu des territoires.
Sans l’éclectisme et la ténacité à l’incarner dans cette résidence de Julien, il y a un nombre d’oeuvres que, sans doute, je n’aurais jamais regardées au-delà de la minute. On se satisfait souvent, par paresse ou par empressement, de
quelques traits que l
’on croit décisifs, que l’on suppose assez significatifs d’une oeuvre, pour la congédier instantanément dans l’oubli. La tenir hors de chez soi. Il ne fait aucun doute, par exemple, qu’ayant cru reconnaître dans le dessin de Joanna ce que j’ai l’illusion de croire être une école, une vague tendance poétique, je l’aurais négligé. Et j’ai été conduit, non seulement à y voir de plus près pour rencontrer une oeuvre passionnante, mais également à y éliminer un peu de ma propre typologie pour trouver, chez elle, plus de complexité que dans l’arrête vive et tranchante de mes choix. De même, de nombreuses oeuvres que j’aurais écartées en d’autres temps pour de tout aussi mauvaises raisons. C’est ainsi que chez soi s’agrandit. La résidence d’arc et Senans a non seulement agrandi un monde que je croyais à peine assez grand pour mes propres déplacements, mais elle a rendu floues les frontières qui en quadrillent la surface.
Le premier des travaux oubapiens auxquels je me sois abandonné est cette proposition de Jean-Christophe, compliquée pour moi par sa composante autobiographique. Pour faire très court, je hais l’autobiographie. Je vais dire ça mieux : je déteste la superstition tenace qui fait croire trouver dans la première personne du sujet une proximité de la vérité que ne saurait garantir, par exemple, l’essai ou la fiction. C’est à peu près aussi stupide que d’imaginer avoir voyagé parce qu’on a parcouru 1000 km. Dans les deux cas, nous avons affaire à une superstition de la distance.
Là encore, il faut bien entendre qu’est inaudible la défense d’une telle forme seulement en tant qu’elle se donne pour catégorie distinctive. De la première personne du sujet, sinon, il n’y aurait tout simplement rien à dire de plus ou de moins que du goût des adverbes ou des participes passés.
Je vois bien que la solution choisie par moi pour répondre à cette contrainte ne satisfait pas vraiment Jean-Christophe : mon texte est saturé
de références maniaques, il tisse brutalement des liens entre les différentes composantes plastiques et intellectuelles que fait rayonner l’architecture de Ledoux. Mais je ne triche pas. Ce n’est pas une manière de contourner le problème.
Livrer, de façon trop dense, trop courte et confuse, l’agencement de ma pensée, c’est bien ma façon d’être là. C’est ainsi que je joue réellement le jeu. Voilà pour ma présence. Je comprends bien que cette surcharge digressive rende assez difficile une éventuelle permutation avec d’autres travaux, mais je ne connais pas d’autre façon d’être au monde. En voici le texte :
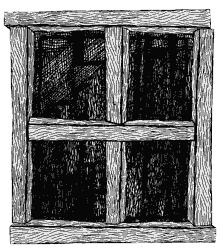 Ledoux ne me conduit jamais à lui-même (il disparaît derrière les images que je me suis faite de lui. Il est transparent à la définition que j’en ai arrêté il y a 25 ans). Ledoux ne me conduit jamais à lui-même (il disparaît derrière les images que je me suis faite de lui. Il est transparent à la définition que j’en ai arrêté il y a 25 ans).
Mais sans lui, serais-je retourné à Boullée (c’est-à-dire dans le couloir des siècles qui se déversent dans le ventre de l’architecte (III) après avoir servi de couveuse à Mussolini ?)
Sans Ledoux, serais-je retourné à Lequeu, c’est-à-dire dans le jardin grotesque qui offre aux divinités épuisées de la philosophie naturelle la cinglante obscénité d’un vagin littéral, feuillu, aux lèvres grenue de calcaire : un jardin imitant un sexe imitant un jardin?
Et sans Ledoux serais-je revenu à Lancelot Brown (IV)?
Travaillant à l’échelle du temps et de l’espace alourdi des végétaux, des roches, il n’aura jamais pu se payer de la conséquence d’un travail opiniâtre et colossal de paysagiste... Le perfectionnement que Brown apporta au
concept hasardeux de naturalisme lui fit réaliser la plus titanesque des oeuvres invisibles ; arbres arrachés et replantés, haies dispersées, émiettées et rassemblées, rocs déplacés pour faire des montagnes plus vraies que des montagnes.
Lancelot Brown s’est fait le taquin de Dieu.
Ainsi, les promenades du dimanche que les Anglais en famille vouent à la nature intacte traversent, sans qu’ils en puissent rien distinguer, les jardins naturalistes parfait de Lancelot
Brown.
- De ces poutres monumentales Benjamin (Novello) a fait le motif (aux deux sens
de la cause et de l’élément) d’une étrange activité de composition ; ayant fait un court bréviaire de poutres dessinées, il les découpe, en déploie un nouvel éventail par le jeu des changements d’échelle qu’offre la photocopie, rédécoupe, agence, ordonne et réalise cet ensemble fascinant de constructions graphiques. (retour)
- j’ai conservé, de mes travaux oulipiens en bandes dessinées du début des années 80, très peu de choses. J’avais toutefois mis en ligne, l‘année dernière, pour y voir un peu plus clair dans le désordre qui a conduit mon travail jusqu’ici, une planche de 1984 moins merdique que les autres, donnant à Hergé un crayonné de Fred (retour)
- Film de Peter Greenaway dont le déroulement vise à faire dialogue de l'architecture et l'histoire, sur la trame (Foucaldienne? Warburgienne?) d'une actualisation de cette dernière (avec la première pour sanctuaire) dans les discours de la célébration (de la vision à la tyrannie). (retour)
- Lancelot Brown est un paysagiste anglais du XVIIIe que j'aime imaginer, comme Matthijs Van Boxsel (« L'encyclopédie de la stupidité » ) excéder toutes les limites distinguant le naturalisme de son modèle. L'image la plus proche de celle qui me vient à l'esprit quand je pense à Brown, me vient d'une anecdote racontée par Borges (où? Je serais bien infoutu de m'en souvenir). Accroupi dans le sable près des pyramides, il fait dans le creux de sa main un petit tas de sable brûlant. Il s'approche de la pyramide, et laisse s'écouler le sable entre ses doigts pour en faire un autre petit tas, sur el sol, rapidement emporté par le vent.
Il dit : « j'ai déplacé le sahara ».( retour)
|
