
thèmes : narration sans sujet, poétique iconique, hyper morale
Guillaume Chailleux & Jean-François Savang

[...] Comment les prendre au sérieux ? C’est si facile. Ils ne constituent pas des adversaires crédibles, ni même motivants. Vous ne pouvez perdre face à aucun d’entre eux. Ils ne deviennent jamais menaçants. S’ils tuent votre frère Amos à coups de pelle (Acme Novelty Library 5, p. 18), vous vous réveillez. S’ils meurent, c’est à l’issue d’une série d’illusions telles que vous ne pouvez pas y croire [...]
[...]
G.C. : Bon, il est trop tard, profitons donc de ce temps perdu : je
crois que je me suis pris au piège de l’alternative
entre deux naïvetés avec cette histoire de narrativité.
Celle qui consiste à prendre l’œuvre au pied de sa
lettre « expressive », psychologique, mimétique
(pour la condamner ou la louer), et celle — plus savante —
d’une littéralité qui serait la critique sans
reste de la première alors qu’il semble bien qu’elle
lui fasse bien une place, cette « critique littérale »,
à la narrativité. Ou plus exactement, qu’elle la
fasse sienne, et immanente. Parce que la distinction ne serait pas
entre narration (contenu) et littéralité (forme) mais
entre ces deux éléments du poème et la
représentation qui fait l’abstraction de la première
distinction, et dont la dualité rationnelle cache une volonté
ontologique (narration « abstraite »).
C’était
peut-être cette narration immanente (concrète) que nous
invoquions, moi, selon Foucault disant n’avoir écrit que
des « fictions », et toi, te repositionnant avec Mieke
Bal (1), faisant du narratif une pratique théorique.
Et
il me semble que c’est ici que ça commence à être
intéressant — et qui fait qu’il est si tard aussi
: tirer du narratif dans ses effets les plus apparemment abstraits
(et asservissants, idéologiques) : expression, mimétisme,
psychologie (!) des continus jusque dans le matériau de
l’œuvre. Je veux dire une critique littérale sans
unilatéralité... non pas seulement dénoncer
l’abstrait, mais en établir la continuité avec le
concret (subjectivation des rapports de pouvoir chez Foucault : le
pli), non pas seulement faire la part de l’abstrait mais faire
sa part à l’abstrait, dans le souci délicat du
continu dans le sujet et non pas celui de l’unité
ontologique de l’œuvre (mais un usage concret de
l’abstrait, comme le littéral est un usage critique du
concret : un concret de la métaphore ?)... Nietzsche insiste
sur le fait que tout discours finit par devenir une réalité
(faut-il entendre que la représentation n’existe pas, et
qu’il est donc urgent de s’en emparer ?...) Mais sans
doute ne fais-je ici que redécouvrir un des fusibles d’une
anthropologie poétique ? (Y aurait-il eu là alors
matière théorique à rendre compte d’un
certain décalage que nous ressentons chez Ware... Sans
cuistrerie, comme tu m’en prévenais envers cet emmerdeur
familial et pleurnichard ?)
J.-F.S.
: Ware est un timbre
postique.
Cela a peut-être un sens : celui de défaire la vignette
de toute idée d’unité. Ses assemblages sont
parfois tellement minuscules qu’il me faut rétrécir
pour retrouver une échelle de lecture raisonnable. C’est
à partir de là que je réussis à me
perdre, qu’il me gratte, que la madeleine de Proust dans
laquelle il travaille a l’odeur de l’énurésie.
Chaque page devient comme un pli du corps, comme une insupportable
histoire d’intimité. J’ai l‘impression que
chaque page est une main qui cherche à coller mon visage au
plus près de son corps ; sur ses abcès, dans son gras.
Son humanité est dégoûtante. Les émotions
qu’il signifie sont comme du linge sale imprégné,
refroidi, défroissé après des années de
macération. L’autoréférentialité
fait bien sûr affleurer une poétique, une architecture
du sens ; cependant, c’est l’individu psychologique qui
fait loi, plus que le dessin et le langage. Et le «
sujet-du-poème » a du mal à se frayer un passage
dans le corps sans organe de cette composition refaisant à sa
manière l’odeur anatomique d’un corps.
Rappelons
que deux systèmes sémiotiques à classe d’unités
différentes, comme le langage d’un côté et
les images de l’autre, ne peuvent constituer un système
« hybride » : en effet, il n’y a pas d’unité
commune aux deux systèmes. Cela veut dire qu’au niveau
d’une hypothétique identification d’unités,
les caractéristiques signifiantes de la langue ne s’appliquent
pas telles quelles à la signifiance en image. D’une part
les images ne fonctionnent pas comme des unités linguistiques,
d’autre part la signifiance du langage appliquée aux
images passe certes par le transfert de la faculté sémiotique
du langage mais ne sous-tend aucunement une identité
ontologique d’un système à l’autre ;
d’autre part encore, les images ont sans aucun doute des
capacités de signifiance qui leur sont propres ; enfin si le
langage et les images font système, c’est de leur
rencontre et de la capacité commune à signifier qu’ils
font système à un niveau supérieur.
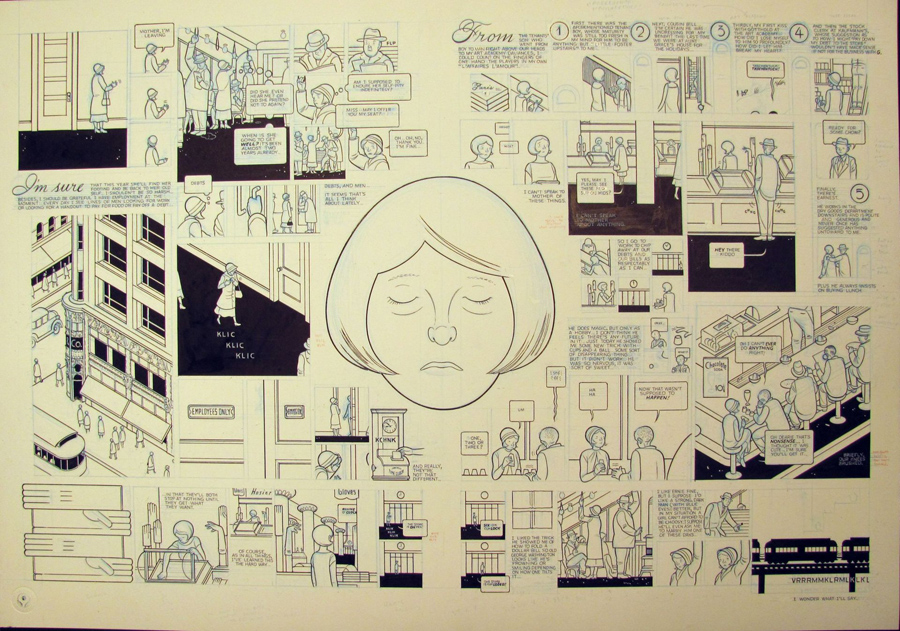
G.C. : Pour ma part, dans cet ordre d’idée autour de la représentation, de ses concepts à la hache et de sa pandémie virulente auprès de tout sectateur pieux du Vrai et du Réel, je lis Grœnsteen, et entre toutes sortes de doux lieux-communs, que lui sert son objet d’étude sans doute (traitement de la condition féminine ipso-facto, « réalisme » naïf, psychologie de l’auteur...), je retiens un point d’aveuglement qui fait symptôme, en conclusion de l’article, marquant un dualisme entre politique, éthique et expérience subjective : « une extraordinaire leçon de vie, ses conditions (?...), ses options (ça rigole pas...), son décor (en effet), ses rituels (on vise peut-être ici l’innocent projet ethnologique)... » mais alors donc « sans interroger les structures du monde social et les rapports de domination », un truc inexistant en fait (une représentation collective), peut-être un objet « esthétique », « inépuisable qui ne cesse d’étonner » et qui n’a pas d’autre sens que fantasmatique parce qu’il n’en a jamais pris les moyens — du sens ou de son inconnu (ça !). On n’est même plus, ici, dans un débat entre signifiance et discours (ce que j’essayais d’esquisser), on n’est nulle part : où une certaine réussite formelle, une esthétique, un style créent un point d’aveuglement éthique, politique, poétique total : un « effet de réalisme »... Non ?...
J.-F.S.
: « La société casse au point faible du signe »
(Meschonnic). On pourrait considérer, à cet égard,
que Ware porte le travail de l’insignifiant non seulement sur
un plan narratif, mais plus précisément sur le plan de
« l’énonciation graphique » ou d’une «
discursivité » particulière du dessin. Cette
manière de dispersion du sens laisse entendre «
l’individu » comme un négligeable du sens.
Pourtant, au-delà d’un travail serré entre les
modes de signifiance, c’est la question du sujet introuvable
qui domine, un désir d’individuation borné par
l’air du temps. Tous ces agencements de l’intimité
sont l’expression du sujet-individuel ; et s’ils
suggèrent une exploration, si la réalité est
pensée du point de vue de l’insignifiant, étrangement
formé aux contreforts du libéralisme, il fait remonter
à la surface l’amplitude baveuse du sujet narcissique
occidental.
Les
cases sont souvent petites et il faut avoir de bons yeux pour
s’accrocher aux détails. Cela contraint à
regarder de près, à ralentir. Tiny-Ware fait
l’espace-temps de l’aventure dans le détail, dans
l’haleine putride d’une oralité inconsciente où
même le rêve n’est pas plus libérant qu’une
enclume. C’est un récit de la frustration qui est en
place. L’homme blanc-masculin-normal
y expose sa frustration de la réussite. C’est le rêve
du prolétaire qui rêvait de devenir bourgeois qui est
ici américanisé, et dont le miroir est promené
sur les routes de l’Illinois. C’est le choix du loser
comme figure de l’ère du temps contre le super-héros
introuvable dans la vie « réelle ». Autre
insignifiant de la chaîne des frustrations qui voudrait nous
faire croire à une tonalité poétique, qui y
affleure et se vautre cependant dans le signe.
G.C.
: Je trouve également très problématique cette
confrontation langage/dessin ou même langage/composition qui
n’atteint jamais son « niveau supérieur »,
comme tu dis, sa co-effectuation, sa conscience toujours reprise par
le sens — donné. Il m’avait d’abord semblé
que Ware était en dialogue avec une forme autoritaire du
livre, une critique du pouvoir, de la modélisation. Qu’il
se glissait dans son façonnage massif et édifiant afin
de l’en détourner. L’ironique entreprise de
modernité se défile en vrai roman familial et
psychologique, auto-dérisoire, bavard et impuissant. La
détabulation espérée dans la Boîte
(N.D.L.R.: Building
Stories)
n’arrive jamais, les durées plurielles, la
délinéarisation disruptive du récit, le
communisme de lectures et d’écritures utopiques du sujet
(politique), la dépersonnalisation joyeusement criminelle
(éthique) restent lettres mortes. Toutes ces virtualités
littérales,
ses signifiances ne résistent pas au non-désir d’un
sens partout signifié, de la fausse promesse du titre
(l’invisibilité de toute historicité sous la
singerie historiciste : « laisser une trace [...] de ce que la
« vie ordinaire » pouvait être au début du
XXIe siècle »), à l’énonciation de
son programme intra-diégétique (le beau comme sens
interprétatif, rationalité du rêve et rêve
de rationalité), en passant par les déclarations de
l’auteur (« construction du sens », nullement un
constructivisme
comme en témoigne le rabattement sur le personnage
principal),
jusqu’au pauvre usage qu’en fait une critique qui indique
toujours le sud (« reconstitution a posteriori », «
dégager un récit cohérent », «
rendre la narration intelligible »), en rien empêché
par une œuvre sage, et à laquelle les lecteurs
emboîteront le pas sans difficultés.
On
ne peut sans doute se vouer ainsi à une telle passivité
morale et donner une œuvre. Juste un catéchisme pimpant.
Nihilisme à travers les âges. Ce livre est en effet
historique.
Mais
j’aimerais qu’on revienne sur cette possibilité
narrative faite d’une littéralité matérielle
doublée d’une littéralité abstraite
dont je qualifiais le processus « d’historicisation »
(avec Foucault et ses « fictions » et Mieke Bal...) et où
le plus beau me semble être que le référent
disparaisse mais jamais le réel (le signifiant comme présence
utopique et non pas présence/absence du signe), une extension
du narratif au théorique, disais-tu ?... (une œuvre
d’art, une politique comme Ware ne nous les fait pas avec tout
son génie.)
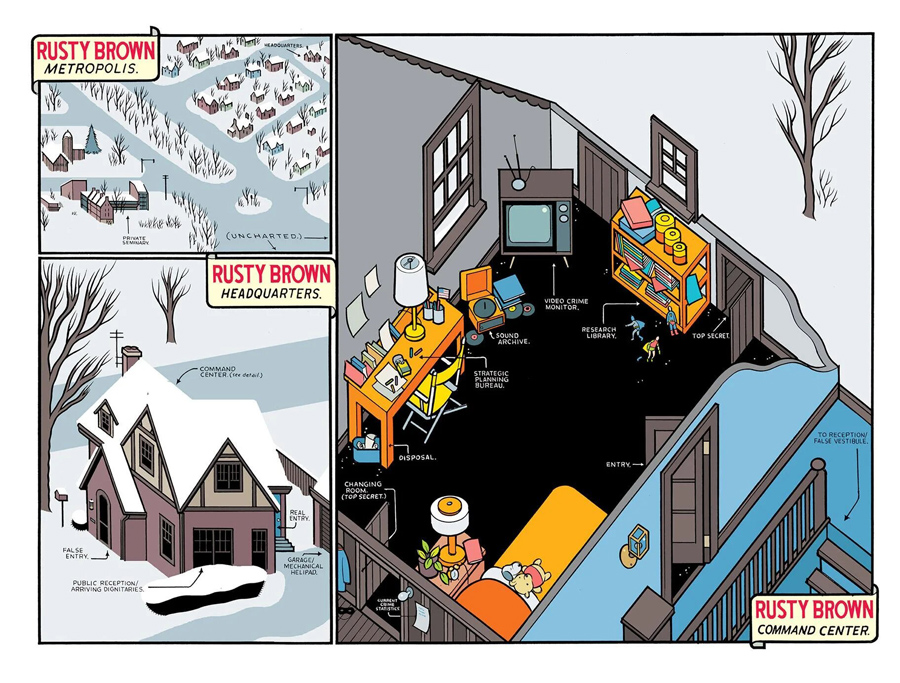
J.-F.S. : Ah, le génie de Ware ! J’ai envie de dire : il est pas con ce Ware ! Et ce n’est même pas lui qui se déclare comme tel. Mais qu’est-ce que ça fait écran à la lecture et à la critique ! Il faut d’abord nettoyer le Ware, retournant la conception du poncif chez Baudelaire : créer le génie, voilà bien dans l’ordre des sacralisations esthétiques un sacré poncif. Quelle voix étrange, cependant... cherchant dans la pâte autobiographique à faire de l’émotion la matière de subjectivation. La notion d’émotion me semble en dire long de l’appareil narratif en question : il raconte un beau « malaise dans la culture », l’histoire de tout le monde, l’individu psychologisé. Et il y a bien un quelque chose de particulier qui en ressort, mais cette subjectivation me semble très conforme à ce foutu sujet unitaire-volontaire-blanc-normal-occidental. En même temps, il y a dans ces mouvements internes, une poétique au sens des dérives qui font de la construction du point de vue, une dynamique d’univers. Par « point de vue », j’entends ce qu’il y a à voir et à dire en même temps, le fonctionnement d’ensemble porté dans ses moindres détails. Il n’est que de s’arrêter un instant sur le paratexte dans Jimmy Corrigan. « Instructions générales » ; « Introduction » ; « faculté de recherche », puis « bref historique » : « Il est communément admis que le but suprême de toute poursuite esthétique est d’appréhender une méthode permettant de reproduire l’expérience humaine dans toute sa complexité, sa richesse et son universalité [...]. Dans le cadre de cette théorie, le langage de la bande dessinée peut être considéré comme le point culminant de plus de deux mille ans d’évolution de la civilisation, et comme la plus haute expression de l’accomplissement humain encore à venir ».
Il y a là l’illustration d’un progressisme imbécile et sélectif, une occidentalisation de la théorie un peu plan-plan (c’est de toi que je tiens cette expression). En tout cas, on a là une théorie extrêmement linéaire du récit de l’art, un mythe de la Caverne de la bande dessinée qui aboutirait à... Chicago. Que la bande dessinée suggère « un nouveau langage pictural », je n’en sais rien. Je ne sais pas si c’est un « langage pictural » comme le dit Ware. Certes, je sens bien à la lecture de Ware la force de composition et le point de vue d’ensemble comme les conditions d’une energeia signifiante dans ses moindres détails (par exemple la circulation du vermillon : oiseau/téléphone/heure/inscription dans l’agenda/onomatopées/béret/sang/ketchup/fond de certains embrayeurs narratifs/etc.) ; mais pour le « langage », je parlerais plutôt d’un système prosodique mêlant à la fois l’évocation par le dessin et la signifiance discursive pour constituer une sorte de poétique iconique interne à l’activité de signifier. Nous approchons des enjeux plus cruciaux de l’« Explication Technique du Langage, Niveau Deux » ; que vais-je apprendre ici ? Il ne s’agit pas, contrairement à nombre de simplifications du travail signifiant, d’un simple déport de codage. L’ambition est clairement poétique derrière la fausse vanité du timide Ware : « la plupart des talents requis pour la compréhension de ce volume sont de nature essentiellement intuitive ». Du « langage », nous passons directement à la compréhension et à la lecture. Les différents niveaux d’assemblage prendraient leur cohérence dans l’intuition, c’est-à-dire dans l’idée que les choses s’organisent sans autre justification que subjective. Mais alors, qu’entend le « maître » quand il parle de « Nouveau Langage Pictural » ? Pile-poil le rôle que la sémiotique fait jouer à la bande dessinée depuis des années, convainquant le lecteur d’une visualité ontologique de l’organisation du langage dans le « signe iconique » : « Grâce aux découvertes technologiques récentes en linguistique picturale (illustrées par les consignes de sécurité des avions, les instructions de placement de piles et les modes d’emploi de protections hygiéniques), les talents de la Compréhension de la Bande Dessinée (CBD) restés jusqu’ici en sommeil sont aujourd’hui stimulés dans l’esprit des adultes ».
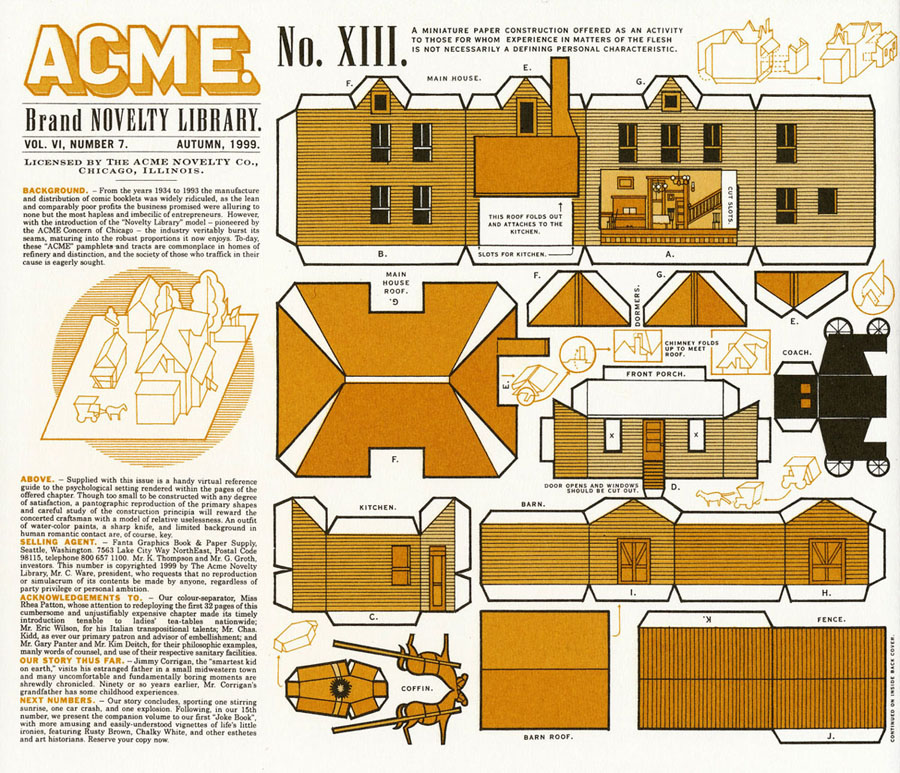
Tout
d’abord, je ne sais pas trop ce qu’est la «
linguistique picturale » ; d’autre part, on retrouve ici
un exemple de la simplification iconique comme facilitateur
communicationnel du message, comme mode de conformation. Pourtant, on
n’est plus dans l’ordre du message, que ce soit dans un
poème ou dans une bande dessinée. On s’en fout du
message. Comme le langage sert tout autrement l’écriture
d’une liste de course et le déploiement de la
subjectivité, communiquer un message au moyen de la bande
dessinée n’a rien à voir avec la subjectivation
artistique qui fait de la bande dessinée une expérience
inédite, transformatrice de la vision du monde des autres
sujets. De plus, cette histoire de « compréhension »
me rappelle que tout est mis comme chez McCloud du côté
d’une esthétique de la réception. Mais qu’est-ce
que c’est beau parfois quand on n’y comprend rien ! Quand
la compréhension en échec est l’échec à
son tour de toute raison organisatrice. Oui, il y avait une
manipulation ontologique à faire passer les mots comme la
matière du langage, sans voir que le sujet était lui
aussi matière constitutive de toute organisation dans le
langage. Le progressisme communicationnel et le caractère
performatif de l’image n’enlève rien à
l’affaire : il ne s’agit pas ici d’échapper
au verbocentrisme culturel du sens et d’ignorer la puissance
signifiante de l’image ; il ne s’agit pas non plus de
s’inscrire dans la représentation de l’universalisme
du signe et d’imaginer qu’il y aurait des niveaux
d’artefact moins idéologiques que d’autres. Le
signe reste un artefact plus idolâtre qu’iconique ; et la
régie du signe iconique appliquée à l’image
laisse entendre le chant des sirènes d’une ontologie de
la réalité là où finalement nous n’avons
affaire qu’à des agencements signifiants, à des
idoles démoralisées.
G.C. : Nous sommes bien d’accord. Aucune illusion à se faire sur le ton d’auto-dérision employé, nous avons bien affaire à un « Humour Libéral » (cynisme purement rhétorique) dans sa version sémiotique, qui sert donc une ontologie naturelle. Ton analyse d’une poétique du signe iconique me semble assez définitive. L’humour de Ware n’a pas du tout la même puissance et la même fonction que celui de Kafka — chez Deleuze et Guattari —, l’exhaustion des phénomènes de pouvoir ne mène pas à leur dégagement critique au-delà de la métaphore mais, au contraire, à leur intégration pour le plus grand confort métaphysique et sentimental du lecteur.
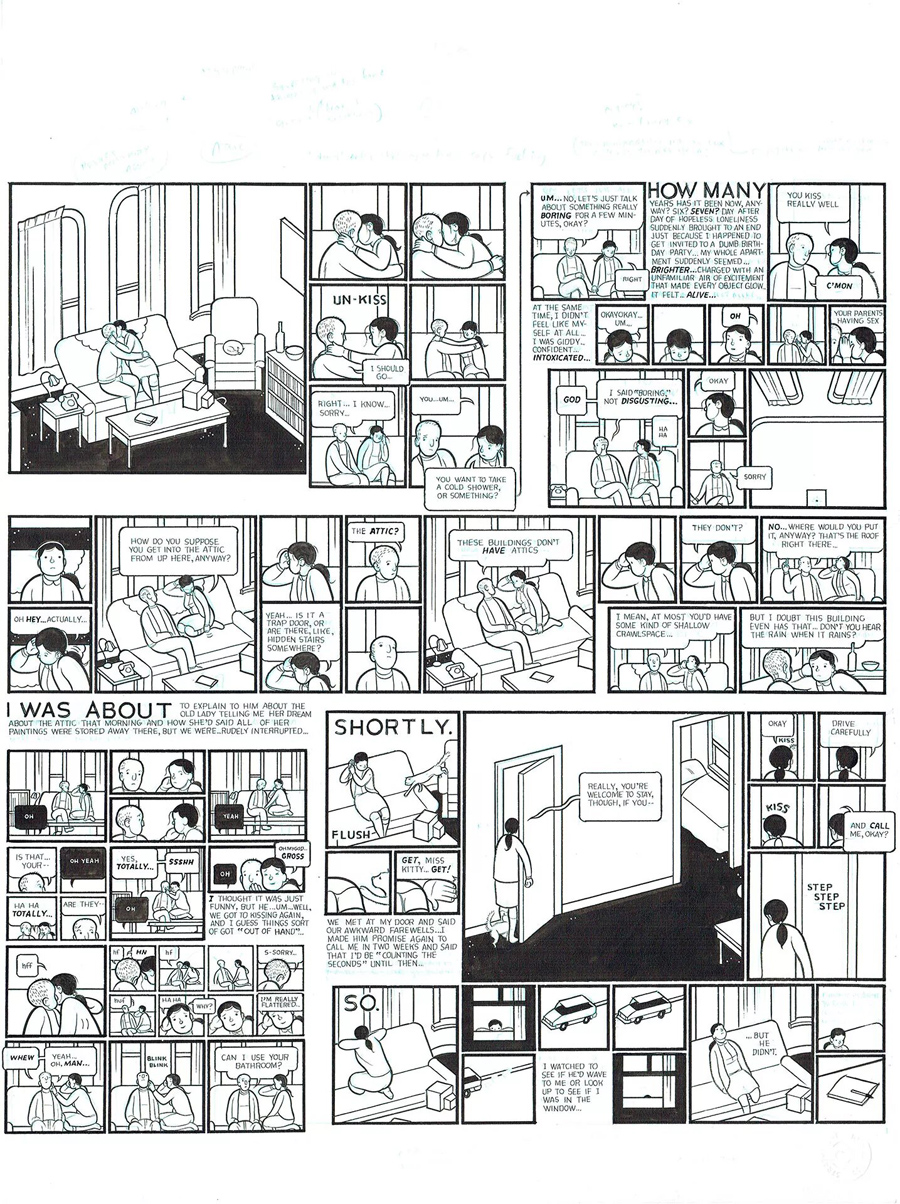
J.-F.S.
: Le problème, ce n’est pas de raconter des histoires.
C’est de faire comme si les histoires se racontaient
d’elles-mêmes, sans sujet, selon un discours qui efface
au maximum les traces de celui qui raconte. Le littéral, pour
moi, c’est d’essayer de faire passer ce qui est de
l’ordre de la représentation pour une réalité
sans tenir compte des stratégies du sujet dans le langage. Le
littéral, c’est prendre des vessies pour des lanternes,
le signe pour la réalité de la chose qu’il
représente. C’est pour cela que de l’artefact du
signe au monde qu’il représente il y a tout un appareil
ontologique, le jeu d’une essence du monde dans les signes du
langage. Pour cette même raison, l’image de la chose
représentée dans le signe est aussi d’une forte
teneur ontologique. Il y a le monde indiciaire qui guette au loin le
réel dans ses traces. Le dessin ressemble, schématise,
reproduit des objets du réel. Mais ces représentations
ne sont pas détachées d’un sujet qui les tient.
Dessiner une voiture ou un bonhomme, ce n’est pas simplement
extraire du réel une ressemblance. C’est instaurer le
monde dans le processus du dessin et l’anthropologiser à
ce titre. Jan Baetens rappelle avec W.J.T. Mitchell qu’on ne
peut aborder une image sans le langage, de même qu’on ne
peut aborder le langage sans l’anthropologie qui le fait. Le
littéral est illusion, effet de réalité : la
ressemblance importe moins que la manière ; la ressemblance
est inerte tandis que le dessin fait, dans sa manière, la
force d’une signifiance du monde pour un sujet.
G.C.
: On peut opposer à ce littéralisme réaliste
(terrible dans son désir d’un monde fini), une
littéralité formelle,
signifiante (plutôt dans sa tradition matérialiste
qu’idéaliste et esthétique). La question était
de savoir si on pouvait établir un continu pour l’analyse,
comme pour la création du poème entre cette critique «
sémantique sans sémiotique » et une discursivité
théorique, une narration (fiction) qui serait sa vérité
au sens où Foucault emploie ces deux notions. Mais on va être
un peu long là, on fera peut-être un numéro sur
McGuire, ha, ha, ha!...
J.-F. : Dans Building Stories, il y a plus qu’une remise en cause de la figure linéaire de la narration : j’y vois la recherche d’une polyphonie énonciative, d’une « graphiation » constellatoire. C’est la polyphonie des habitations collectives, l’enregistrement immobilier de la vie distribuée en tranches historiques : construction et reconstruction, d’où ces histoires de vies et les tremblements du langage dans les murs de l’immeuble ; les anciennes voix qui l’incarnent dans le temps. Cela rappelle l’aventure de New-York dans la polyphonie des destins mis en scène dans Manhattan transfer (Dos Passos). Car, il y a bien cette volonté de passer par l’architectural : « musique gelée ». Et de faire de l’agencement des espaces, la perspective d’un vivre et d’une expérience artistique. La narration est une construction jamais entièrement réalisée. Les changements d’échelle, les temporalités croisées, les jeux de focalisation télescopiques sont autant de mobilisations du corps et de la voix. Tu parlais à travers ça des enjeux de manipulation, de la reconstruction, de l’unicité de chaque lecture dans un ordre chaque fois différent. La question de la corporalisation, du corps accidenté, de la recherche d’une reconstitution impossible de l’entier me semble circuler de l’histoire à ses modes de présentation, incarnée par la jambe amputée de la jeune femme. Le corps, s’il est corporalisation, ne prend sa réalité que dans le rapport à la signifiance qu’il constitue dans sa représentation et les moyens langagiers de cette représentation. J’y mets le dessin du corps comme aventure du morcellement symbolique en quatorze parties. Pourtant, bien qu’il manque une jambe au corps de cette jeune femme sans nom, son corps est entier. L’absence de nom propre est particulier à la rhétorique de l’individu — on n’appelle pas l’individu ; ce vide du sujet ou ce sujet à remplir par un autre est une forme sociale imaginaire comme Benasayag parle de mythe de l’individu. Pas de nom, juste une emprise sociale, une plasticité instrumentale : un stéréotype imaginaire habitable par n’importe quel lecteur. Comme Jimmy Corrigan, c’est un faux « livre sur rien », plein d’agencements minuscules et de représentations stéréotypées. Ce n’est pas la complétude du corps qui fait le corps. Pourtant, il y a cette jambe qui manque, le décalage entre un corps réel et un corps imaginaire ; une jambe du désir, un sceptre d’émotion. Groensteen parle de fragments ; il a tort, ce n’est pas la logique de la chose, chaque élément est un entier, un passage dans l’histoire. J’y vois une concentration de moyens. C’est la polyphonie du temps en soi, pris dans les strates d’émotion, de l’imaginaire. Une temporalité propre à l’agencement de l’œuvre partagée en lecture.

G.C.
: Oui, j’imaginais cette nouvelle manipulation que nous propose
Ware comme extensivité du geste de la lecture, une sorte de
prolongement corporel d’une activité de l’écriture
: l’entre-deux d’une danse, singulière et
commune... Comme j’imaginais le passage d’une ellipse,
prise dans l’arthrose tabulaire d’un récit
névrotique, aux jeux d’angles de la boîte faisant
pivoter les sujets dans un espace nouvellement libre, une sortie, un
dehors, un infini topographique... Ceci avant de succomber à
son épuisante faconde de conteur libéral (et pas schizo
du tout). Si Groensteen se trompe sur la finalité totalisante
de tout ça, c’est en plein accord avec son objet.
L’usage qui est fait chez Ware du sens, de la représentation,
du sujet
ne laisse aucun doute sur l’absence totale de pensée et
d’imagination théorique, politique, éthique et
artistique de ce que lui a proposé sa fantaisie plastique et
éditoriale. Il semble qu’il surenchérisse sur
l’expression con
comme un peintre
en prenant très rétiniennement
à Duchamp l’idée de sa boîte. Pourquoi la
BD « d’importance historique » n’arrive-t-elle
pas à envisager le temps autrement que comme
narratif/individuant ? Est-ce le narratif (fiction) qui fait problème
ou une absence d’imagination et d’ampleur théorique
de celui-ci ? (2) Est-ce un problème esthétique,
politique ? Pas d’image-temps
en « bande-dessinée magistrale », juste une
interminable et précieuse
déclinaison de l’image-mouvement.
Des vanités Oubapiennes aux grosses œuvres américaines,
on a l’impression d’un grand foirage de la pensée
en BD. On l’a dite adulte, on la découvre pubère
hésitante, peu, entre de longues études et le monde du
travail (la signature). Toute une histoire des valeurs en BD est à
transmuter. La micro-édition semble s’être emparée
du problème. On a tout à gagner à abandonner
l’Histoire majeure de la « BD magistrale » pour
produire son historicité mineure. Parce que la BD a moins à
sortir d’elle-même pour trouver sa puissance qu’à
cesser son petit commerce — anecdotique — d’importation
extra-disciplinaire et transhistorique. Commencer à penser.
J.-F.S. : Je ne veux pas spécialement défendre la narration, que ce soit avec Ware ou un autre. Je ne veux pas l’ignorer non plus. Juste, s’il y a une histoire, il y a quelqu’un qui raconte, une discursivité énonciative. Mieke Bal distingue la narratologie comme étude des enjeux langagiers — y compris subjectifs — constituant un fait culturel — l’agir du raconter dans le langage — du genre. Mais au-delà de cette distinction qui me fait reconnaître le récit comme une forme sociale voire comme une structure mentale organisant notre rapport culturel à l’histoire et à l’expérience du monde, j’ai toujours l’impression d’être dans une forme apriorique de la pensée dissimulant ses processus et son discours, à des fins soit ontologiques soit esthétiques.
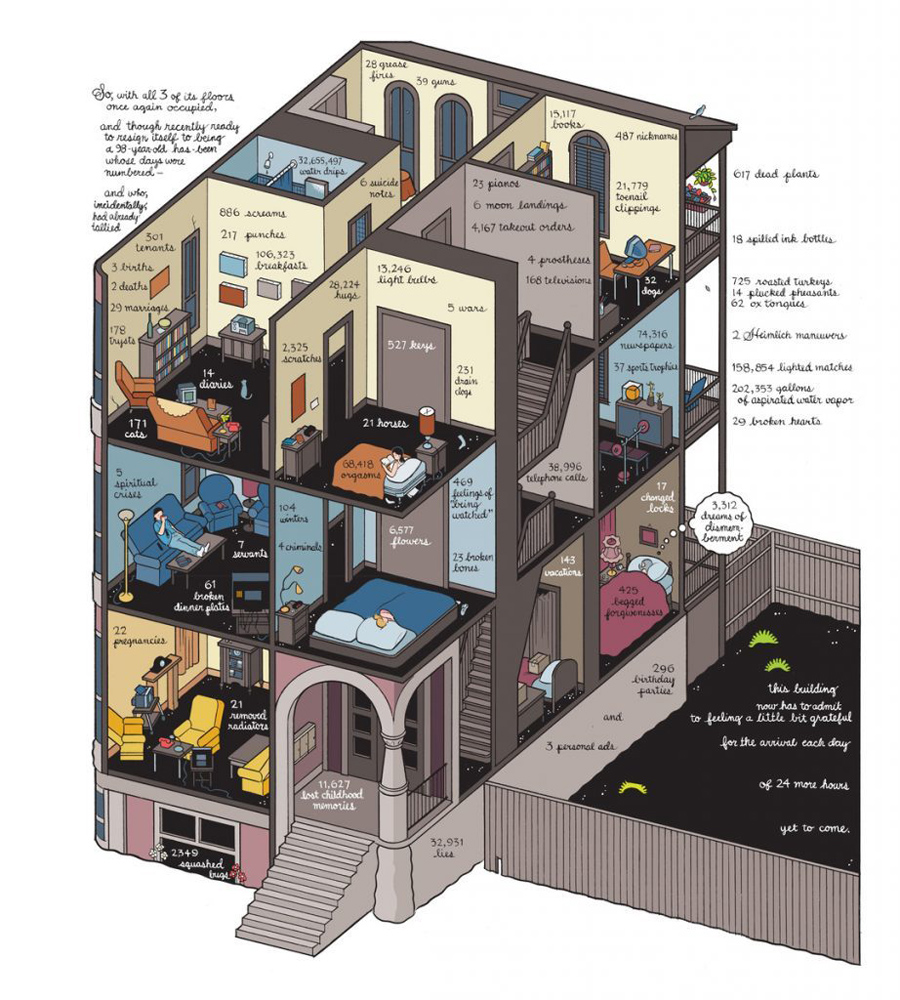
G.C : Je ne te reproche (!) pas de défendre la narration, mais plutôt de ne pas la défendre assez... puisque justement avec Foucault et Mieke Bal, je me souviens qu’il s’agissait, dans ton jardin, d’en élargir la notion à l’éthique, aux conditions du travail théorique, à la subjectivation. Plutôt, donc, faire la critique de la critique de la narration parce que j’ai l’impression que cette dernière fait écran à une sémantique de l’œuvre plus large. En fait, il s’agirait d’inclure tous les aspects du sens (politique, éthique, théorique) dans les moyens de productions dont use une œuvre d’art, à l’instar des autres « médiums » de la discipline plus évidemment impliqués dans la critique d’art. Ces matériaux sémantiques relevant eux aussi d’une question de goût, dirait Nietzsche... C’est peut-être reprendre la question de l’idéologie dans l’œuvre avec cependant, me semblait-il, cet acquis Deleuzien que justement l’idéologie n’existe pas, que tout est là, non pas seulement le matériel dans sa physicalité mais le pensé. Pas du tout la verticalité du super — et de l’Infra —, ni celle de l’Idée et du sensible, leur dualité abstraite, mais plutôt leur continu immanent dans l’art, leur sens comme matérialité. Parce que tout ça — éclaircir les conditions d’une critique de la narration au regard du sens de l’œuvre — me semble rendre possible une critique de l’échec de Ware, au-delà du simple constat d’une réussite esthétique et d’un manquement théorique, du constat benêt d’un choix entre « l’expérience subjective » et une « lecture politique » (tu parles !).
Ware
entretient une confusion : pour ne pas être dans l’effacement
du signifiant, il n’en use pas cependant avec une conscience
telle qu’il fasse autre chose qu’affirmer la
représentation et son monde clos. « Tout ce qui peut
être imaginé est réel » sonne chez Ware
comme une menace, comme le triomphe d’un réalisme
universel plutôt que comme un plaidoyer pour l’imagination.
Il y a d’abord une confusion entre les représentations
et l’imaginaire, nulle place à l’imaginaire autre
qu’anecdotique, dans une volonté déclarée
de faire histoire du quotidien pour les générations
futures, non plus que dans le projet intra-diégétique
de description du monde environnant ou dans son harassant goût
pour le néant anthropomorphique. Il s’agit de
reproduction. L’imaginaire, les procédés de
l’art, l’idée et la curieuse présence
de la boîte
sont impuissants à dire autre chose, dans leur heureux
clignotement sitôt disparu, que leur vocation poétique
manquée, reprise par une affirmation de la représentation,
qu’ils servent, comme Réelle. Je soutiens que l’absence
d’analyse des possibilités (des éléments)
d’une narration élargie le mène à élever
une réalité (politique) historique à son
apothéose ontologique (le Réel comme existant) et
unitaire. Que c’est un échec de l’art, que c’est
une œuvre tendancieuse qui joue la circularité théorique
d’un monde à reproduire. Il ne faudrait pas que Ware
soit le seul à penser qu’il est un artiste raté.
Tu dis le « dessin du corps comme aventure du morcellement
symbolique en quatorze parties ». À toute virtualité
de rapport réel, Ware substitue un glorieux et inoffensif
rapport métaphorique (de celui qui désespérait
tant Kafka). Je veux dire que le morcellement de la boîte
ouvre des béances elliptiques que Ware est très loin de
travailler dans leur possible ampleur symbolique. Tout ça
finit plutôt par évoquer la livraison d’un
précieux secrétaire, bourré de journaux intimes
soignés, aux formats occasionnels — « stéréotypie
imaginaire habitable ». Ce n’est pas seulement la petite
narration qui enferme le visuel,
le plastique,
c’est lui-même qui la produit, sa conne histoire trop
humaine. Ware n’est qu’un scout au regard d’une
responsabilité hyper-morale de l’œuvre. Il ne
s’agit pas de ce que dit une œuvre, ni de comment elle le
dit, mais de ce qu’elle fait (savoir, pouvoir, subjectivation).
Point critique, zone d’immanence, de pénétration
où s’évaluerait la valeur de la valeur que se
donne l’œuvre d’art.
(1) https://narratologie.revues.org/6909#text
(2) cf : les notions de « signature » et de « fiction » dans Pré-carré 7, Regarder lire Ici de Richard McGuire de Loïc Largier.