

Autrement dit la guerre,
sur le travail de Loïc Largier,
par Aurélien Leif
« Ludimus effigiem belli » Scacchia Ludus
La guerre passe en D2, rebondit sur six lignes puis s’étale sur une carte qu’aucune boussole n’oriente. Elle avait commencé par se fourbir des cadres que ses armes ont brisés et qui ont fait monter sur elle des images mensongères, trop adéquates aux faits, simplement iconiques de ce qu’elle ne commet pas. Il y a eu des batailles qui ont tracé un alphabet, des charges aberrantes composant le lexique de ses prochains mouvements et un exode de lignes pour débouter le tout — la guerre va bien, elle a deux jours. La voilà en C1 qui furète et s’étend en cassant les cadastres, A0 frappe B10 qui riposte sur Z-nul et en fend les contours — alors les luttes s’emmêlent dans une découpe sans bord, la guerre vient de fuir son nom et se déserte elle-même.
Loïc Largier pratique un art délicat de délinéation du temps et de délinéarisation des figures consistant à détracer les termes de l’espace pour en faire un événement sans coordonnées. Son travail fonctionne comme un montage de calques qui décadastre les cartes et où les planches font à peine livre tant leur forme d’usage se rompt d’une tierce continuité fondée sur l’interstice : Des combats (1) se traverse par plongeons transversaux, par profondeurs diagonales plutôt qu’en surface et linéairement. C’est une composition stroboscopique qu’on lit l’œil aplati, le regard tectonique pour une carte fragmentée. On imagine un général encoller ses mappemondes, les charcler à la hache et, après en avoir semé les paperolles dans la bouillasse d’un no man’s land, rabibocher tous ces fragments dans un herbier martial. Le petit livre 3 grands dessins verticaux (2) constitue un triptyque replié dont les faces extérieures sont dévolues au texte, un texte mitraillé dont les brèves séquences partiellement citatives s’engrènent par tirets enchaînés et déclinent en syncope une sorte de stratégie phrasée qui fait corps de sa carte. On passe de l’un à l’autre par une perpétuelle réversion du sens au fil du sens, le texte frappant la carte et la carte ripostant, avant que les deux ne se mêlent au gré d’un même mouvement qui les déporte ensemble et les dépose au sol comme deux belluaires en duel qui enfin forniqueraient. La guerre s’est invaginée et, tournée contre elle-même, tente de trouver, deux fois, sa teneur et son dépli. Reste à l’ouvrir, un peu, et si on lit la carte on glisse dans la bataille, et si on tourne la page c’est pour charger dedans.
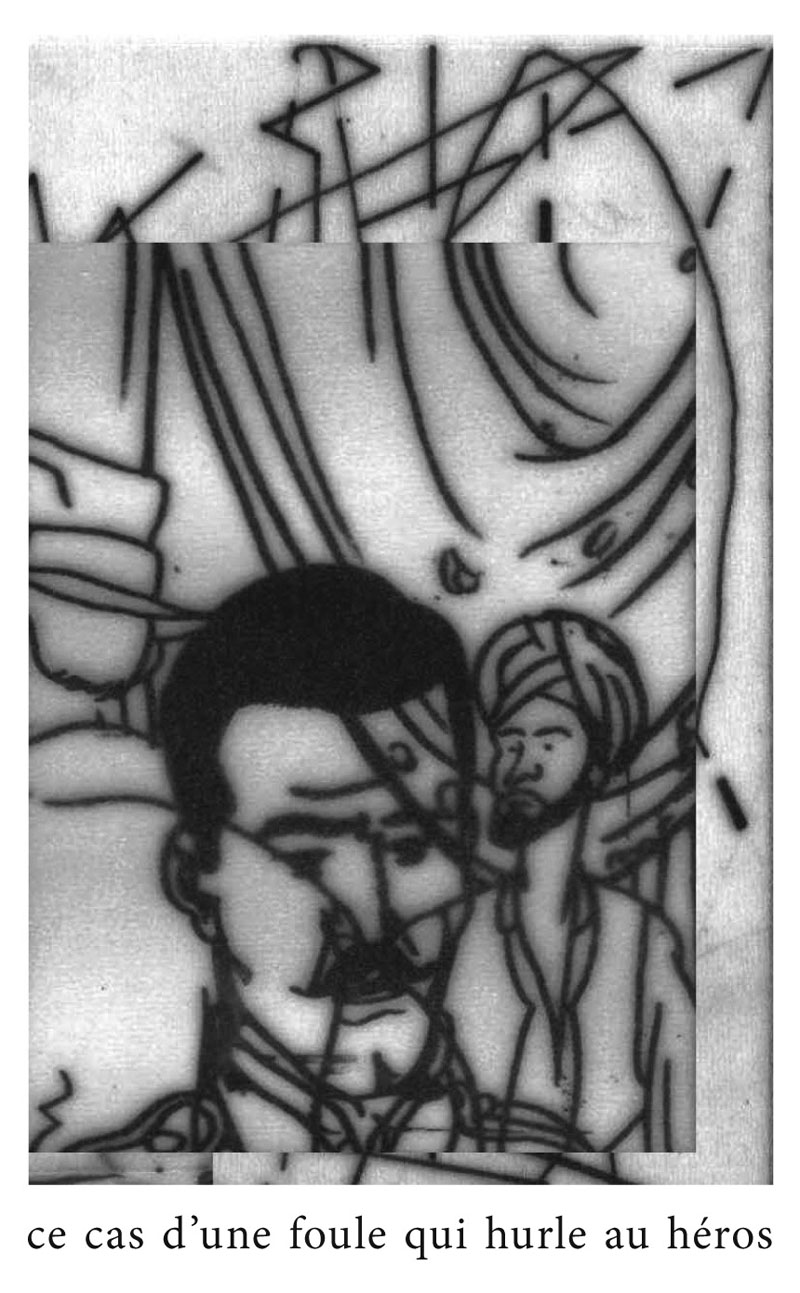
Le problème n’est jamais où commencer, mais comment se faire un ailleurs qui commencera pour nous. Oublions la BD, page et planche, trouvons plutôt une plage esthétique où pour l’instant tout est encore mêlé sans qu’on puisse même dire quoi. Il n’y a d’abord chez Largier ni texte ni graphe mais une texture qui est aussi sa propre guerre, du TOIL au partitif qui n’est pas un support mais un mouvement de texturation (3) : il ne se représente pas, il se modalise, tantôt sème tantôt graphe et si l’on veut graphsème, mais d’abord calque et carte qui se mêlent et font page (4). Pour lire Des combats, on ne peut se contenter d’un schème de superposition ou d’une double articulation pour voir le nervurage de la carte et du texte, car c’est une même opération qui les régit, une opération de découpe et de traversée s’instanciant selon deux modalités : la texturalité par lignes (texte), la texturalité par calques (carte). Texte et dessin ressortissent ici génétiquement à la matière et composition de la guerre plutôt qu’à un problème de sens qu’il faudrait déplier ou articuler, même s’ils se déterminent génériquement comme carte et comme poème. Ces deux modes de texturalité travaillent le dessin et le texte à titre de procédures internes confondues, mais le texte et le dessin sont en tant que tels des procédés externes disjoints, dont chacun assume un type de texturalité comme formation majeure ou mouture dominante (Jakobson) (5). C’est comme si la même motion venait animer sur ses deux pans une détermination double, du narratif dans le spatial et du spatial dans le narratif (6) : il n’y a ni calque ni décalquage entre les deux, leur écart est leur recouvrement ou leur duel amoureux, leur entre-guerre compénétrée. Ce n’est pas dialectique, c’est diérotique, et ce couple est disparate d’une concordance : le texte fonctionne cartographiquement en retranchant par salves des zones et des îlots d’un vaste territoire textuel pré-inscrit, la carte fonctionne comme délinéation textuelle de l’espace selon des noyaux et des catalyses (7). Tous deux sont soumis à la même coupe réglée, mots scindés d’une page l’autre ou strips scalpés au tiers, comme si la guerre les liait dans leur contusion même. Cette crase asynthétique du texte et du dessin culmine dans le trait, tiret typographique et pointillé topographique traçant une seule suite disruptive qui poinçonne carte et texte par une même ligne de coupe (8).
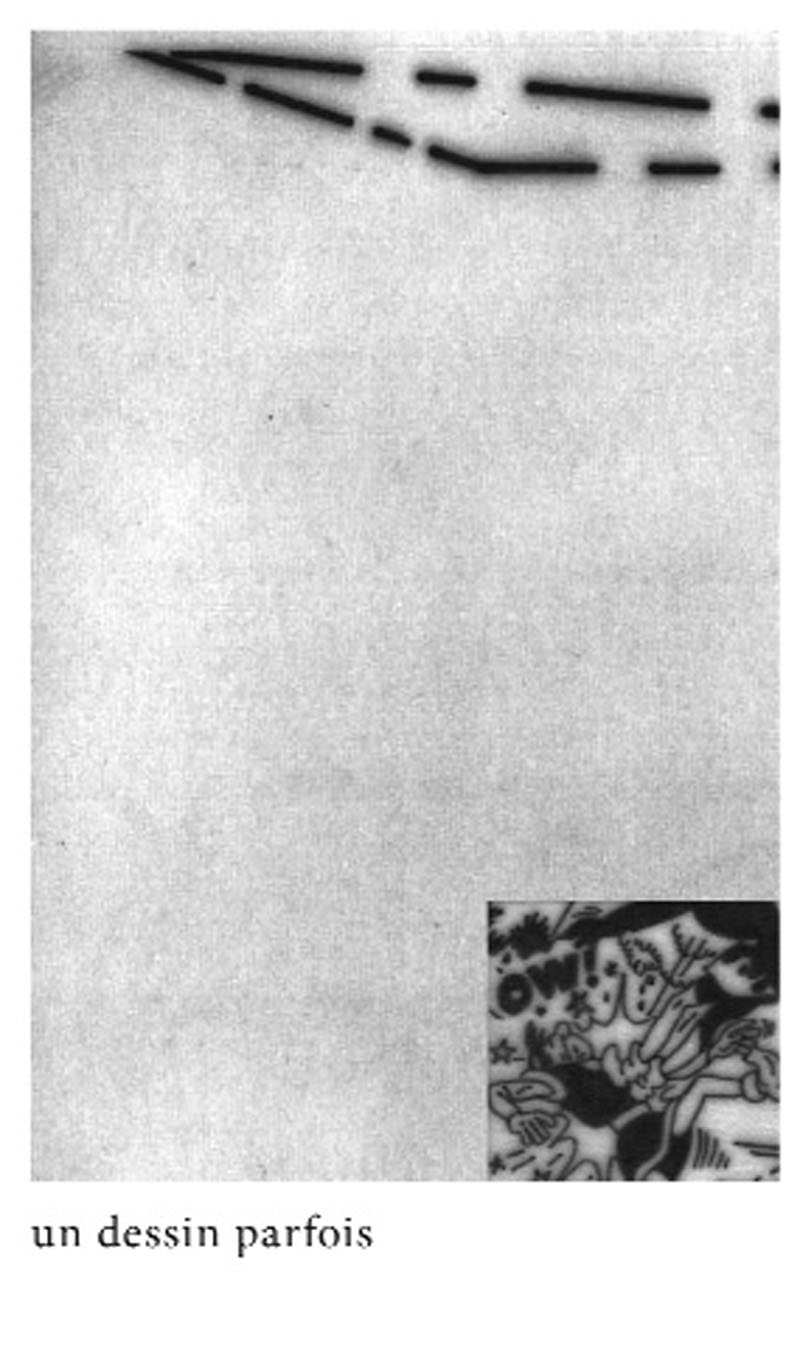
C’est pour tailler dedans qu’on cherche la texture d’une guerre, et les livres, ce sont d’abord des stratégies mobiles. Des combats est un livre de stratège deux fois, quand il reprend des vignettes de BD comme autant d’indices de sa trivialité pour la faire jouer contre elle-même, et parce qu’il est la guerre en acte de la lecture contre ses cribles : une longue-vue braquée sur la carte, six microscopes pour lire le texte, et l’œil au beau milieu qui désaccommode tout. Ce qui se lit dans la crase des textures, c’est le disparate de la guerre, ses dimensions entrelardées de mouvements à l’aveugle et de violence incorporée, toutes les esquisses compénétrées du choc et du feu. Le pólemos est poíkilos, la guerre est composite, c’est le Dépareillé et le Dépareillant. Ce livre de guerre est un perspectivisme fragmenté, et chaque page comme une même bataille vue par les yeux du soldat et de l’oiseau, Austerlitz que dix-mille Fabrice rateraient autant de fois. Lire Des combats, c’est d’abord un rapetissement en éclaté du regard, un rapetissement agrandissant, comme s’il fallait entrer dans la partiellité d’un événement pour sentir l’intégralité de ce qui le traverse, des armes et des affects, la mitraille et la brume, et c’est pourtant l’espace qui s’ouvre, en pointillés sur toutes ses diagonales.
On pense souvent la stratégie comme la continuation d’un ordre, mais c’est plutôt l’ordre devenu impossible et retourné contre lui-même au point de produire son dehors, c’est le clivage de la situation, son insituable double jeu (9). En déjouant l’historicisation présente du lisible, en le rendant à la polarité du déchiffrable et du syntagme, Largier déploie une stratégie de l’adventice, une stratégie de ce qui advient de sens malgré sa perpétuelle calcification. C’est tout l’enjeu des citations et des vignettes de BD pareillement tronquées, tranchées par les mêmes traits, cadrées au sabre clair : il s’agit de démettre la valeur d’établissement de la BD, et c’est la carte qui en permet la chute et la renaissance. On ne trace des cartes qu’en désédimentant, ce qui ne veut pas dire archéologiser : ces figures et ces mots qui montent à la surface sont le dépôt des images et du sens dans l’acception admise, codée, d’un regard ou d’une langue, se défaisant de leur statut en intégrant l’espace d’une guerre, autrement dit le sens, donné comme une parade ou une charge sans objet. Mais pour faire rebander les fossiles, il faudra faire revenir, comme des fantômes ou des oignons, le sens tout-fait dans ses torsions, ses diffractions, dans ses écarts surtout. Ce thème et cette pratique de l’écart sont omniprésents dans ces livres, à la fois comme écart de référencement (unités désindexées qui entrent en com-position), comme écart thématique (entre le littéral de la guerre et ses figures connotatives), et comme écart de procédés (la perpétuelle traversée répulsive du texte et de la carte, qui tendent à se rabattre sur le dispositif du commentaire ou de la légende). On fait toujours une carte contre les fossiles de la terre, contre les dépôts d’un fond primordial, on les espace, on fait craqueler les ambres, on entaille l’ancestralité. C’est parce qu’elles défossilisent que ces deux œuvres sont des livres de survol dont la composition repose sur des traces de strates (10), comme si d’un temps fossilisé, celui de la BD comme celui de la lecture, étaient remontés des figures fragmentées d’histoire et des plans de bataille depuis longtemps sédimentés en faits, devenus archives, fossiles de guerre, os de papier. Faire du document un fragment arraché à sa propre historicité et l’unité nouvelle d’une carte à tracer, c’est désenfouir le sens pour en refaire une vie possible, autrement dit la guerre (11). La carte dans Des combats est un stratagramme actif, trace de strate et tracer de stratégie, un plan de bataille vibrant dont les lignes ne montrent pas un réseau de mouvements mais produisent un emmêlement de durées dessinant un dédale ouvert, un dédale fait présents où cohabitent des narrations inchoatives, de nouvelles Histoires à l’état naissant. Si les lignes filent et s’involuent, si les lignes d’erre guerrières (12) coupent et discontinuent en étoilant le dédale, c’est que la carte échappe à ses mouvements en même temps qu’à sa fiction (13), c’est qu’elle est muette à force d’errance, erratique à force de mutisme, c’est que la carte est un peu autiste.
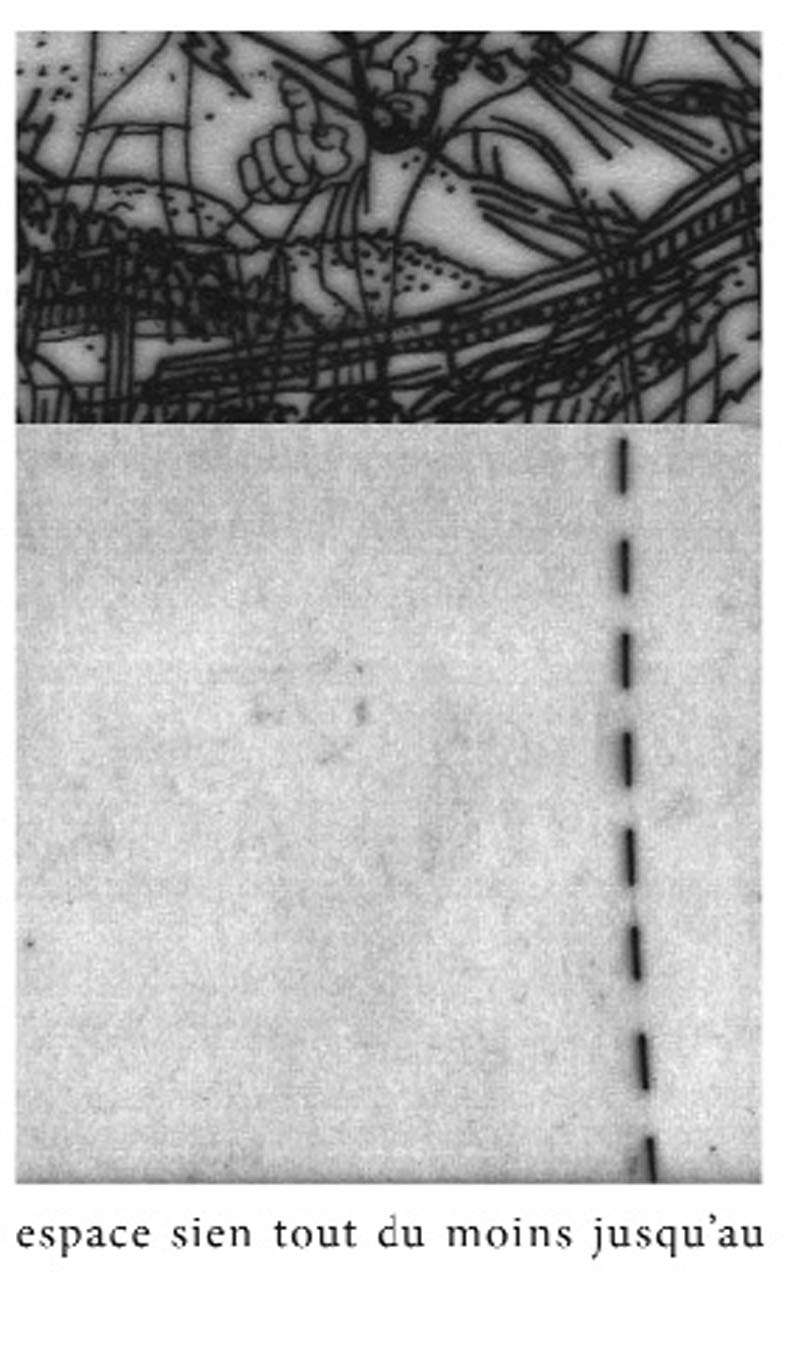
Car la carte a ceci de particulier qu’elle constitue dans l’univers des dénotants une fonction d’insaturation : si elle peut s’ouvrir et n’être qu’ouverture, c’est qu’elle n’est jamais que quasi-dénotative (14). Il y a pourtant toujours le risque de reformer des saturations en elle quand on la soumet à encadastrage, et la grande polarité qui travaille la terre n’est pas celle de la carte et du territoire (15) mais celle du cadastre et de la carte. Le cadastre axe les sens de la carte en y établissant un ordre cardinal, un partage du sensible qui ne fait redondance de la terre qu’en la sursignifiant comme telle : le cadastre n’est pas un système d’organisation, c’est le système de l’organisation (16). Et en même temps, il fait entrer la carte dans le régime du représentable, il la dénote, quand elle ne fait que quasi-dénoter la terre dont on l’inscrit (17). Le cadastre fait la guerre aux cartes. Il nous resocialise l’autisme. Des combats réintègre du cadastral dans le cartographique pour mieux l’y déborder, le retrancher dans et de la carte : les strips de BD qui s’y surimposent sont non seulement la trace d’une imagerie-fossile (la BD comme historicité), mais c’est surtout, dans ce qu’ils supposent de geste dépris, le symptôme d’un schème cadastral à l’œuvre dans tout geste de traçage et tout calquage mobile. Là où ce livre fait BD, ça n’est pas dans la destruction citative qu’il met en œuvre mais dans ce désordonnancement de cadastre qui, par fragments réagencés, redonne minimalement des unités de bande, un grand tracé mobile qui veine la page sans axes et polarise des cases selon des contours flous, des cadres tronqués, mille histoires avortées. C’est un long et tranquille désaxe. Tout est comme à l’aveugle, pourtant tout fait voyance. L’idée de BD qui travaille ces pages, c’est d’en faire un espace composite non gradué, dont chaque découpe possible serait une contre-nature du cadre et pourrait s’élever à la teneur substantielle d’une portion de sens, d’une zone graph-sématique qui serait case, page, carte dans la page et re-page dans la carte. C’est une combinatoire de plans quelconques mais déterminés, agencés par écarts en surface de glissements, selon un double mouvement d’approfondissement sans réduction et d’écartement sans agrandissement : la profondeur n’y est pas niée mais sans cesse éludée. La profondeur que le cadastre met sur et sous la carte, c’est l’Histoire comme grand Index. Et en décadastrant, on désindexe l’Histoire, on désindexe l’indexateur, autre manière de dire le Jeu en tant que tel. C’est une BD jouée, au bord de son évanouissement, ou plutôt c’est l’évanouissement de la BD fixé sur le papier et se rejouant sans cesse sans lui-même s’évanouir, un vertige épinglé sur son propre baptême. Quelle stratégie pour tout carter ? Transformer les cadastres en puzzle et rabouter des pans d’ordonnancement péris.
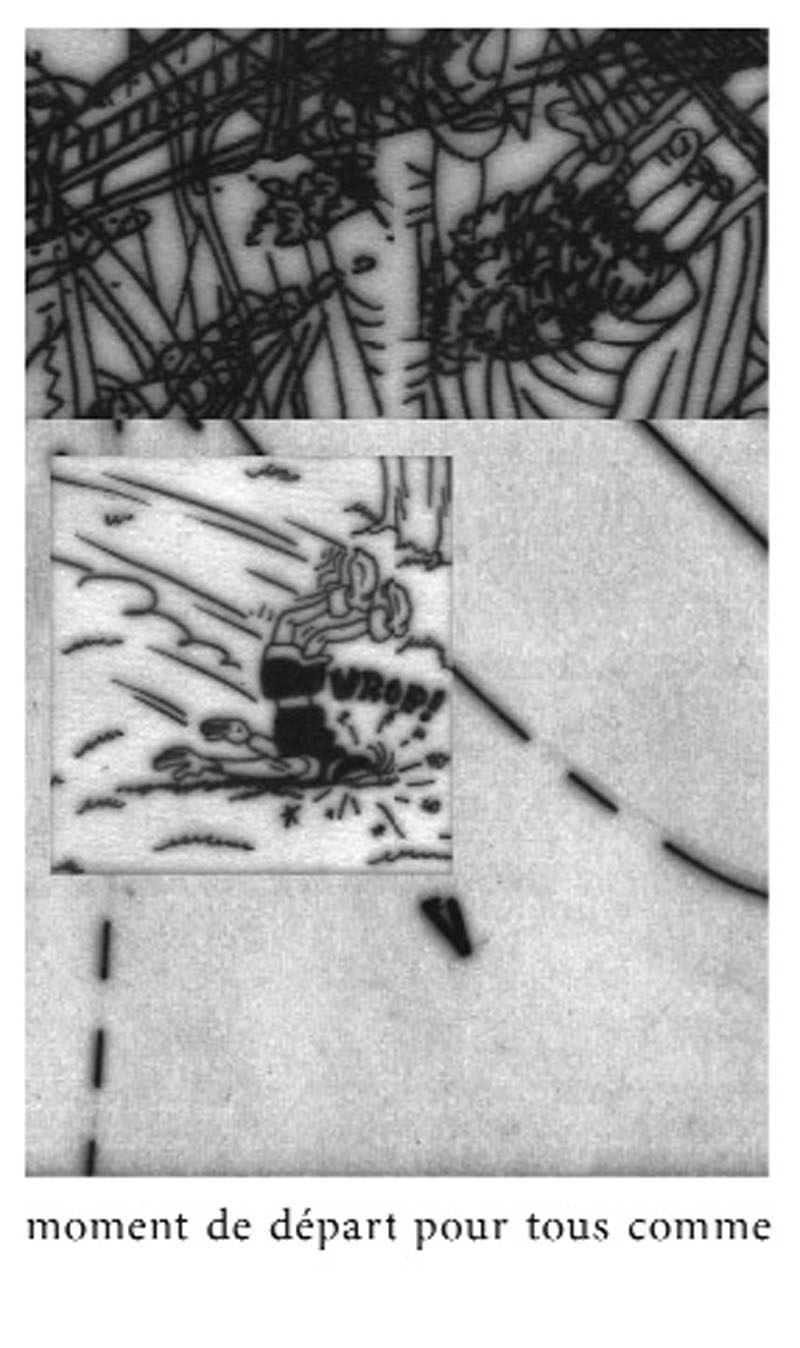
Alors qu’est-ce que le livre ici ? C’est pourtant l’infrangible, c’est encore du cadastre réduit à s’exhiber dans tout son arbitraire. Le texte haché, les mots coupés et strips tronqués montrent littéralement le geste décisoire discrétisant toute unité graphique ou textuelle, mais ce geste reste ici absent ou plutôt congédié : couper cartes et textes n’est pas un nouvel acte de cadastrage parce que la coupe est quelconque, que ses unités mêmes le sont tout en restant particularisées, parce que le cadastre est conjuré au profit d’un non-choix supérieur, d’une noluntas, une nolonté qui tranche mais qui ne choisit pas. Cette construction par désassemblage est une sorte de collagisme en braille, de cut-up mécanique ou de zen qui couperait, cut-toil, toil-up. Le texte n’a en droit pas plus de début de fin ou de structure phrastique que la carte n’a de bord, tout file et s’invagine en deux indéfinis. Les planches de Largier (notamment dans la revue 1.25) peuvent être vues comme des livres d’une page, ou des livres potentiels avalés dans l’unicité d’une carte qui ne serait elle-même qu’une vaste page et fragment d’un plus grand ensemble, carte et page à la fois.
Le cadastre fait plus simple : il décrète la limite d’un dernier ensemble, et rend ses éléments visibles pour y ensevelir la carte, pour faire que le visible cèle l’invoyable. Mais un cadastre ne naît pas seul. L’encadastrage est une opération étatique, et l’État est à chaque niveau de la vie un grand Encadastreur, omniprésent mais acentré (18). L’État n’est pas une forme ou une structure, c’est d’abord une puissance de schématisation génétique et inengendrée, et c’est le schématisme incorporé qui permet de parler d’étatisme du livre, de l’art ou du sujet, quand bien même ils naîtraient dans la plus grande des marginalités ou la plus lointaine sauvagerie. Il y a un étatisme du livre, comme il y a des sujets qui ne sont que de l’État vivant, non pas des hommes d’État, mais bien l’État fait homme ou, pour mieux dire, de l’État incarné. La guerre aussi s’est étatisée quand elle est devenue la conjonction du territoire, de la population et de la production (19) ; l’étatisme de la BD lui est homologue, c’est la conjonction du territoire (espace graphique), de la population (fiction incarnée comme personnage), et de la production (culture du sens et croissance de la dénotation), opérée au profit d’une économie rectrice de la signifiance. Quand la BD n’est plus que ce co-ordonnancement de procédés composites indexés sur la même économie de signifiance, quand texte dessin et personnages ne sont que des variables hypostasiées d’un même segment énonciatif invariable de nature, quand le graphique, le textuel et les figures se rabattent uniment sur la même dénotation, sur le même énoncé fonctionnel dont le dessin et le texte ne sont qu’une incarnation traductrice, alors c’est un petit État qui naît, qui coordonne, régit, assermente tous les procédés du sens pour en faire de la signification unitaire et saturée. C’est un étatisme du vrai et de l’identification perpétuelle, qui subsume l’adventice du sens à cet unique mot d’ordre qu’est le réalisme de la signifiance, ou la fiction comme pure valeur de communication. Alors les personnages font redondance du texte et le texte du dessin, et tout réciproquement pour boucler l’énoncé réaliste du fictif. On peut distinguer trois sortes de fictions : celle dont l’énoncé est réaliste, celle dont l’énoncé est fictionnel, celle qui n’a pas d’énoncé. La première est celle de l’État (réalisme et énoncé), la seconde celle du mythe (onirisme et lignage), la troisième est poïétique (désaxe et carte) (20).

C’est cette fiction qui se déploie ici : en é-cartant les cadastres, Des combats éconduit cet étatisme et opère la disjonction des procédés de la BD, qui ne font plus conjonction mais s’incorporent les uns aux autre pour faire naître un entre-sens : le livre disjoint l’espace et ce qui le peuple (territoire et population), pour que naisse sur cette disjonction tout un système de productions anarchiques (agriculture et production), qui font aussi bien ligne que personnage, aussi bien trait que lieu. Si c’est un livre de stratégie, c’est qu’il fait la guerre à sa propre étatisation et substitue au programme frontal d’une guerre contre l’État un combat pour la désétatisation de la vie.
Cette stratégie de l’adventice se couple à une tactique d’impropriation. La disjonction des trois dimensions que l’État coordonne pose en effet un problème pratique : quelles formes reste-t-il à voir, comment les assigner ? La táxis grecque désigne à la fois l’ordre taxinomique et la tactique comme ordre de bataille : toute táxis est tactique, toute tactique est un classement mobile. Elle ne s’affronte pas à la limite de l’Ordre et de son dehors (stratégie), mais à sa combinatoire interne. Si Largier pratique une tactique d’impropriation, c’est qu’il dissout les assignations catégorielles et sensibles, rend texte et dessin impropres à leur régime, à toute indexation statutaire ou esthétique, les rend impropres à eux-mêmes et à toute schématisation. Il ne s’agit plus dès lors d’opposer terme à terme, de façon frontale et discrétisée (frontale car discrétisée), deux formes ambivalentes mais de mêler des unités virtuelles formables (21). La tactique d’impropriation, ce n’est pas d’opposer une forme à une forme qui s’y réciproquerait, mais contrapposer à la forme une procédure du formable, c’est une esthétique des formabilités qui combat avant tout les historicités de la forme (22). Ce régime graphique est une anacoluthe généralisée quand c’est de la rupture même des formes que celles-ci s’initient et que les pages sont des interstices, des stases d’écartement, une oblation de la forme pour le formable même (23). C’est pourquoi la guerre se fait économie des mouvements virtuels placée sous le critère du proche et du lointain (24) : le problème de Des combats, c’est de révolutionner les ordres sans en passer par un séquençage linéaire de leurs termes. Largier pratique à la fois une économie du proximum, du plus-proche, dans ce qu’il instaure de rapports entre lieux graphiques, et en même temps opère une distension des référents narratifs, ce qu’on pourrait appeler un écart remotum. Abolir la naturalité de la narration implique ainsi un travail sur les rapports, en instaurant un écart maximal entre entités narratives et en liant des états narratifs, non plus de l’intérieur par une affinité de thème mais en surface par la cartographie. Ce sera la ligne qui opérera la mise en rapport du narratif et du spatial en jouant sur l’ambiguïté du vertical et du plat : la ligne de Largier est à la lettre une ligne de communication, une ligne communicante qui connecte des ordres et des régimes différents, la stratégie et la tactique, le cartographique et le cadastral, le dressement des figures et l’à-plat du territoire (25) ; ainsi des lignes courbes emportent un crâne dans une boucle ogivale de pensées indécises mais dessinent en même temps, vues à plat et plus en portrait, des mouvements de rebroussement tactique, ou bien un tir d’archer se prolonge en écheveau de lignes qui sont à la fois le trajet chaotique d’une flèche et des mouvements virtuels de troupes (26). C’est une cartographie du direct et de l’indirect (27), qui repose sur un procédé de divisions et de regroupements (28) lisible à chaque page mais aussi dans leur combinaison à l’échelle du livre. Ce qu’il s’agit de faire alors, c’est la balance des forces, la confrontation cartographique des formabilités virtuelles (29). Cette confrontation s’opérera par calquage. Le calque est un opérateur d’écart dans toutes les directions, il rapproche et mêle jusqu’à la confusion, ou fait saillir en un même lieu graphique une distance incomblable entre deux plans pourtant superposés ; on atteint dans le premier cas à un noir vibratile, haché comme un chaos qui s’amalgame d’une multiplicité d’images, et dans le deuxième à une transparence mince entre deux feuilletages d’histoire qui demeurent étrangers l’un à l’autre (30). Toujours le sens advient dans l’interstice, interstice plat des lignes chevauchées ou interstice dressé de deux calques qui se repoussent. Mais le calque a aussi une troisième portée euristique quand il se branche directement sur les lignes qui le traversent ou le prolongent dans l’espace nu de la carte, et qu’il est à la fois figure frontale d’une fiction possible et dérive aplatie de cette fiction réduite au mouvement d’une ligne (31). Chaque face et personnage levés sont le fragment d’une multitude qui grouille dans les tracés abstraits d’une danse stratégique, un archer isolé
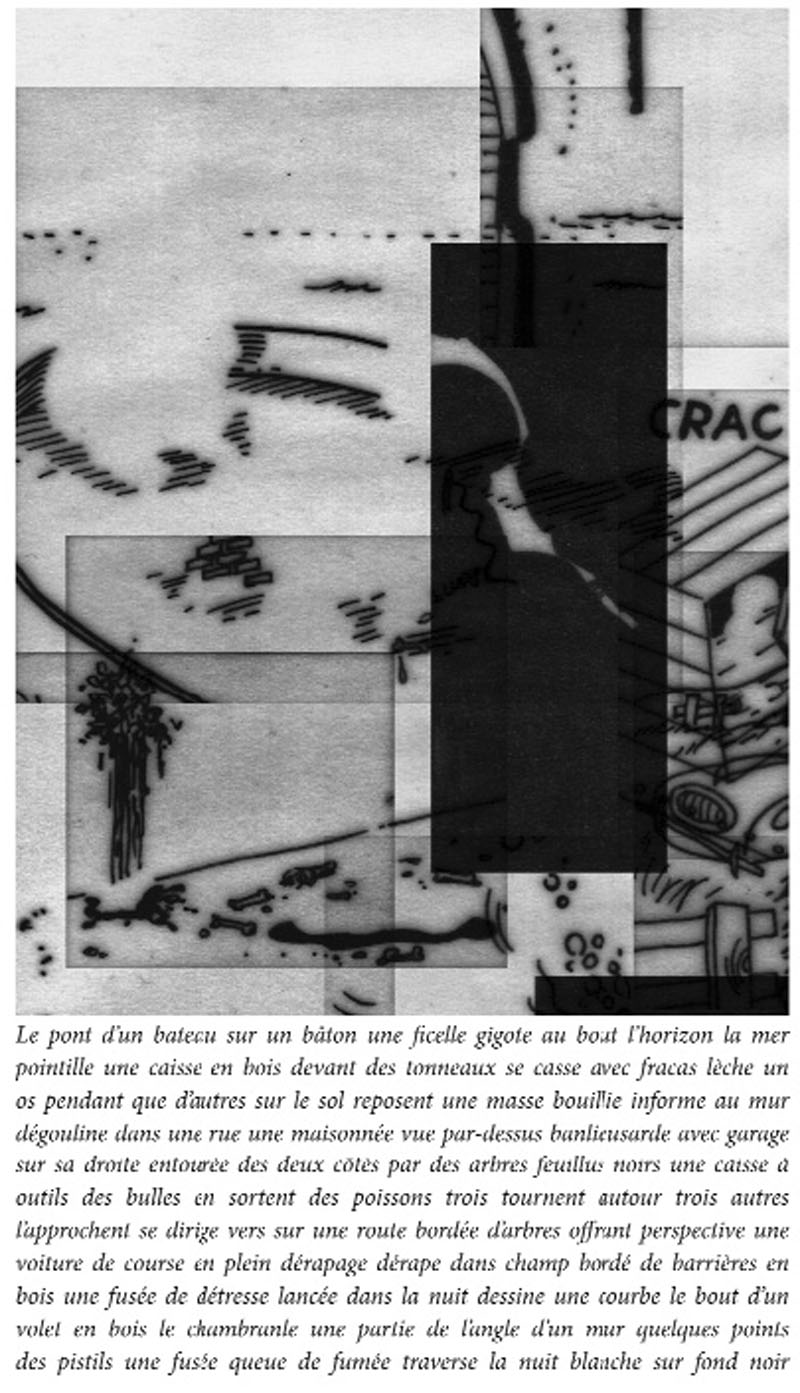
dans une ligne courbe qu’on imagine peuplée, un chevalier qui charge dans un canevas noir électrique d’angles et de pointillés qu’on sait être, vus du sol, des hussards au galop et des troupes qui se débandent. Ces calques sont un zoom sur une portion quelconque des lignes de la carte, y révélant une guerre en cours figée comme une bobine mais qui se dresse comme un tableau. Nous sommes à la fois devant l’écran et au-dessus d’une carte d’état-major. Cette calquographie ressortit moins au collage qu’à un montage par cut-up ou cut-toil à plusieurs dimensions : on fait des collections d’images, et de ces collections une méta-collection. Tout le contraire d’une archive et tout l’envers d’une sélection : noluntas.
Ce cut-up, c’est celui du cliché : c’est dans l’acception sociale la plus tristement bête de la BD que Largier va traquer ses vignettes enfantines à l’excès, ses batailles de papier, sa guerre de salle de jeu. Stratégie encore : produire de l’exceptionnel avec l’acceptionnel, ne pas mettre sous la lame une BD infantile mais l’infantilisme de la BD. S’il s’agit de jouer comme un enfant, c’est en coupant pour infanter, c’est en calquant pour enfancer, pour que l’infans ne désigne plus le mutique mais l’infanterie, le polémisateur, le petit pioupiou du pólemos. Soumettre le cliché à sa propre transparence, c’est opacifier sa dénotation d’usage, neutraliser la bêtise en l’enfouissant sous ses figures, en le surcalquant. Le calque n’existe alors pas seul mais fait toujours partie d’une multiplicité m de calques dont il est le +1, l’excédant : c’est le surcalquage qui fait le calque, pas l’inverse (32). Ce feuilletage excessif des calques produit un filtre négatif, qui n’agit pas en sélectionnant la matière raréfiée du graphe ou une figure nue purifiée de ses clichés, mais en accumulant le pire, en l’engraissant, en massant le cliché sur lui-même jusqu’à ce que, de son opacification noirâtre et comme murée, monte le sens altéré du poncif à l’excès, sens toujours adventice et jamais programmé, et dont la production aléatoire s’oppose à l’ordre même de la bêtise et du stéréotype.

Ce surcalquage a tout à voir avec la carte — il est la carte même comme processus et pas comme produit, car l’empilement gestuel des calques se résout en un plan sans épaisseur, totalement effeuilleté : ce n’est pas qu’on l’ait effeuillé strate par strate, c’est qu’on a supprimé de lui la forme même du feuilletage (33). C’est un calque flaubertien quand, à force de multiplier les clichés par eux-mêmes et de les surcalquer en une masse amorphe de vie déjà toute-faite, advient une sorte d’arasement par le nul, une tabula rasa sur laquelle jeter les dés du sens. Deux autre opérations calquographiques produisent cette nullification du cliché : décalquer les contours formels d’un poncif figural en produisant littéralement une abstraction (34), ou mélanger ses traits expressifs, faire crase de ses déterminations jusqu’à l’altérer dans son régime même (35). Trois conjurations pratiques du cliché : le surcalquer sur lui-même, l’abstraire de lui-même, mélanger ses déterminations. C’est donc la gravité des historicités figées que le calque rejoue, en les intégrant à un syntagme qui les déborde et les symptomatise, et si Largier calque des strips de guerre ou d’aventure, des poncifs vignettés comme une sorte d’Uccello de bistrot passé au crible des comics, ce n’est ni dans une optique citationnelle ni dans un simple geste d’irrévérence iconoclaste ; ce que ce livre nous montre, c’est l’écart infini de la représentation et du sens (36). Car à la fin, quand la carte a décorporé son cadastre par surcalquage abstraction ou crase, on retrouve la bande et son ambivalence. Il y aurait deux sortes de BD : celle dont la bande est d’emblée de représentation, représentale plutôt que représentative, dotée d’une intériorité qui fait le littéral, visant une extériorité qui constitue formellement le figural, et déictiquement le figuratif. C’est la BD qui met de l’intériorité partout, dans le sujet le dessin le signe, et qui les met en parallèle avec une extériorité, personnage à décrire, réel à montrer, signifié à vouloir-dire (37). C’est la BD acceptionnelle, une bande pré-dessinée ou endographe que la représentation a doublement tracée, en tant qu’elle-même d’abord, à sa surface ensuite. C’est, deux fois et d’emblée, la bande comme pure surface d’inscription (38). À l’opposé et pourtant tout contre, il y a la bande dessinante où le tracé est le traçant et la trace en même temps, où ne se donne à sentir que du tracer partitif ou graphein inconditionnel ; c’est la bande en elle-même telle qu’elle n’a pas d’elle-même, pas de fond ni de constitution, désindexée de tout schème oppositionnel de l’extérieur et de l’intérieur, du dessiné et du dessinant. Ce n’est pas en niant la représentation mais en passant dessous (39), par un étrange constructivisme soustractif, que la bande se rend dessinante, lorsqu’elle décorpore ses schèmes (cadastre) pour capter (calque) ce qui la parcourt (carte), plutôt que pour exprimer le réel le montrable le dicible et leurs envers spiritualistes, l’absolu, l’immontrable, l’indicible. Chez Largier, le calque est contraction du réel, la carte soustraction au montrable (c’est son usage indéictique), et la bande abstraction du dicible. La page alors, c’est la crase de la carte du calque et de la bande plutôt que leur synthèse, c’est une variation dynamique et une page n’est pas une page n’est pas une page n’est pas une page. C’est une héautoscopie (40) spatiale dont le livre n’est que la fermeture nécessaire parce qu’insuffisante, quand la première et l’ultime page sont un dialogue invaginé qui n’est plus du temps mais de l’espace, « un dessin parfois / d’une bataille (41) », comme si le reste du livre, son cœur étale, n’en était que le dépli, comme si le livre ne tenait que dans l’usage parodique de sa désignation.

Il y a toujours une syntaxe avant que l’ennemi n’arrive (42). Hugo décrivait dans Les Misérables comme le W de Waterloo avait précisément la forme de son champ de bataille ; imaginons une guerre qui ait son nom pour forme — tout son mouvement ne serait rien d’autre que son épellation. Qui saurait donc la proférer ? Les victorieux sont sans grammaire et les victoires sont aphasiques. C’est en polémisant qu’on défait les syntaxes plutôt que ceux qui les parlent, en faisant le faire de la guerre, contre les fondations et les constitutions, toutes sortes de constitutions. Dans le mythe fondateur de Thèbes, Cadmos tua un dragon dont il sema les dents sur les conseils d’Athéna ; de ces dents germèrent des soldats armés qui devinrent les premiers Thébains et fondèrent un mythe plus profond que l’autochtonie, le mythe de l’inscription et de sa surface. Il y a bien sûr une terre où l’on ne sème plus rien, rasa sans tabula, mais y tracer c’est la tracer, et quel espace la contiendrait, serait-elle même un espace ? On ne fait pas la carte du désert sans faire le désert. Si le dragon avait tué Cadmos et Athéna puis en avait planté les dents, rien n’eût été changé, un alphabet aurait germé pour faire de la carte une grammaire. La terre, elle, ne sème pas, elle crache ses morts, ils sont fossiles ou bien guerriers, ils viennent de déserter.
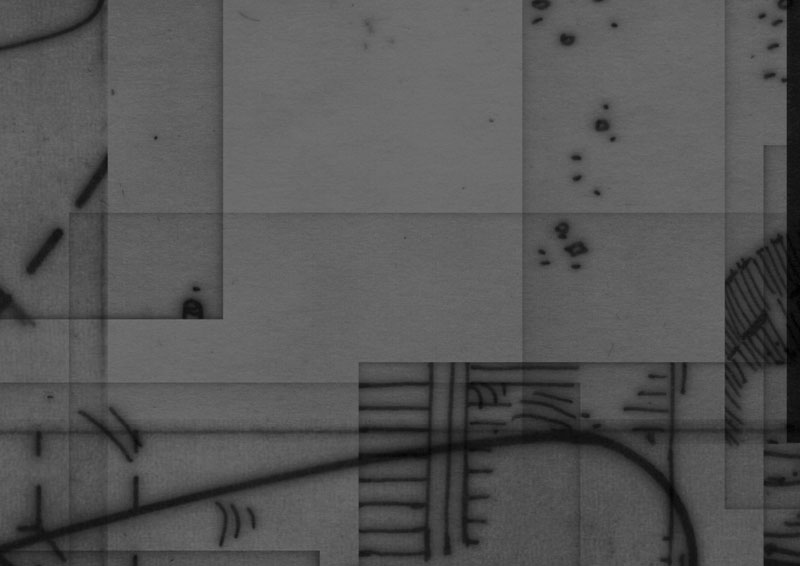
Notes