

De quoi l'icône est-elle le signe ?
par Jean-François SAVANG
« Jonathan Culler dismisses the icon as « more properly the concern of a philosophical theory of representation than of a linguistically based semiology ». » (1)
Les enjeux de l’icône et de l’image tiennent une place déterminante dans les discussions théoriques concernant les rapports entre bande dessinée et langage. Interrogeant le statut du langage à partir du dessin, la bande dessinée permettrait de questionner la problématique des signifiances visuelles — la capacité d’action d’une image : l’image étant d’abord productrice et transformatrice de sens avant d’être simplement l’interprétable d’une représentation donnée. Contre l’idée qu’on pourrait accéder directement au monde, qu’il ne saurait y avoir de perception ou d’expérience du monde sans activité du langage, se pose alors la question de la manière dont l’image suscite le langage, la manière dont elle l’assimile et le transforme pour signifier à son tour. L’image en bande dessinée, toujoursdéjà signifiante pour être reconnue comme image-dessin, stimulerait la perception dans une organisation du sens qui n’existe pas ailleurs et ferait l’aventure de cet inédit de la pensée selon une énonciation qui lui serait propre.
Cette fois-ci, nous porterons une attention particulière à la notion de « ressemblance » et aux ramifications problématiques du rapport entre image et langage. Avec la notion de ressemblance, nous sollicitons non seulement l’identité du monde à une représentation, mais nous faisons fonctionner un système de pensée au sein duquel l’icône occupe historiquement une place stratégique. La notion d’icône renvoie évidemment à la théorie générale de l’image : elle suppose un schématisme de l’image, une réduction du sens à la puissance évocatrice de l’image. L’icône est liée à la question de la ressemblance et donc à l’idée d’une équivalence de la réalité dans le monde symbolique. La notion d’icône, notamment, a maintes fois servi de passerelle problématique entre la bande dessinée et la sémiotique. Elle est, souvenons-nous, un pilier de la démonstration sémiotiste et cognitiviste chez Scott McCloud distinguant entre les mots (icône non-figurative) et les images (icône figurative).
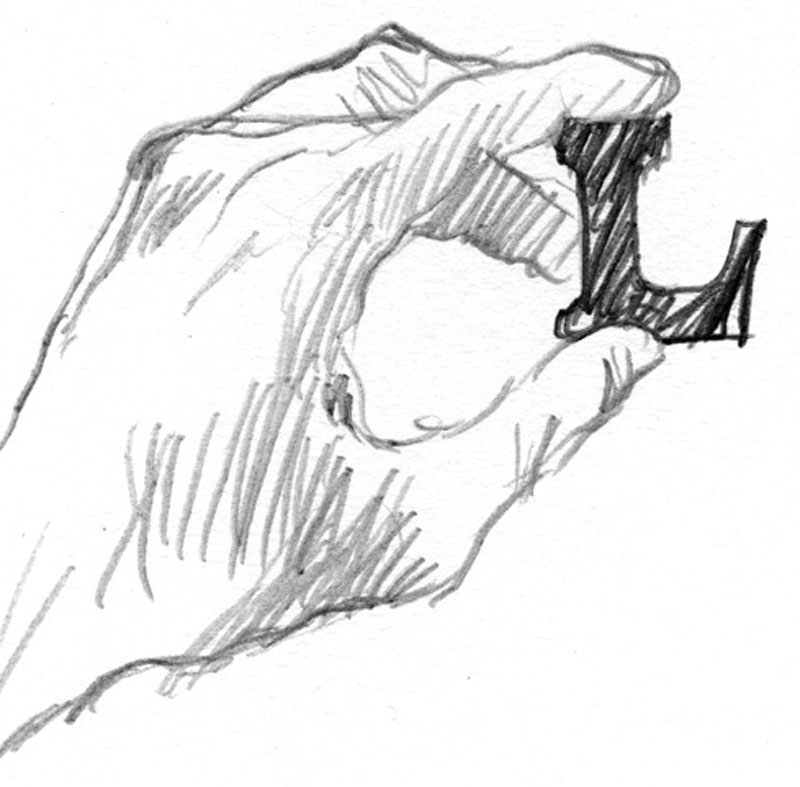
Mimèsis et vérité
Dans le Sophiste de Platon, icône et phantasme constituent deux manières distinctes de produire des simulacres et sont donnés par Platon comme des divisions de l’idole : « Le Sophiste, après avoir assimilé l’art de fabriquer des images à la mimétique, subdivise cette dernière en deux sections : l’art de la copie et l’art du simulacre (Soph. 235 b- 236 c) (2). L’icône est la forme d’imitation qui correspond à la copie. Elle renvoie à l’art de la copie. L’icône ressemble à l’objet qu’elle représente, à la différence du phantasme — du fantôme — qui lui n’a que l’apparence de la ressemblance et ne formerait que la production d’une illusion. La ressemblance iconique serait en fait la condition qui donne accès à la référence, tandis que le phantasme aurait moins la réalité pour référence que la manière du sujet d’inventer des représentations sans référence apriorique dans le monde réel. L’icône serait ainsi fondée à restituer une identité existante du monde réel dans le monde symbolique à la différence du phantasme qui jouerait lui de l’illusion du réel. Dans cet ordre, le modèle — opposé à la copie — jouirait d’une capacité supérieure de vérité et donc de représentation. C’est en effet au nom d’une condition préalable que la copie est une forme dégradée du modèle : c’est parce que la ressemblance est instituée, du point de vue de la métaphysique chrétienne, à partir de l’identité perdue de l’homme dans la figure divine. La ressemblance, en ce sens, n’est pas la simple conséquence d’un rapport entre une image et le réel : elle engage le monde comme représentation dans son ensemble et interroge l’équilibre entre le réel et sa possibilité, le rapport entre image et vérité. Jean-Marie Pontévia fait remarquer fort justement que c’est dans le cadre du rapport à la vérité que Platon argumente le dialogue sur la mimèsis : « Platon pose d’emblée le problème de la peinture dans sa relation à la vérité (Rép. X, 596 d 597 a)(3). C’est donc l’ensemble de la mimèsis platonicienne, de la poésie à la peinture en passant par l’artisan, qui est en jeu et qui constitue une forme dégradée de la vérité. La peinture pour Platon est illusion et mensonge. Comme Meschonnic parle du poème comme « contre-cohérence », la peinture poursuit Pontévia, supposerait une critique de la raison, « un autre langage »(4) et ressortirait ainsi à d’autres enjeux que ceux de la vérité ou du réel. Qu’il s’agisse d’eidolon, d’eikon ou de phantasma, de même que le poète, l’image reste suspecte par rapport à la notion de vérité.
Gilles Deleuze met également en évidence cet aspect systémique de la notion de ressemblance et la situation qu’elle constitue d’un plan d’énonciation plutôt que d’une réalité brute, considérant que ce n’est pas l’opposition entre l’original et l’image qui est déterminante mais le rapport entre les deux sortes d’images, entre icône et phantasme. La notion de modèle aurait alors principalement la valeur d’une référence normative à la vérité :
« La distinction modèle-copie n’est là que pour fonder et appliquer la distinction copie-simulacre ; car les copies sont justifiées, sauvées, sélectionnées au nom de l’identité du modèle, et grâce à leur ressemblance intérieure avec ce modèle idéel. La notion de modèle n’intervient pas pour s’opposer au monde des images dans son ensemble, mais pour sélectionner les bonnes images, celles qui ressemblent de l’intérieur, les icônes, et éliminer les mauvaises, les simulacres. » (5)
Autrement dit, dans ce qu’elle restitue de la réalité, l’icône montre aussi quelque chose de la manière qui la constitue : elle montre aussi, par son fonctionnement, une éthique du système et une conception particulière de la réalité. Ainsi y a-t-il dans le travail iconique non seulement la marque d’une reproduction normative du réel, mais également la marque d’une méthode et d’une culture de la lecture du monde. C’est bien ce qu’elle n’est pas en termes de réalité et ce qu’elle est en tant que manière de représenter qui fait l’icône. Cependant dans la mimèsis platonicienne l’image ne fait pas vaciller le réel. C’est son degré par rapport à la vérité qui la réalise moralement en tant que telle; c’est la condition de vérité et ce qu’elle soustend d’un point de vue métaphysique qui organise le dialogue platonicien de la mimèsis : « il est clairement dit dans le Timée que le monde d’ici-bas aurait été fait le plus ressemblant possible au monde éternel « à travers la mimèsis de l’immuable nature » (6). Aussi ne peut-on pas aborder la notion d’icône sans considérer la dimension métaphysique qui en détermine le fonctionnement, sans supposer que le modèle idéal porté par la ressemblance institue le rapprochement du politique et du théologique. Le principe de la ressemblance iconique instituerait le monde, contre le langage, dans l’ordre de l’identité perdue : l’irreprésentable serait l’origine absente du fonctionnement du voir, l’institution d’une théologie du sens qui nous pénétrerait directement sans langage.

« Qui n’a pas vu Dieu n’a rien vu » Maurice Roche
Il y aurait ainsi une discipline du « voir » inféodant le langage qui tiendrait toutes les autres disciplines en ordre de bataille. Je veux dire par là — et c’est le sens de ma réflexion avec la bande dessinée — que tout se tient : l’eidétique de la phénoménologie propose l’essence de la pensée dans l’ordre du voir ; à la ressemblance iconique du signe correspond le mythe d’une ontologie du réel. Faire du langage un simple dispositif de la communication entretient, dans une même logique, phénoménologie, ontologie et théologie. Et je suppose, étant moi-même pris dans cette situation critique, que nous pouvons tourner longtemps, de cette manière, dans l’ordre de la pensée. J’ai à l’esprit la même ritournelle concernant l’observation sociologique des représentations, le même air dans les motivations cognitivistes ou psychologiques ; le « langage visuel » de Neil Cohn me semble attaché à ce déterminisme du signe, aux flottements du langage et du graphique. Même la notion de « théorie » qui fait souvent l’impensé de mon propre discours me met au garde-à-vous de l’image : « Théôrein, cela veut dire en grec être au spectacle, être au théâtre. Le mot vient d’ailleurs de la même racine : le théâtre est l’endroit où l’on ne fait que regarder sans intervenir, et on rit du naïf qui avertit le gentil quand le traître arrive »(7). L’esthétique avec la rhétorique n’échappent pas à cet enchaînement disciplinaire dominé par la vision. La rhétorique tient autant à la beauté des images qu’à celle du langage. Elle est une esthétique du langage. Elle tourne souvent à vide produisant plus de paysage que de sens : c’est l’esthétique du camelot sur les marchés. Autrement dit, il y aurait dans le «voir», quelque chose d’inéluctable, une sorte d’anus solaire, mou et sans os, refusant de perdre sa chair. Le « voir » serait abstraction, perte du corps.
Mon opinion ici est taraudée par la question de ce qui fait corps dans le langage et peut-être aussi du tri nécessaire entre histoire et nature; jusqu’où « voir » est-il naturel? Le signe comme théorie du sens institue la réalité dans le miroir des discours historiques. La remarque d’Umberto Eco à l’égard de l’iconisme de Peirce met en évidence ce caractère idéologique et culturel de la « vision »:
« Pourquoi Peirce l’appellet-il [le signe] icône,
ou ressemblance (Likeness), et pourquoi dit-il qu’il a la nature
d’une idée? Il me semble que cela est dû à la tradition
gréco-occidentale au sein de laquelle il évolue, une tradition
dans laquelle la connaissance se fait toujours à travers la vision. Si
Peirce avait été formé dans la culture juive, il aurait
sans doute parlé d’un son ou d’une voix. » (8)
Le statut signifiant de la bande dessinée, dans nombre des discours théoriques qui s’y collent, reproduit en fait la séparation pseudo-originaire de la lettre et de l’esprit. La malédiction de la chair soustrait ainsi, pour des siècles d’ontologie et de métaphysique, le corps à la pensée; faire du corps le tombeau de la pensée. Le corps absent du langage détermine ainsi, religieusement, une logique de compensation du monde dans l’imaginaire du signe pour le sens. C’est ce que nous voulons montrer : le signe n’est pas le langage; l’icône n’est pas la reproduction de la réalité. Le signe est le produit d’une métaphysique du sens. La ressemblance induit l’identité perdue de l’homme avec le réel, là où l’anthropologique dans sa méthode est l’invention même de la vie sociale.
L’art et la littérature, à cet égard, vont perpétuer une forme d’eucharistie sociale, un reflet, une insufflation, un travail de ressemblance, et dans la ressemblance. Dans un monde où l’illusion littéraliste du réel laisse entendre la raison descriptive comme l’interprétation normative de toute poétique, il n’est pas étonnant que d’un côté nous ayons les œuvres et de l’autre, les glossateurs de leur raison. Et ce sont les glossateurs qui sont les conseillers du Prince, là où artistes et poètes ne font que chanter sa gloire et le divertir. Les guerres encore actuelles de l’iconoclastie religieuse sont révélatrices des fonctionnements culturels et sociaux : des enjeux politiques et idéologiques du langage et de l’image.
Peut-être la structure fatale du signe institué dans la logique de la ressemblance joue-t-elle un rôle dans cette errance du religieux ; croyant-voir Dieu là où il n’y a qu’anthropologie de l’organisation du sens. Il y a un mythe théologique de l’irreprésentable, un imaginaire de la ressemblance comme forme dégradée de la « pureté de l’être». Être introuvable et perdu. Il y a un essentialisme intrinsèque à l’activité de ressemblance, une responsabilité morale dans l’organisation même du sens et de notre rapport à l’image. Le fonctionnement iconique suggère un double principe que nous décrit ici Georges Didi-Huberman en termes de «structure de mythe » :
« Dans le premier grand récit mythique judéo-chrétien, nous trouvons la ressemblance posée dès le départ non pas comme une relation naturelle ou immanente — encore moins familière —, mais bien comme une relation surnaturelle, transcendante, métaphysique, redoutable en un sens : c’est la relation de l’homme à son Dieu. Dieu, dans le récit de la Genèse, crée en effet l’homme ad imaginem et similitudinem suam (1, 27)... Mais nulle part il ne sera dit que Caïn, par exemple, « ressemblait » à son père Adam, et encore moins qu’il « ressemblait » à son frère Abel. » (9)
N’étant pas naturelle, la «ressemblance» balance alors entre l’anthropologique et le divin, entre l’image et le modèle. En même temps, la question de la ressemblance est posée d’emblée comme relation asymétrique entre l’homme et Dieu. Elle est posée en soi comme un principe démiurgique, évidemment, tout en restant fatalement à la porte de la vérité; extérieur à toute essence divine, condamné à l'irreprésentable du sujet absolu, l'homme n'aura jamais qu'un accès indirect à la signifiance du monde. Ainsi, pour le croyant, la ressemblance émane du divin sans l'intégrer en soi, comme référence mythique : l'image supposerait ici une ontologie dégradée, d'où l'irreprésentable. D'où la méfiance iconoclaste face à la reproduction iconique du sacré en général. Pourtant, l’image de Dieu ou du Prophète, fournie par le dessin, ne fait jamais référence à l’objet même, dans la mesure où Dieu est à la fois inconnaissance et irreprésentabilité radicale. Ce n’est jamais dans l’ordre de la ressemblance iconique qu’on dessine Dieu, mais comme phantasme de représentation : il n’y a pas de référence réelle à un dessin de Dieu puisque justement il est absence de représentation, absence de réel. La ressemblance dans l’identité radicale renvoie à une structure absente. C’est à cette condition que la ressemblance implique, dans son retournement anthropologique, une force supérieure de représentation, une modélisation du monde dans l’image absente de Dieu : c’est là le fondement du signe, l’irreprésentable radical.
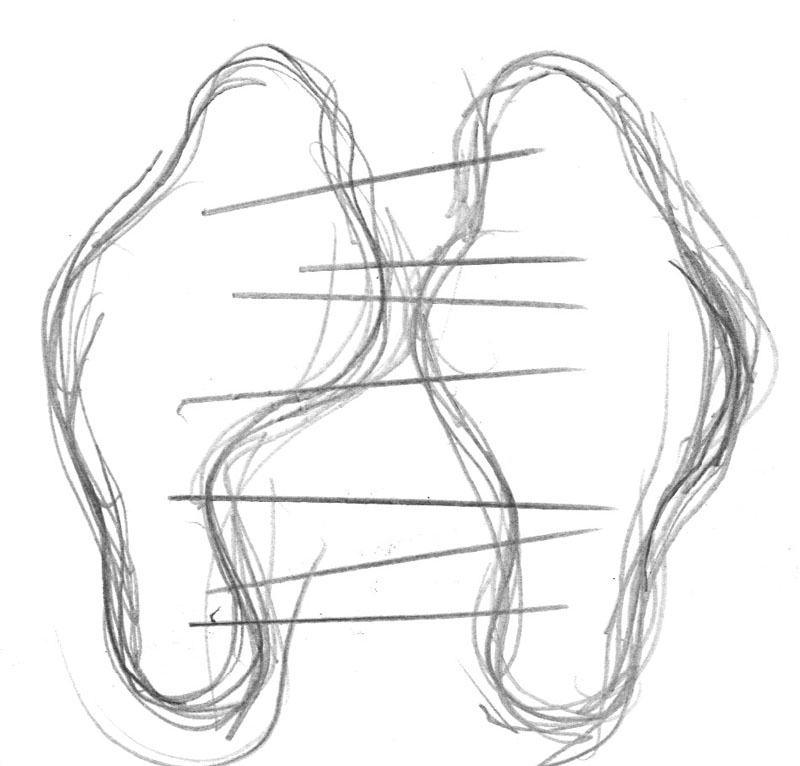
À ce titre, une autre structure accompagne la « structure de mythe » selon Didi-Huberman ; c’est la « structure de tabou » : « puisqu’une telle relation — de l’homme à son Dieu créateur — se trouve immédiatement assortie d’une interdiction fameuse : ne pas toucher à « l’arbre de la connaissance du bien et du mal » […] »(10), c’est-à-dire que la ressemblance ne peut jamais s’appliquer à Dieu. Le tabou tel que je le comprends est celui du principe de ressemblance et non celui de la représentation en soi. Bref, l’imbécile qui regarde le sage montrant la lune confond le doigt et la lune, le signe avec la chose, Dieu avec un dessin. Nous voilà, avec le dessin, directement immergés dans la guerre du signe : si tu dessines mon eidôlon je te décime. Car l’icône profane est eidôlon pour l’infidèle. Cependant eikôn et eidôlon constituent deux degrés différents de ressemblance :
« Le célèbre passage de la Genèse 1, 26 qui montre Dieu créant l’homme « selon son image et sa ressemblance » fait de l’homme une « icône » et, qui plus est, une icône fidèle. Si les traducteurs ont ici écarté eidôlon, c’est parce qu’il aurait fait contresens, en présentant l’homme comme un double visible de son créateur. Or le divin n’appartient pas à la sphère du sensible et la ressemblance que l’homme peut avoir avec lui ne se situe pas au niveau de l’apparence et du corps, mais de l’essence et de l’âme ». (11)
L’eidôlon appellerait une reproduction littérale du visible, une apparence, là où l’eikôn suppose une reproduction ontologique. La puissance du signe absolu — l’irreprésentable — met ici le divin dans le langage. Autrement dit, certains essentialistes, ignorants d’anthropologie du langage, n’auraient pas saisi que toute ressemblance avec un prophète existant ne peut être, dans l’univers humain, que purement fortuite. On voudrait nous faire croire que le divin échappe à toute ressemblance, à toute incarnation dans le signe et que le signe atteint directement le réel ; y aurait-il du langage qui soit irreprésentable dans le dessin ? Il y a bien une dimension morale à la ressemblance, un impératif de fidélité par rapport à l’objet d’origine : l’icône se doit d’être conforme à une idée préalable de l’essence des choses. Aussi, y a-t-il un danger réel à plébisciter une transparence du langage, à faire du dessin le miroir iconique d’une essence de l’irreprésentable. Il y a un réel problème à faire du langage un mode d’appréhension littéral du monde. Si le diable se cache dans les détails, où donc se cache Dieu ? On voit depuis des millénaires s’accumuler les éléments d’une métaphysique de la représentation confondant, dans la pensée, le signe et l’objet qu’il désigne. Les religions ne font que reprendre ici l’espace mental ouvert par les théories instrumentalistes du langage et du sens.
L’icône : révélation métaphysique du réel
Il est symboliquement révélateur, dans l’archéologie d’une théorie du langage, que la notion d’icône constitue une représentation formelle basée sur la « ressemblance » avec le réel ; d’autre part, elle marque un rapport au vrai par extension de la représentation au « vrai-semblable ». L’icône n’est pas simplement un élément technique ou transparent du langage ; penser la représentation du monde en terme d’« icône » est tout à fait discutable comme nous l’enseigne historiquement la « querelle des iconoclastes ». La question d’une idéologie du visible portant le langage comme enjeu secondaire de toute phénoménologie est d’autant plus prégnante si nous interprétons l’icône comme signe dans le système sémiotique de Peirce. Penser le langage comme reproduction iconique du monde supposerait alors le langage comme une modalité faible du réel, dans la mesure où l’artefact, l’image, le signe institueraient le monde par comparaison : le langage, outil de communication, permettrait d’explorer le monde sans en atteindre jamais « l’essence véritable » ; cette dernière étant réservée au signe ultime institué dans la « présence-absence » de ce qu’on ne nomme pas et qu’on interprète comme le « divin » interne à l’universalisme du signe.
« Les hommages des fidèles, loin de s’arrêter à l’icône, la traversent pour atteindre le divin. Selon la formule du deuxième concile de Nicée, qui reprend, en la modifiant quelque peu, une phrase souvent citée de saint Basile: « celui qui vénère l’icône vénère en elle l’hypostase de celui qui s’y trouve peint ». Et les théologiens qui défendent les images, comme Jean Damascène ou Étienne le Diacre, célèbrent dans des termes à peu près identiques une icône qui est «révélation et indication du caché» et «porte ouverte sur l’Au-delà ».» (12)
Il y aurait donc un continu théologico-politique entre monde et langage — notamment par le statut qui est octroyé à l’interprétation — qui détermine le langage comme une forme de lecture du monde, avec en point de mire la « vérité du sens» ou le « sens vrai »; jamais atteint puisqu’il appartient à l’origine du sens — à une « archéologie» — qui nous échappe fatalement. Alors oui, dans le langage-théorie-de-la-nomination-du-monde, le langage ne dit rien d’autre que l’idéologie de sa modalité essentielle, celle de l’incomparable voire de l’innommable. Mais dans ce cas, y aurait-il une concurrence entre les modes de représentation, entre la figuration par le langage et une figuration par l’image ? Nous allons essayer, en l’absence de réponse évidente, de nous accrocher à la question. Le régime du visible a un tel impact dans les théories du langage, qu’il ne serait pas absurde, peut-être, d’envisager une corrélation entre l’histoire de la bande dessinée et la théorie du langage — à condition de ne pas réduire la théorie du langage à la linguistique ; à condition de ne pas réduire la signifiance de l’image à la signifiance de la langue.
Ce n’est pas parce qu’image et langage sont des systèmes différents et que le langage implique l’image de manière asymétrique que nous défendons un verbo-centrisme de l’organisation du sens. Nous soutenons Jan Baetens, concernant l’iconologie de Mitchell, quand il déclare que «nulle théorie de l’image ne peut être coupée du langage qui l’articule » et que d’autre part « la plupart des discussions sur l’être de langage ont ceci en commun, qu’elles abordent le visible en l’opposant à la langue » (13). On retrouve chez les deux auteurs une position théorique que nous connaissons bien et que nous partageons ; non par excès de confiance dans les capacités du langage ou dans la perspective de faire entrer le monde dans les moindres parcelles du discours. Non. Il y a quelque chose de l’image qui continue dans le langage, quelque chose qui fait, comme pour le langage, qu’une image ne peut jamais être une image seule ; sa réalisation tient à l’ensemble des conditions qui la rendent possible, au premier rang desquelles, il y aurait le langage. Et à chaque fois que l’image prend un sens, elle est paradoxalement un peu plus image au fur et à mesure qu’elle gagne en langage. Pour autant cela ne subordonne pas l’image au système du langage, car le langage est là pour disparaître dans ce qu’il y a à dire. Rien n’est fait pour rester tel quel : les images sont mobiles en tant qu’expériences subjectives, elles peuvent se dissoudre en tant qu’image que ce soit dans le monde ou dans le langage. L’image est continue du langage bien qu’elle ne s’y soumette pas. Jan Baetens le précise très clairement : l’opposition texte/image est tout aussi discutable qu’une hypothétique hybridation structurelle ou formelle de l’un et l’autre champ. L’opposition texte/image ne serait-elle que le révélateur, finalement, des tensions idéologico-théoriques plus profondes qui constituent historiquement la société? Il y a des luttes idéologiques qui se prolongent dans les conceptions de l’image et dans les théories du langage. Cependant, pour ce qui nous concerne, il s’agit moins d’avoir raison que d’essayer d’ouvrir la théorie du langage dans le rapport au visible — grâce à la bande dessinée. Les arts du langage comme la poésie et la littérature ; ou bien la peinture du côté des arts de la «monstration» pour parler d’une forme énonciatrice du visible ouvrent des possibilités de questionnement du sens que ne permet pas la logique interne à la linguistique. Certes comme le dit Baetens, Mitchell « exécute sommairement » la sémiotique ; cependant à la différence de Baetens qui déplore notamment l’absence d’une discussion des thèses d’Émile Benveniste, « la reconnaissance d’un sémantisme spécifique, non verbal, des systèmes iconiques » (14), je ne peux me résoudre, comme il le suggère, à concevoir Benveniste comme un sémioticien. Baetens voit bien l‘originalité de l’approche du langage de Benveniste mais il ne l’extrait pas d’une lecture sémio-structuraliste.
Poétique de l’eidôlon
Nous avons pu constater que la notion d’icône constituait un passeur théorique récurrent concernant les enjeux d’une signifiance particulière à la bande dessinée. L’iconicité, à ce titre, n’est pas seulement l’image en elle-même, mais c’est aussi le processus par lequel se réalise l’image : la comparaison, la mise en rapport du monde et de sa représentation. L’icône n’instaure pas néanmoins un savoir absolu mais un rapport relatif au monde. D’où l’idée que l’icône est à la fois image et processus, mais aussi « conjecture », interrogation du monde dans le langage dans la mesure où:
L’ensemble formé par eikazô [dérivé
de eikôn [εἰκών]] et les termes qui
s’y rapportent « illustre — dit Chantraine (s.v. eoika) —,
le passage du sens de « image, ressemblance » à celui de
« comparaison, conjecture» ; eikasia [εἰκαὓια]
par exemple désigne aussi bien l’image (Xénophon,
Mémorables, 3, 10 1) que la conjecture, celle des devins comme
celle des médecins (Platon, République, 534 a; Hippocrate, Des
Maladies, 1; cf. to eikastikon [τὸ εἰκαὓτικόν],
Lucien, Alexandre, 22). » (15)
Il y a donc, avec l’icône, une valeur interprétative et subjective de ce qui est appelé à la comparaison, c’est-à-dire de ce qui est mis en relation. Il y a aussi un plan moral de la comparaison comme mesure du vrai : l’icône, le « vrai-semblable », doit être conforme à une certaine réalité. Ainsi ce qui atteste du monde dans la relativité du vraisemblable s’opposerait au caractère absolu du vrai dans la mesure où, dans la conjecture, le vraisemblable peut-être faux en réalité. Selon la logique rhétorique, le vraisemblable ne permettrait jamais d’atteindre le vrai puisqu’il en constitue à la fois l’écart moral et l’instrumentalisation au profit de la persuasion. Pourtant dans le jeu des apparences le vraisemblable peut paraître plus vrai que la réalité. La question de la mimèsis entre « imitation », analogie stricte de la réalité, et « représentation » c’est-à-dire réinterprétation de la réalité dans le langage, fait basculer la situation du vraisemblable : elle n’est plus la mesure interne de la réalité mais la prise en charge dans l’activité signifiante d’un sujet d’une réalité du monde qui ne peut prendre son sens que de manière interne au langage. L’icône serait alors puissance poétique au sens d’Aristote dans la mesure où « le rôle du poète est de dire, non pas ce qui a eu lieu réellement, mais ce qui pourrait avoir eu lieu dans l’ordre du vraisemblable ou du nécessaire » (16). Autrement dit, le rôle du poète n’est pas de dire le vrai mais bien d’ouvrir la réalité au possible et à l’infini du langage ; et, débordant le récit de l’authenticité, de travailler à l’interstice de la conjecture du réel et de l’image pour s’en faire chaque fois le recommencement des théories du sens dans leur ensemble. À l’instar d’une œuvre d’art, c’est dans l’incommensurable du réel et du sens qu’un poème ne ressemble à rien d’autre qu’à lui-même, troublant de ce fait la distribution d’un rapport simplement « imitatif » entre le monde et le langage.
Or si l’icône est la reproduction fidèle de la réalité comment peut-elle rendre compte de la signifiance de la langue dont le système est fondé par convention ? Les ressemblances ne se réaliseraient qu’au niveau discursif, dans la capacité à appareiller la réalité au langage pour produire quelque chose que nous pouvons « appeler » image dans un système de discours. D’où cette circulation importante de l’image et de ses hypostases artistiques ou poétiques dans l’invention de la théorie du langage. Cependant, allons plus loin dans l’analyse de la ressemblance incarnée par l’icône afin de considérer en quoi la bande dessinée a trait à l’art d’imitation ; qu’il s’agisse de la reproduction brute des objets de la réalité ou des extensions logiques comme le récit dont le but au départ consiste à rapporter des faits et non à les interpréter ou à les transformer poétiquement, pour reprendre Aristote. D’un autre côté, l’icône maintient, dans la logique même de son fonctionnement, un régime ontologique de la réalité, un rapport à ce qui est réellement.
Ainsi, qu’on se réfère à Platon ou à Aristote, poésie, peinture et sculpture ne relèvent pas de la mimèsis iconique mais d’une réinvention subjective de la réalité, d’un simulacre. L’art n’est pas semblable au vrai littéralement puisqu’il est le faux de la réalité. Pour autant, il semblerait, au-delà de l’illusion de la réalité, qu’il porte en lui une expression du vrai, celle du sujet signifié par l’œuvre et faisant le sujet signifiant. Et à y réfléchir, je verrais plutôt dans la peinture la constitution d’idoles, non pas au sens moral de l’idolâtrie qui en découle, mais au sens de ce que ça transforme du voir. En effet d’un point de vue moral l’eidôlon renvoie encore à l’illusion et au faux. Mais l’art n’est-il pas justement subversif par sa critique des apparences sociales que prend le vrai sous des formes comme l’esthétique ou l’harmonie ? Car l’eidôlon est du visuel porteur d’illusion, par opposition à l’eidos ou l’idea [ἰδέα], de même racine, la forme belle et vraie, qui devient chez Platon « idée » (Cratyle, 89b 3). Là encore l’art est ennemi du vrai ou du moins du monde tel qu’il est. D’où l’introduction avec la poétique d’une utopie de la réalité et du vrai dans la subjectivation artistique. L’illusion au bout du compte serait moins la reconstruction d’une perspective trompeuse qu’une forme inédite des rapports du sujet et du social venant faire corps avec le monde comme aventure de nouveaux rapports dans le langage ? De même, n’est-ce pas un athéisme de l’idole qui s’est mis en place avec la littérature et qui fait de la bande dessinée non pas un art de la poésie mais un art du récit ? Un art du littéralisme iconique ?
Alors pourquoi ne pas renverser le processus original qui fait de l’icône la représentation « normale », « convenable », « conforme », par sa ressemblance, à la réalité ? Et de mettre en valeur l’idole, non plus comme expression de la fausse ressemblance pour reprendre le jugement moral de la métaphysique chrétienne, mais comme vrai signifiant, désessentialisé, pourvoyeuse non pas de ressemblance, mais de force symbolique ? « Esclave de l’apparence, l’eidôlon est radicalement coupé de l’essence »(17) et suppose dans l’ordre du visible non pas un rapport à ce qui est ou au réel, mais un rapport au discours. La philosophie morale de Platon qui cherchait à mettre en évidence les conditions universelles du vrai a ainsi hiérarchisé moralement le visible par rapport au vrai et non par rapport à l’art : de l’eidôlon à l’eidos, jusqu’à l’idea. Dans le fameux Mythe de la Caverne, précise Suzanne Saïd, relèvent de l’eidôlon « des réalités opposées à la vérité, à l’essence et au bien qui ne peuvent être appréhendées que par l’opinion » (18) ; c’est-à-dire dans les discours du sujet. Elle relève ailleurs que ce n’est pas seulement ce qui ressortit au visible et à l’apparence formelle qui est moralisé dans le faux et institué dans l’eidôlon comme illusion d’idéa : « dans le Théétète (206d), le langage qui, tel un miroir ou une étendue d’eau, manifeste la pensée au moyen de verbes et de noms grâce à la réalité sensible de la voix est «comme un reflet de l’idée ». Par contre dans le Phèdre (276a) c’est le discours écrit qui hérite du nom infamant d’eidôlon par opposition à un discours oral dont on souligne par comparaison le caractère vivant et animé » (19). Le langage et en particulier l’écriture, interprétés comme « reflets » de la réalité, sont ainsi rangés au niveau de l’artefact, comme des formes discontinues du vrai et de la vie. Ce qui vaut pour le peintre vaut également pour le poète.
Ce qui nous intéresse ici, c’est le retournement possible d’eikôn en eidôlon, considérant que les rapports entre l’art et le vrai ne font pas référence à un objet réel mais à la relation au monde que constitue le sujet dans le langage. En effet, « Alors qu’il n’existe entre l’eidôlon et son modèle qu’une identité de signifiant, la relation entre l’eikôn et son modèle repose sur une identité de signifié » (20). C’est un changement de point de vue qui nous intéresse, dans la mesure où, selon nous, le travail poétique comme le travail artistique se fait au niveau signifiant et non au niveau signifié, ou sous l’angle d’une ressemblance effective à l’objet. L’objet réel n’ayant qu’une importance relative pour l’artiste, nous n’aurions affaire en peinture qu’à des simulacres critiques des représentations instituées de la réalité, qu’au travail critique du signifiant contre les ontologies du réel.
Notes