

NOTRE HÔTE : TOMMI MUSTURI
Le prisonnier du style (et son plan d’évasion)
Traduit du finnois par Kirsi Kinnunen avec l’aimable collaboration d’Anne Cavarroc*.
DU STYLE ET DE SON IMPORTANCE POUR L’AUTEUR
« Style is a manner of doing or presenting things. »
Au commencement était le papier, le crayon et l’enfant qui dessinait. Il lisait des bandes dessinées et des romans jeunesse. Il préférait le dessin à l’écriture. Ça le fascinait de voir des univers naître sur le papier sous ses yeux. Il s’appliquait. Il lui arrivait souvent d’en tirer un sentiment de réussite. Un de ses copains de classe lui a un jour demandé de dessiner sur son bras le logo de son groupe de musique préféré. À la maison, il travaillait généralement la nuit quand les bruits et les lumières ne pouvaient pas le déranger. Il sentait son talent évoluer. Il a eu l’occasion de concevoir la pochette du disque pour le groupe de ses amis. Il est entré dans une école d’art. Il a dessiné de plus en plus. Il savait maintenant qu’il avait du talent. Il publiait ses bandes dessinées dans le journal local. Il a gagné un concours d’illustration. Il a gagné un concours de bande dessinée. Il sentait que ça se passait bien pour lui. Il arrivait maintenant à faire quasiment tout ce à quoi il avait aspiré. Son style n’était pas le plus original qui soit mais il était néanmoins reconnaissable, c’était son style à lui. Sa narration était impeccable, le lecteur pouvait la suivre. Les commandes se faisaient de plus en plus nombreuses. Il était même payé pour son travail. Ses illustrations et ses bandes dessinées lui suffisaient pour vivre et il pouvait se considérer chanceux parce que nombre de ses copains de l’école d’art manquaient de travail ou changeaient carrément de métier. De temps à autre, il repensait à ses moments de réussite et cela lui donnait parfois le sentiment désagréable de s’être laissé piéger dans une machine bien plus grande que lui. Alors, il se rappelait à lui-même qu’il avait la chance de pouvoir gagner sa vie en faisant ce qu’il aimait. Il en obtenait non seulement une gratification pécuniaire mais aussi le respect de ses collègues. Mais au fond, son travail ne l’intéressait plus tellement même s’il continuait à honorer ses engagements. Il était devenu quelqu’un qu’il n’avait pas prévu.
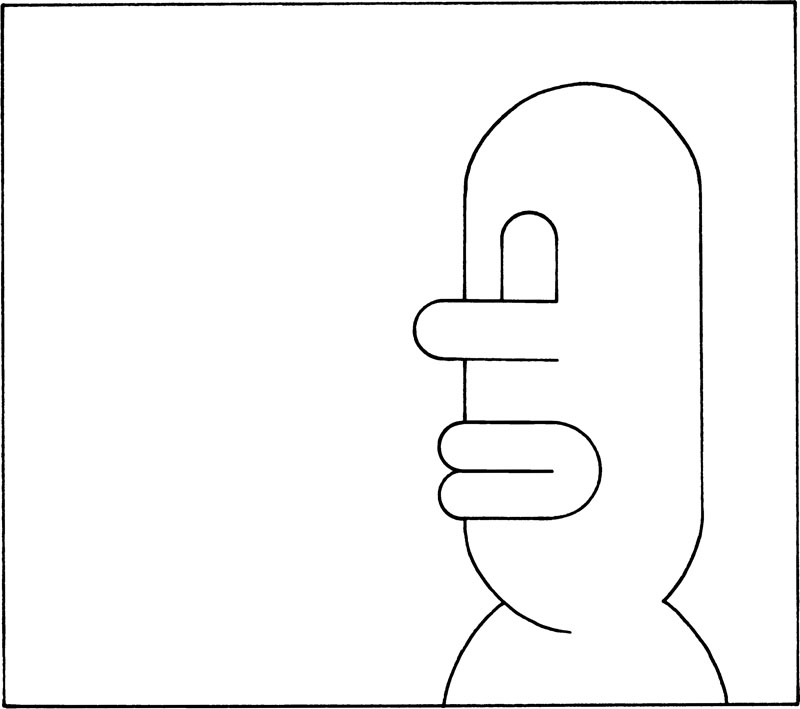
QU’EST-CE QUE LE STYLE?
Le style est quelque chose de reconnaissable, de constant, d’immuable, d’arrêté, de prudent, que l’on peut identifier et auquel on peut s’identifier. Le style représente aussi une peur — peur du renouvellement, peur de la perte, peur de l’indistinction.
Je parle ici du style figé, identifiable de loin, associable à l’auteur qui sait ce qu’il veut et comment l’atteindre et qui permet au récepteur de voir ses attentes satisfaites. Tout va bien dans le meilleur des mondes, les pièces tombent à leur place et ce même schéma se répète aussi bien dans le mainstream que dans les cultures underground. C’est comme si, main dans la main, la création et la réception avaient choisi leur camp. L’auteur se laisse emporter par le fleuve dans lequel il s’est lui-même jeté. Les critiques finissent par retrouver un goût familier dans son œuvre après l’avoir pu mâchonner suffisamment longtemps et peuvent maintenant formuler un avis dessus. Nous vivons dans une culture de saveurs uniformisées. Pour rehausser le goût, la solution habituelle aux États-Unis est l’ajout de sucre. En Russie, tout regorge de gras. La vieille sagesse connue dans les asiles psychiatriques est: « Plus tu manges du porridge, moins tu as envie d’autre chose. » Rien n’interdit à l’homme de consacrer sa vie à une seule chose et se perdre dans les détails. Il n’empêche que quelques changements de saveurs et d’univers gustatifs suffisent pour remettre même le porridge dans un contexte tout à fait nouveau.

Le récepteur peut s’enticher d’un style pour plusieurs raisons. Le style peut tout simplement lui procurer un plaisir esthétique. Le style peut aussi faire appel à son identité et sa place dans le monde en s’ancrant placidement dans l’actualité ou en invoquant les souvenirs de ses premières expériences de la culture de masse. En général, un récepteur lambda ne cherche pas à analyser les raisons pour lesquelles une œuvre lui plaît. Il la trouve « importante » ou « très bien ». Il ne décortique pas le contenu de l’œuvre mais se laisse emporter par les sensations qu’elle suscite. En effet, trop analyser n’est pas souhaitable dans la mesure où cela peut nuire à l’expérience globale. Au pire, le style n’est qu’une surface. Dans ce cas, les significations de l’œuvre ne sont formées qu’en relation avec l’identité et les expériences du récepteur. La complexité de ce monde du XXIe siècle pousse souvent les gens à rechercher la facilité. La surface n’a déjà été que trop remaniée par le marketing dans le but de la transformer en produit de marque. Dans l’ère des réseaux sociaux, des centaines de millions de gens peuvent avoir simultanément l’impression qu’une œuvre particulière les interpelle spécifiquement. Imaginons une société où tout le monde a partagé les mêmes expériences depuis l’enfance. Comme seule alimentation, un unique « porridge éternel » est nécessaire pour nourrir les sens. Du point de vue du capitalisme, le plus simple est de réduire les gens à cet état d’addiction au porridge le plus tôt possible. Pour le capitalisme, le style est un outil particulièrement efficace. Il sert à procurer à l’économie de marché des emballages différents dans lesquels le même produit ciblera des publics différents, et les réconfortera grâce à sa familiarité. Proposer de nouvelles idées, de l’information pure ou des contenus idéologiques aurait pour seul effet de déranger le business.
Une fois le style fixé, l’évolution de l’auteur ne se manifeste plus qu’au niveau des nuances — dans des détails infimes ou dans sa façon de travailler. Le récepteur s’en rend à peine compte. Ces variations peuvent cibler et guider son expérience, mais le contenu reste immuable. Sur un forum d’auteurs de bande dessinée, untel annonce avoir changé de marque de gomme, untel se dit bloqué dans sa création parce qu’un certain type de papier dont il avait l’habitude n’est plus disponible. Le style est l’ennemi de l’auteur car il falsifie l’expérience du récepteur. L’œuvre devrait se répandre doucement sur le destinataire, comme une pluie fine un jour de canicule. Le vrai but est de parvenir à émouvoir et à s’émouvoir.

« Trouver son style » peut avoir un effet abrutissant sur l’auteur.
Il sombre dans la routine et l’énergie, qui auparavant se dégageait
de son œuvre, disparaît. La qualité de son travail baisse
et la création n’est plus qu’une suite de répétitions
diverses. On assiste à la naissance de l’anecdotisme. Pourtant,
le récepteur, nourri par ses expériences antérieures conservées
dans son inconscient, continue à apprécier l’auteur et,
la plupart du temps, lui reste loyal. L’auteur pour sa part, aime le récepteur
parce que celui-ci aime son style. Ainsi, leur rapport est-il symbiotique mais,
dans le même temps, il est symptomatique que pour le destinataire c’est
souvent la première œuvre de l’auteur la meilleure.
Si la machinerie capitaliste aime l’auteur et son style, elle aime encore plus le récepteur parce que celui-ci est la levure de l’appareil commercial. Dans la promotion de l’auteur il s’agit en fait de son style. Le micro-ciblage donne aux spécialistes du marketing les clés pour comprendre les divers besoins des récepteurs qui, eux, ont arrêté de réfléchir et se contentent de revisiter les œuvres de l’auteur parce que son style les comble d’un sentiment de sécurité. Leur rapport est devenu sérieux. Ils pensent bien se connaître et se blottissent dans ce confort. Tranquilles au coin du feu, l’auteur et son récepteur partagent le même bien-être. L’homme cherche toujours le confort. En effet, il serait bien inconfortable de passer la tête dans les flammes de la cheminée. Pourtant, pour se renouveler, c’est ce qu’ils devraient faire tous les deux. L’objectif de l’humanité est d’évoluer en tant qu’espèce. Seules la pensée individuelle et la capacité à faire des choix personnels sont en mesure de sauver le milieu sur lequel nous avons étendu notre suprématie : notre planète.

Le style est souvent le reflet d’une époque. Sous la pression sociale, nombreux sont ceux qui s’emparent des tendances du jour. L’idée de se voir rejeté par ses collègues ou de perdre leur respect est trop effrayante — ne pas avoir de style reviendrait alors à n’être rien. En effet, la plupart des auteurs délimitent leurs intérêts et construisent leur identité d’après des déterminants externes. L’homme du XXIe siècle manifeste un besoin d’appartenance particulièrement important. Au cœur d’un monde changeant, tout ce qui relève du « privé » procure un sentiment de sécurité. Qu’il s’agisse d’un punk, d’un joueur de golf, ou d’un pêcheur, tout le monde a besoin de son propre groupe. Sans appartenance, ils n’existent plus, ou tout du moins, ils se sentent incomplets. Devant le néant, tout est petit. Nous espérons qu’en adhérant à une pensée unique notre petit monde va retrouver sa cohérence. Partager les mêmes sensations, assister aux mêmes reprises, verser ensemble les larmes que l’expérience nostalgique générationnelle nous tire ne font qu’accentuer le phénomène. Dans le même temps, les algorithmes des médias sociaux cherchent fiévreusement à nous proposer des amis pensant comme nous, des idées et des produits qui ne font que changer d’emballage. Si à ce moment-là nous regardions le miroir, nous ne saurions pas quoi penser de ce qui s’y reflète. Si on nous enlevait nos vêtements, nos bijoux, nos maquillages, nos tatouages tribaux et nos faux ongles, nous nous sentirions bien mal à l’aise. L’image que renvoie le miroir ne montre généralement pas l’asymétrie de notre visage.

Pas obligé de « liker»
L’économie de marché adore les produits faciles à reconnaître et faciles à vendre. Grâce aux réseaux sociaux il existe désormais un cerveau unique perméable à tout et à n’importe quoi que les milieux commerciaux ont l’idée de diffuser à travers la planète en quelques millisecondes. Au sein d’une culture unique, les styles et les contenus qui ont fait leurs preuves subissent un processus toujours s’accélérant de « pirater/commercialiser ». Les images qui encore hier étaient expérimentales sont aujourd’hui exhibées sur des caleçons. Pour éviter le tourment, un grand nombre d’auteurs ne vendent pas seulement leur travail, mais aussi eux-mêmes. Pour ne pas morfler, l’auteur, en guise de mécanisme de défense, préfère se laisser contrefaire.
Les médias sociaux sont remplis de flux d’images où les auteurs se piratant les uns les autres se « likent » les uns les autres. Aux quatre coins du monde se répandent instantanément des tendances identiques, qu’il s’agisse des piteux effets 3D, de l’art singulier, des fanzines imprimés à la hâte en riso dont le contenu est la copie conforme de la scène artistique, des sons, des équipements, etc. Face à ce phénomène, les rangs serrés des cliques d’entêtés en fin de vie créative portant l’étendard du temps jadis. Jamais il n’y a eu aussi peu de convergence entre le vieux et le nouveau qu’aujourd’hui. L’histoire n’entre pas dans le moule commercial. L’homme sans instruction accepte qu’on lui vende et revende toujours le même produit.

L’arrivée de l’internet et la transition obligatoire des vieilles aux nouvelles technologies a eu lieu à un moment idéal du point de vue financier. Dans les années 1990, l’internet était encore une plate-forme relativement libre mais réservée à un groupe restreint de privilégiés. La toile a pris de l’ampleur grâce à l’enthousiasme grandissant pour une nouvelle ère numérique, mais c’est la toile elle-même qui a permis sa commercialisation. En Occident, les médias de la pensée unique créée par la mondialisation ont vite associé l’internet libre à la vente de drogues par le réseau Tor, ou aux « criminels » diffusant de la musique et des films grâce aux technologies P2P. La plupart du temps, ces contrevenants étaient de jeunes hommes enthousiasmés et profondément motivés par l’idée de liberté. Les changements du réseau restent généralement invisibles pour les utilisateurs de la toile. Néanmoins, il est important pour tout un chacun de comprendre que dans les années 2010, les informations, les opinions ou les expériences diffusées par l’internet sont loin d’être objectives. Il s’agit la plupart du temps de vendre quelque chose. Au fond, il est question de pouvoir. Sous toutes ces surfaces visuelles poussent des horreurs dont nous ne sommes pas conscients. La tendance à l’automatisation évoque à un certain point les aspirations déshumanisantes du pouvoir nazi. Tout comme le soldat ouvrant les vannes des chambres à gaz n’assistait pas au résultat de son acte, nous ne nous rendons pas davantage compte des conséquences de nos clics. À l’apothéose de la machinerie commerciale mondialisée plus personne n’est responsable de rien. Le pouvoir est soumis au service de l’argent et l’automatisation le rend rentable.

Avec la mondialisation, les marges de manœuvre se réduisent pour tous les domaines culturels. Les milieux détenant le pouvoir définissent aussi bien les tendances anciennes que nouvelles, et l’auteur est obligé de trancher : soit il cherche ses publics dans les milieux de l’underground soit il s’adapte aux codes du mainstream. La vraie création et la production mainstream ont de moins en moins de points communs — les publications, les médias, les magasins, les événements ou les forums sur l’internet divergent tant que la rencontre entre tout produit culturel qui contient une pensée réellement importante et ceux qui sont à sa recherche devient carrément difficile. L’impact réel de la culture devient minimal, et se limite aux apparences lorsque ceux qui revendiquent le changement prêchent des convaincus. Pour les dirigeants du pays, la culture fait figure d’une relique qui justifie son existence à travers les résultats réalisés dans le cadre budgétaire. Le pouvoir de l’art a été noyé dans les comptes d’apothicaire et relégué à la marge. Certes, il est compliqué de créer des indices pour mesurer les sensations suscitées par l’art et, quand bien même ils existeraient, ils seraient conditionnés à l’obligation de résultat. Évidemment tout cela est tout à fait abstrait, une création peut aussi bien susciter de la colère que de l’enthousiasme tout en ayant une valeur dans les deux cas. Mais force est de constater que le mainstream entretient aujourd’hui une attitude hostile envers la culture, l’instruction et l’information. Je le redis : il est question de pouvoir, car le pouvoir signifie la capacité et la possibilité d’influencer. Dissimuler l’information et la culture aux yeux du peuple est un moyen de coercition utilisé depuis des centaines d’années. Au début de l’imprimerie, ses secrets étaient bien gardés parce qu’ouvrant un accès au savoir à tous, ils représentaient l’outil de contrôle le plus important pour le pouvoir en place. Les anciennes colonies africaines et latino-américaines souffrent encore aujourd’hui de lacunes en matière de compétences en imprimerie. De nos jours, les médias et réseaux sociaux ont pris la place de la parole imprimée, et ce phénomène a permis le développement d’un contrôle qui au lieu de s’exercer au niveau d’un seul pays, s’étend sur la planète entière. Il est essentiel pour l’économie de marché que l’esprit humain soit subordonné à l’emprise de la toile et que, rangé entre le grille-pain et le vibrateur du monde réel, il fasse partie de « l’internet des objets ». Soumise au pouvoir de la finance, la toile est définie selon sa volonté jusque dans le moindre de ses composants. Sont ainsi définis non seulement le contenu mais aussi son utilisateur. Quand tous les flux sont structurés dans des paquets de données bien ordonnées, les médias et les réseaux sociaux n’ont plus grand-chose à proposer à la culture dissidente – alors que c’est justement la culture qui devrait toujours représenter la pensée divergente.
Il a été dit que c’est justement la sensation du néant qui représente le mieux ce début du nouveau millénaire. L’humanité a du mal à adapter son esprit à cet univers virtuel qui n’arrête pas de se transformer tout en restant anonyme. L’internet se fond de plus en plus en un miroir où les accros à la toile sont heureux de retrouver leur propre image. Le rêve partagé dans les années 1990 d’une ouverture de l’accès à l’information, à la culture et à l’instruction pour tous a été noyé dans une sensation de liberté qui n’est qu’apparente. Dans une situation où les droits d’auteur sont devenus une marchandise comme une autre, les auteurs tout autant que les organismes œuvrant pour la protection de leurs droits sont pour leur part responsables de l’abrutissement du peuple. La nature et les manières de diffusion des contenus par l’internet auraient dû être définies ensemble par les défenseurs des droits d’auteur et les idéologues de l’internet mais leurs visions ne convergent que rarement. Malgré tout, la machinerie du pouvoir de la toile est toujours vulnérable et l’homme n’est pas encore complètement abruti. Maintenant, il faut saisir les alternatives et les protéger, et il faut surtout proposer des canaux et des lieux différents pour leur diffusion. Aucune culture n’arrive à survivre et aucune pensée subversive ne se transmettra si elles n’ont pas de public.

[...]
deuxième partie dans Pré Carré 10
La traductrice remercie la Kone Foundation pour sa bourse de travail.