

Les statues amnésiques, sur Jeu de lumières de J. Muñoz et C. Sampayo
par Aurélien LEIF
débité en tranches fines par Guillaume Chailleux
à Élie
« Les mexicains d’antan craignaient que le soleil ne sombre si les guerres s’arrêtaient. Je fais aussi la guerre, mais j’y suis dans le noir. C’est pourquoi j’ose penser que les jours sont éteints depuis que la pacification règne, et que la lumière en est le signe. »
La foulée des dégoûts
Une vieille lumière, une bien vieille lumière qui ne connaît pas le gris... La nuit se lève à peine sur la toute première page que nous voilà déjà piégés dans les distinctions brutes, noir blanc, lumière obscurité, comme une valse à deux temps qui ignorerait la nuance... Dès le départ, le problème est posé : noir n’est pas le contraire de blanc, la lumière est sans distinction et n’a pas de contraire — elle n’est pas opposable, elle est réversible, elle n’est pas un milieu, mais bien un processus. Mais comment en vient-on à faire de la lumière un simple redoublement, une bête constatation ? Il y a un présupposé pratique, perceptif et conceptuel à la fois, qui régit sourdement notre rapport à la lumière : on présuppose toujours que la lumière ressortit à la forme théorétique ou contemplative de la vie, qu’elle est milieu de révélation, monstration du constitué, apparaître du phénomène, plutôt qu’elle n’appartient à la vita activa, au monde de l’action et de l’activité. Il y a pourtant un décrochage paradoxal entre le monde de l’optique, et le monde du visible : aller au bout du concept de lumière implique de déterminer le moment où, invisible comme telle, on ne la saisit plus que comme activité esthétique, ou sensibilité du sensible. La lumière n’appelle pas tant une physique ou une métaphysique qu’une pragmatique capable d’en montrer la puissance de tracé, et la nature inchoative. Premier constat, devise impressionniste : la lumière trace, dessine — écrit. Poser le problème de l’espace graphique implique ainsi de déterminer ce qui y fait non-spatialement lumière : qu’est-ce qui en tant que lumière se résout en et à l’espace sans y appartenir ? En quoi la lumière trace-t-elle l’espace, plutôt qu’elle ne s’y inscrit ? L’espace graphique, c’est ce qu’on rabat toujours-déjà sur le couple scription/surface d’inscription pour en faire l’interface des deux, leur entr’expression muette, leur partage blanc et neutre. Le concept de « medium » appliqué à la bande dessinée ou à toute autre discipline est d’abord la conséquence de cette superposition de la scription et de la surface d’inscription censée produire l’écriture en elle-même au terme d’une étrange synthèse homogène et réglée. C’est qu’on transforme toujours le sensible en espace qualitativement neutre et quantitativement régulier dès qu’on en fait l’entre-deux du monde et de la conscience, du sujet et de l’en-soi, de l’œil et du visible : la séparation esthétique se joue là, et s’inaugure dans cet espace qui est celui de la représentation, là où les images tombent et meurent d’être assignées, d’emblée soumises aux reconnaissances figurales, objets d’une perception devenue mémoire des formes, devenue, surtout, incarnation des schèmes qui en sont la matrice. S’il y a un espace graphique qui se résout en positions et thèses, qui finit fatalement en espace figuratif, il y a pourtant un spatium plastique d’une tout autre nature, qui est d’abord un espace processuel, diégèse littérale du sensible et de ses métamorphoses, durée dont la lumière est la littéralité plutôt que la vérité...

On reconnaît la bonne critique à ce qu’elle fait sentir des œuvres, plutôt qu’à ce qu’elle leur fait dire. La lumière, mais l’esthétique en général, c’est ce qui échappe à la critique conçue comme repérage analytique. C’est ce qui en est par conséquent la pierre de touche. Quel est le drame de cette critique ? D’être sans esthétique. C’est pourquoi on ne peut poser la question de la lumière comme mode de dessin qu’à partir d’une critique tonale, modale, impressive, capable de littéraliser comme tels les processus sensibles qui font une œuvre. Si l’on va au bout du concept de lumière, il faut lui reconnaître une puissance génétique qui ne consiste pas seulement à révéler ou faire apparaître des formes préexistantes mais à les créer en même temps qu’elle les montre. La lumière n’est diégétique qu’à être déictique, mais elle n’est déictique qu’à être activité : ce qu’elle fait, elle le montre, mais elle ne montre rien sans le créer au moment même où elle le montre. Elle sculpte — sculpte la chose, ses monstres, et l’espace labyrinthique et obscur où elle saura non seulement surgir, mais surtout disparaître...

Dans Jeu de lumières Muñoz et Sampayo ne font pas de la lumière un sujet, un mode de contouration graphique ou le redoublement structural de l’un par l’autre : elle est écriture et dessin, inchoation de l’expérience elle-même, non pas révélation ou monstration du monde constitué mais tracé de ce monde. Jeu de lumières apparaît d’abord comme une œuvre de baroque moderne, avec ses labyrinthes statues et masques composant un jeu continuel de déplacements sans terme et de renvois sans référent, une sorte de miroir brisé qui serait son propre reflet, dont la lumière serait la seule image. C’est un livre qui joue à cache-cache. Mais c’est aussi dès le départ un livre diagnostic : le baroque y est comme aboli, étouffé, déceptivement rejoué par un baroque supérieur, un baroque romantique condamné à l’Histoire, et sous l’action duquel la chair du monde fond comme de la cire sous une lampe halogène. Quel est le problème, le problème esthétique ? Là où, dans le baroque, le monde était la Forme ouverte où convergeaient toutes formes dans le milieu diaphane de la représentation expressive, l’Histoire est devenue la nouvelle Forme rectrice enveloppant toutes les formes, la synthèse de toutes les synthèses qui ne produit plus de tout, mais seulement des stases intriquées, emboîtées et gigognes. Quand le baroque a été englobé par l’Histoire, il n’y a plus que des mémoires divergentes et antagonistes, que le récit historique axe et linéarise pour en refaire du continu, non plus un continuum sensible mais un continu d’énonciation. Jeu de lumières rencontre directement ce problème esthétique, cette impuissance expressive, et pose un tout nouvel enjeu en forme de diagnostic : recréer un Baroque par-delà sa capture historique, faire converger à nouveau les mémoires vers un temps d’amnésie plutôt que vers l’Histoire, dépasser les synthèses vers un tout esthétique et un percept pur qui soit fragment du temps — créer une image qui, ne pouvant plus être expression du monde, soit une pure impression sensible, un tout esthétique qui ne soit plus le tout de l’esthétique. Le problème n’est pas tant que nous ne croyions plus au monde — il semble au contraire que notre époque est celle du monde devenu nouveau pathos et nouvelle religion : le monde comme figure même de la pensée, horizon de toute perception et fonds de toute sensation, une sorte de mondanisme qui a pris la place noétique de l’humanisme ou de la théologie. C’est bien plutôt que nous ne sentons plus le monde, au moment même où nous y croyons le plus. Le problème plastique (plutôt que graphique) de Jeu de lumières, c’est donc de tracer un tout sensible, d’imprimer et sculpter un tout de lumière dans l’univers des formes et des figures, c’est de contracter le sensible dans sa lumière pour nous rendre capable de sentir et de voir par-delà l’Histoire, et en-deçà du monde. Ce tout, ce sera l’hologramme comme nouvelle forme d’art et fragment de temps pur, lumière en tant que lumière s’élevant à une paradoxale forme d’éternité finie : l’hologramme, c’est littéralement le tout comme tracer de lui-même, et le tracer d’un tout qui n’en cesse plus de finir. Non plus la totalité du monde ou une synthèse historique, mais bien une contraction sensible qu’on perçoit pour elle-même, sans plus la référer à une forme englobante (monde) ou une linéarité de synthèse (Histoire). Produire des hologrammes, des touts sensibles, est un problème concret, c’est le problème même de l’art et de l’esthétique, c’est aussi un problème germinal du point de vue du dessin : que veut dire une œuvre baroque dans un monde où l’on ne croit plus à l’harmonie du monde, où seule l’Histoire se donne à voir, où même les images sont d’abord des coupes d’Histoire, archives diachroniques et mémoires référées ? C’est la lumière qui constitue l’étrange rédemption de l’esthétique, non plus en tant qu’elle montrerait le constitué, mais en temps qu’elle nous trace le monde d’avant toutes les constitutions, en tant qu’elle est tracé du devenir même : la lumière va se voir dotée d‘un tout nouveau rôle, non plus montrer, mais tracer ce qu’elle montre en même temps qu’elle le montre. Très tranquillement, Munoz et Sampayo annoncent dès le titre qu’il y a non plus une multiplicité de lumières mais une plurivocité ou une pluralité modale de la lumière qui compose un seul jeu sensible, jeu du visible et des visions, jeu des mémoires partielles et des récits tronqués qu’il faudra dépasser dans une mémoire du monde et au-delà encore, vers une paradoxale mémoire du sensible qui est tout aussi bien mémoire de l’Amnésie...

La lumière, unique personnage de ce livre, seul acteur, scène en soi... Faire de la lumière une écriture et un dessin, en faire un mode de sculpture du sensible implique tout un travail sur les valeurs d’usage de l’image d‘une part, et ses valences graphiques d’autre part. Cela concerne particulièrement le noir et blanc. La valeur d’usage traditionnelle du noir et blanc ressortit au modèle eidologique (1) qui fonde la notion de ligne claire : noir et blanc y sont fonction du contour et de ses figurations-défigurations et se répartissent en clair-obscur selon une lumière distributive réfractée par degrés et diffractée par dégradés. Même la matière est alors constituée de contours, même les volumes sont des formes en trois dimensions sur lesquelles s’indexent le noir et blanc, répondant par là, jusqu’à la défiguration, à une forme d’illusion réaliste qui est d’abord un fantasme référentiel. Mais qu’en est-il du noir et blanc dans Jeu de lumières ? Étrangement, c’est chez Aristote qu’on trouve peut-être les meilleures manières d’esquiver la forme, la plus grande attention aux tératologies informes et aux monstruations brutales.
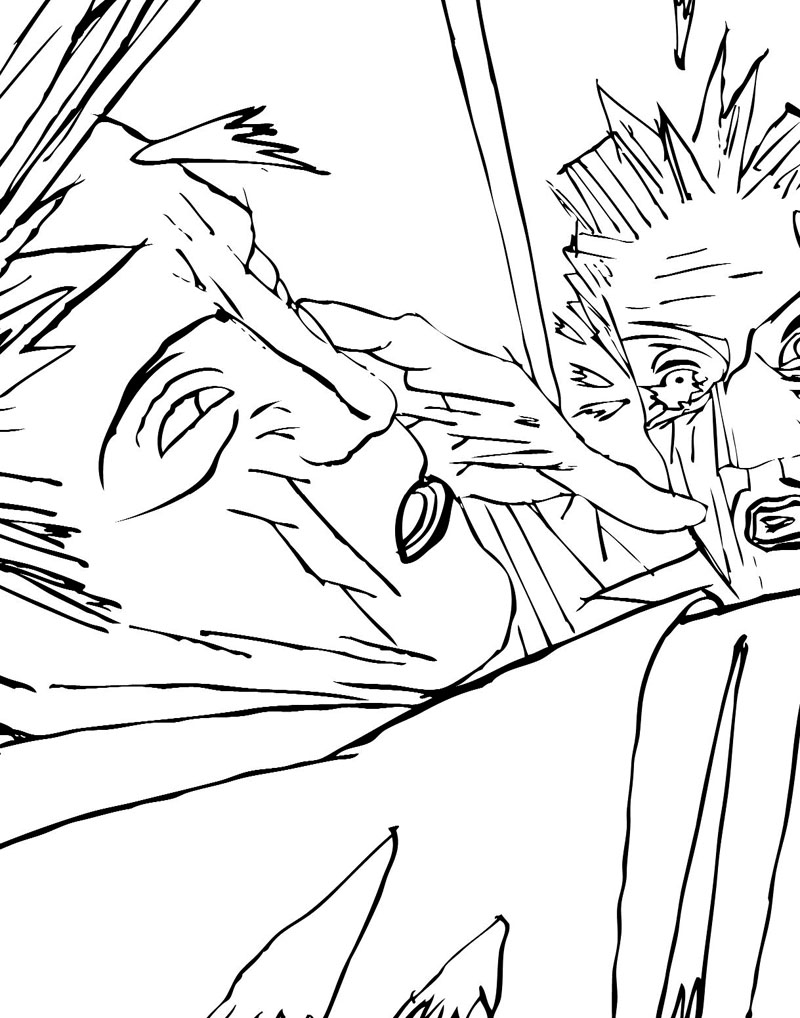
Aristote nommait ekstasis le passage du noir au blanc, le déport d’une essence formelle vers une contre-nature qu’elle ne recélait pas en puissance, et s’imposant à elle par un mouvement contrevenant à la physique : l’ekstasis est une monstruation du visible (2). Jeu de lumières répond plastiquement à cette logique extatique, c’est un extatisme de lumière où noir et blanc sont désattribués plutôt que substantiellement distribués, contractés plutôt que continués : c’est une photologie des formes et des extases qui joue sur des valences graphiques rendues visibles par le déport brutal du diégétique vers sa contre-nature, et qui vise moins à montrer qu’à faire sentir, à révéler qu’à esthésier. C’est bien du point de vue plastique et pas du point de vue graphique qu’il faut distinguer ces deux emplois du noir et blanc. Le noir et blanc extatique est effraction du tracé dans les formes ; ainsi le paysage nocturne vu est traité non pas par volumes en clair-obscur mais par plans séparés et étagés dont naît la profondeur ; et le ciel nocturne remémoré ou lu est blanc, mais les plans ne s’imposent plus verticalement, ils sortent du blanc par blocs qui constituent minimalement des plans. L’extatisme concerne graphiquement le noir et blanc mais diégétiquement tout ce qui se sent : tout devient monstre de soi-même, visages, souvenirs, mémoires, le temps lui-même passant de l’hologramme noir de l’incipit à l’hologramme immaculé qui fait l’ultime acmé du livre. Mais cet extatisme est surtout fonction d’une anamnèse généralisée où la mémorialité dicte la contraction sensible : la lumière vaut comme ekstasis des natures mais se montre comme passage d’une mémoire.
L’intrigue plastique de Jeu de lumières, c’est l’incorporation progressive des mémoires les unes par les autres, la mémoire individuelle passant dans la mémoire collective, celle-ci se contractant dans la mémoire du monde, et cette dernière à son tour s’incorporant dans une mémoire esthétique, qui est une paradoxale mémoire d’amnésie, mémoire du sensible en tant que tel : c’est là que la lumière culmine, c’est là qu’elle montre le sensible en tant que sensible, dématéralisé, arraché à ses formes et même à ses figures, devenu pure sculpture de clarté, tout fini, événement esthétique.

Le livre, le prisme
Il n’y a d’abord qu’un débord sans provenance et des rebonds sans terme, des arcs involués dont la tension dessine une profondeur encore inattribuée, de larges blocs griffés comme des éclairs horizontaux qui s’étirent et se courbent, zigzags blancs et rinceaux dans la transversale noire d’un mouvement sans mobile. Dès la première page de Jeu de lumières, la figure n’est pas distinguée, séparée, tranchée ou contourée, mais émanée : la lumière n’y fonctionne pas selon une logique de distinction formelle mais d’émanation par nuances et contrastes qui culminent paradoxalement dans un brutal mouvement de coupe. Lumière inindexée qui n’éclaire pas le monde mais le sculpte déjà comme un hologramme noir, un tout obscur retranché de la lumière. On n’imagine guère de commencement plus littéral que celui-là : il n’y a aucune instance derrière la lumière pour en dicter l’apparition, en ordonner l’existence. Tout s’y sculpte en même temps, la lumière, le lumineux, le rayon, l’obscur, son espace, et l’œil enfin... Cette page est un théâtre où la lumière entre seule sur une scène manquante, et en se contractant crée la scène, les rôles et les mémoires du texte : c’est le visible encore caché qui, en se créant un prisme, va par lui se rendre lisible, c’est la lumière qui, entrant dans le diégétique, s’y rendra déictique, mais déictique de ce qu’elle crée en le montrant. Tout est encore possible, rien n’est encore cadrable, ce n’est pas l’incipit d’une ligne narrative, c’est une genèse qui sort d’elle-même, une genèse ab nihilo, jeu de lumières dont émergent, en trois cases, trois pointes de prisme qui sont autant de persona. Munoz ne dessine pas la lumière mais la fait dessiner, de sorte qu’elle se montre elle-même dans ce qui n’est pas une réflexion, mais bien une contraction, non pas une réfraction ou une diffraction mais une confraction. C’est une lumière qui joue, un Fiat Lux un peu farce où la lumière a déjà plus d’un sens, et qui se déploie librement, pour elle-même et en son seul nom, avant d’entrer dans l’ordre des lisibilités figurales et des occurrences déchiffrables, avant de s’indexer sur le motif, celui d’une voiture roulant dans la nuit. La première page de Jeu de lumières est déjà une philosophie du dessin qui permettrait de distinguer non pas deux modèles, mais deux modes de dessin transversaux à différentes modélisations du tracé : le dessin eidologique, expressif par nature, et le dessin impressif, qui est plutôt dessin du flux et des conflux (W. James), dessin des mélanges et des crases informes dont les formes émergent : c’est le dessin qu’on dira crastique, dessin qui est contraction sensible du sensible, dessin littéral plutôt que figural. On a affaire ici à un type de dessin contractif, à une lumière de confraction : la lumière sculpte des linéaments plutôt qu’elle ne révèle des limites prédéfinies, elle ne se réfléchit pas sur des corps-écrans, mais s’incorpore des masses obscures.

La diégèse vient toujours d’un geste, mais le geste est déictique d’un sentir qu’on croit impossible : les premières cases de Jeu de lumières font le geste graphique infiguré du livre que la narration ne fera que rendre lisible, celui de sculpter la lumière sans jamais l’attribuer ni l’originer, pour y faire émerger des figures qui sont ses possibilités sensibles et pas des entités narratives. Jeu de lumières implique bien une intrigue, des linéarités graphiques et narratives, mais la problématique du livre, sa dramaturgie réelle est d’ordre plastique et esthétique — drame posé dès la première page comme un horizon gris : comment recréer cette confraction de lumière, une fois que celle-ci est passée par la figure et ses linéarités ? Jeu de lumières est organisé non pas en miroir, mais comme un trou noir : la lumière se déploie à un bout pour sculpter les figures, et on la retrouve à l’autre bout, comme sculpture de lumière. C’est pourquoi tout ce livre est un prisme, emmêlement de triangles à plusieurs dimensions, triangle des personnages et des mémoires, triangle des arts et triangle des lumières, qui ne se répartissent pas tant autour d’un centre organisateur qu’ils ne s’intriquent et ne se mêlent comme les pans d’un cristal brisé devenu matière à sculpture.

Triangle des mémoires
Jeu de lumières est un livre qui fonctionne non pas comme un cercle de cercle, mais comme une constellation de triangles entrecoupés, prisme éclaté dont les fragments se recoupent fragmentairement jusqu’à former un tout autonome, un tout sensible, un hologramme qui surgit par-delà la forme-livre. Dans Jeu de lumières, tout va par trois, mais c’est toujours trois + 1, ou plus exactement, trois + le tout. Il y a trois persona, trois positions, trois types de mémoire, auxquelles correspondent trois types de lumière régissant à leur tour trois arts, lumière du théâtre, du cinéma, lumière hologrammatique, chacune impliquant en même temps non pas un type, mais un mode de dessin, non pas une typologie mais une modologie graphique. À chaque type de mémoire correspond ainsi un régime de temps et une tonalité sensible traduite par un mode graphique.
Plutôt qu’une juxtaposition du théâtre, du cinéma et du hologramme, Jeu de lumières est donc une contraction de trois mémoires qui s’expriment dans ces arts. Trois types de mémoire se mélangent, que ne distingue pas une différence de nature ou de degré mais une différence de régime. Il y a d’abord la mémoire incarnée, mnémé, support physique des souvenirs engrammés, mémoire individuelle qui fictionne le passé pour faire du souvenir un récit vivable et qui agit par deux déformations fictionnelles : refoulement et fantasme. C’est la mémoire du représenté qui fait récit en sériant figurations et dénotations, en les rendant visibles comme constats et cas (3). C’est la mémoire-cinéma qui inscrit un récit sur un passé devenu écran et truque la réflexion par la fiction : sa lumière est projection, elle trace des contours, y soumet les formes, et c’est en contourant qu’elle déforme et refictionne. Cette mémoire est skiagraphique (4) : en elle le contour dicte la forme.

La seconde mémoire est impersonnelle, non pas support ou surface, mais opération remontant à un connu enfoui au fond des choses et des psychés : c’est la mémoire anamnèse, puissance de l’immémorial qui ne représente pas des cas mais qui est re-présentation de l’original incarné par les cas. C’est la mémoire-théâtre deux fois dramatique dont la lumière est scénographique, aura et émanation : le contour est émané de la forme, la forme se diffuse comme contour et aura. C’est l’anamnèse narrative, dramatisation et interprétation, expression et figuralité, qui incorpore la mémoire-récit fictive et figurative : mnémé est contractée dans l’anamnèse, le cinéma dans le théâtre, le contour dans l’aura. Jeu de lumières retrouve ainsi le theatrum mundi baroque, mais le théâtre y est contre-nature, ce n’est plus l’illusion comique et l’entr’expression des drames qui va jusqu’au cosmique, mais la falsification tragique et la co-déception générale : en guise d’original on ne trouve que des monstres, et sous la persona une grimace sans face comme un sourire sans chat. La diégèse sensible qui dicte l’anamnèse narrative c’est donc l’ekstasis du monde en Histoire : elle est sa contre-nature, sa tératologie, non pas sa défiguration, mais la monstruosité d’un monde paradoxalement représenté sans figure. Dans Jeu de lumières, les anamnèses sont maintenant soumises à la forme de l’Histoire, on ne se souvient pas d’une forme intemporelle ou d’un passé immémorial, on se souvient de l’Histoire, dans l’Histoire, par l’Histoire : il n’y a plus d’anamnèse qui soit mémoire du sensible ou mémoire de l’être. L’anamnèse est scindée : parce qu’on se souvient dans le milieu de l’Histoire, on ne saisit l’anhistorique (la forme, le trauma, le fait) qu’à travers ses occurrences dénotées. L’anamnèse ne saisit plus de Forme pure, elle la saisit dans un lignage, dans un cycle et une mémoire phylologique. Elle se fait par rebroussements brusques, retour du refoulé rejaillissant par flash, non pas linéairement mais labyrinthiquement. L’anamnèse écrit tout au présent, c’est le sens propre et le figural émanant comme faits du visible lu, c’est l’aura lumineuse émanée des corps par-delà le temps. C’est la mémoire-narration qui dicte le récit et ses visibilités, mais qui comme continuité lisible est déjà dictée par la diégèse. L’ultime mémoire est celle du monde, c’est Mnémosyne. Ce n’est plus la mémoire volontaire (mnémé) ni la réminiscence involontaire (anamnèse) mais une mémoration sans volonté, une mémoration avolitive. Elle ne visibilise pas des cas ni ne lisibilise des faits, elle sensibilise des touts (holos), elle mémore le sensible non comme passé mais comme avenir : elle écrit, fait mémoire de l’avenir — c’est ce qu’on peut appeler une graphamnèse. Mnémosyne, c’est la mémoire comme diégèse, passage continu du sensible qui dicte la narration et par elle le récit. Si le cinéma est mode de lumière dans mnémé, si le théâtre est sa modalisation dans l’anamnèse, l’holographie sera sa modélisation dans mnémosyne.

Il y a donc trois mémoires, se contractant les unes dans les autres selon un enveloppement graduel : la mémoire individuelle se contracte dans l’anamnèse valant comme mémoire historique et incarnée, celle-ci se contractant à son tour dans la mémoire du monde. Et de la même manière, le cinéma est contracté dans le théâtre, et ce dernier par l’holographie, seule à même de constituer des touts. Tout le problème de Jeu de lumières consiste en ceci : produire un tout qui dépasse la mémoire individuelle des faits et la mémoire collective des situations, un tout qui soit d’abord un événement pur, un moment du devenir esthétique (non plus la mort comme fait, non plus la mort comme fatalité collective, mais la mort comme extase sensible, sortie de la vie hors d’elle-même ou la mort en tant que mort). Et de la même manière, il va falloir dépasser des lumières partielles pour aller vers la lumière en tant qu’elle-même, dépasser la lumière projetée et contourante du cinéma, la lumière scénographique et émanée du théâtre, dépasser même la lumière sculpturale de l’holographie pour s’acheminer vers une lumière qui soit plutôt pangraphie. Dans la lumière cinématographique de la première mémoire, le départage du clair et de l’obscur se fait sous la forme du rai (focale de lumière, et degrés de réfraction) ; dans la lumière théâtrale de l’anamnèse, ce départage se fait sous la forme de l’aura (diffusion de la lumière, et diffraction par dégradés). Dans l’hologramme, on réintroduit une lumière sombre, une lumière noire, de sorte qu’on n’atteint pas l’eidos (la forme) de la lumière mais la lumière faite eidos à travers un volume qui l’exprime : ce n’est pas la lumière en-soi, c’est un soi de lumière et un soi de la lumière. C’est par le trait que la forme passe de l’espace plan au volume, alors que la lumière-rayon du cinéma demeurait superposée à la surface plate de l’écran (lumière à une dimension), et que la lumière théâtrale opérait dans l’aura la disjonction de la figure et du fond (lumière à deux dimensions). C’est seulement dans l’hologramme comme série de tracés mobiles que la forme atteint la troisième dimension du volume, et s’y dissipe. On y atteint la lumière pure mais seulement comme sculpturalité : la lumière en tant que telle y est visible mais invoyable, elle y est monstration montrée devenue pur apparaître. La lumière en tant que telle, on ne l’y voit ni ne l’y lit, on ne peut que la sentir diégétiquement : dans le cinéma, la lumière est visible dans des figures (skiagraphie), dans le théâtre elle est lisible dans des situations (scénographie), dans l’hologramme elle est sensible, mais c’est encore au crible d’une sculpture, et l’on n’y saisit la lumière qu’à travers autre chose qu’elle-même — le volume et la masse d’un événement vivant. Mnémosyne devra donc fendre la sphère de la représentation, dépasser l’holographie vers une forme supérieure de pangraphie, passer du soi-lumière à la lumière en tant que telle. Comment un tout-holos se contracte-t-il en graphie du tout (pan) ? Comment mémore-t-on la lumière ? Il va falloir, jusqu’à l’oubli, se souvenir plus loin, là où les mémoires tombent et où les lumières meurent.

Trinité de la mort
Au cœur de la lumière, il y a un mort. C’est Filippo qui gît, invisible, illisible, insensible, dans un nulle part sans mémoire. Il était là dès le début, dans les rinceaux blanchis et les éclairs sans fond, traçant sa mort à même rien. Jeu de lumières est une sorte d’enquête policière, mais dont l’objet n’est pas tant le fait ou le souvenir que la mémoire elle-même devenue sa propre diégèse : la question que pose le livre n’est pas — qu’est-ce qui s’est passé — mais bien plutôt — comment en vient-on à se rappeler ce qui s’est passé tel qu’il s’est passé ? Comment en vient-on à le vivre en retard, comment la virtualité du présent s’actualise-t-elle en différé, comment incorpore-t-on le souvenir pour s’en faire un présent qui reste pourtant contemporain du passé ? Le problème du livre, ce n’est pas la mort ou le meurtre, pas plus leur impossible représentation qui ne fait que bégayer le vieux et fatiguant pathos de l‘ineffable ; le problème du livre, c’est l’image littérale de la mort, plutôt que sa vérité comme fait, signification, dénotation, ou condition. C’est que narrativement, le dénouement lui-même tient en peu de mots : nous sommes au cœur des années 30, sur un tournage, dans un train fonçant dans la nuit ; Haffner et Filippo y tournent une scène devant une porte ouverte où le paysage file en éclairs blancs et noirs — tout va très vite et tout se cristallise, amour, rivalité, le drame avale le script et Haffner change de rôle, met son masque tragique et pousse Filippo qui se fracasse sur un pylône, sang étoilé dans la nuit blanche. C’est le constat du récit, le fait de la narration, un tout de la diégèse. Haffner tue Filippo par jalousie, pour l’amour de Gloria. Et c’est pourtant cette mort qui sera celée et refoulée au terme d’un sinistre marché : les fascistes italiens fermeront les yeux sur cet assassinat si Haffner devient leur égérie. Alors Filippo meurt, mais sa mort n’est même pas une ombre tant qu’on ne l’aura pas vue, lue, sentie : il lui faudra mourir trois fois, mêler ses morts aux mémoires pour devenir de la mort qui passe à tous les temps de tous les cas. Chaque mémoire va mettre cette mort dans sa lumière : mnémé la rend visible, l’anamnèse la rend lisible, mnémosyne la rend sensible, c’est-à-dire l’esthésie. Un livre n’est jamais l’intrigue du récit ni le drame narratif, mais diégèse du sensible qui contracte ce qu’on voit et ce qu’on lit dans une nouvelle manière de sentir, dans un sentir nouveau : Jeu de lumières est cette diégèse, c’est le mouvement de trois mémoires s’incorporant esthétiquement une mort. C’est pourquoi la mort de Filippo y sera trois fois rejouée, cinématographiquement, théâtralement, puis holographiquement. C’est comme une guerre, non pas une guerre des mémoires, mais des modes mémoriels. La mort de Filippo est d’abord le fantasme de mnémé, souvenir deux fois cinématographique que le récit figure et dénote, constat pur, accident réécrit qu’on ne sait pas lire : c’est simplement, au loin, une mort passée. Sa mort est ensuite un souvenir rejoué et remémoré dans l’anamnèse, mort qui se donne à lire, au présent, comme drame vivant des corps. Le cinéma s’y contracte en sorte que le film même devient décor du drame et théâtre dans le théâtre : c’est la mort qui se passe. La troisième mort ne sera pas un rejeu idéel de son fait mais la saisie sensible de son tout : elle est holographique, conjoignant dans un même cadre les deux protagonistes, Haffner vivant et Filippo mort, qui sont tous deux hologrammes d’hologramme : Filippo ressuscite, mais cette résurrection est la mort même d’Haffner. Cinéma et drame s’y mélangent et l’on y sent le tout de la situation : de la mort passe.

La mort de Filippo devra être vue lue et sentie pour être enfin montrée et mémorée dans le monde, palpable comme un tourment et tangible comme une honte : elle cristallise tout, en une contraction finale des lumières et mémoires. La mort de Filippo ne se réfléchit pas dans la conscience d’Haffner, mais se contre-nature dans sa mort à lui. La preuve que le hologramme est un tout sensible plutôt qu’un fait représenté ou qu’une réminiscence montrée, c’est qu’il agit : la mort holographique de Filippo provoque celle du Haffner réel et c’est, littéralement, la mort devenue lumière qui tue le meurtrier lui-même avec des décennies de retard. Étrange mélange de vie et de mort, d’image et d’aveuglement... La mort de Filippo dans la nuit noire du cinéma s’extasie dans la mort d’Haffner tramée de pure lumière holographique, la mort s’extasie dans la mort et y prolonge le cycle du monstrueux : Haffner tuant Filippo a aussi tué Gloria, comme par un contrecoup lointain, un ricochet du meurtre, une réfraction du crime. La mort s’est extasiée deux fois pour revenir au meurtrier, au monstre qu’elle l’a par trois fois fait devenir. C‘est un cycle de justice, une justice du temps qui s’impose aux mémoires. Le juge, c’est Jean-Pierre : il est le petit-fils de Filippo, son anamnèse vivante et vengeresse sculptant le meurtre dans la lumière pour le montrer au monde. Jean-Pierre rétablit les lignages, met l’ordre dans les mémoires par une lumière qui montre et qui crée ce qu’elle montre : c’est la mort, qui crée la mort en la montrant. Une mort est vue, la mort est lue, la mort est sentie. Alors tout revit et s’effondre, la chute de Filippo se mêle à celle d’Haffner, l’une blanche et l’autre noire, ekstasis des deux morts qui n’a rien d’un miroir mais tout d’une réversion. C’est la crase finale dans l’holographie quand, mourant, Haffner voit tout en hologramme, et s’y fond à son tour. Le paradoxe de l’hologramme, c’est qu’en détourant la lumière, en la sculptant, il ne montre des figures que pour nous faire d‘abord sentir l’immatérialité sensible de la lumière, son corps : plus c’est sensible, plus c’est immatériel, voilà qui fait le paradoxe central de l’esthétique et de toute œuvre d’art.

Dans l’hologramme final, même la mémoire du monde est dépassée vers une étrange mémoire du sensible qui est tout aussi bien amnésie : la mémoire n’est plus répertoire de faits signifiés et dénotés, elle n’est plus rappel des drames, ni même le présent actualisé du monde. C’est l’oubli, fondu au devenir, l’oubli du constitué qui nous plonge dans le processus — l’esthétique en elle-même. L’ekstasis finale est celle du livre même, et de la mémoire : non pas oubli de quelque chose, mais amnésie du constitué qui nous met directement en rapport avec un flux sensible sans passé ni avenir, un présent qui tient tout entier dans sa pointe et ne se charge d’aucun souvenir. On a dit plus haut que le baroque nous mettait en contact avec le monde comme totalité ouverte, et que l’Histoire nous rapportait à une synthèse de synthèse dans le milieu linéaire de la dialectique conçue comme récitation. L’acmé finale de Jeu de lumières nous met plutôt en contact avec l’esthèse, le fond sans fond de l’esthétique, son jaillissement statique et continué. La lumière sculptée qui constitue l’hologramme nous donnait accès au domaine de la perception pure, elle nous faisait percevoir immatériellement l’événement de la mort. Mais derrière cette lumière sculptée de l’hologramme, il y a la lumière en tant qu’elle sculpte, lumière qu’on ne voit pas, et qu’on ne peut que sentir, sentir à l’œuvre comme activité sourde invisible et bruissante qui répartit les masses, organise les contours, trace la mort à même le présent. C’est la lumière comme pangraphie, qui nous donne accès non pas à la perception pure, mais au sentir en tant que tel. C’est la lumière qu’on sent à l’œuvre non pas en tant qu’elle nous fait sentir quelque chose, mais en tant qu’elle nous fait sentir qu’on sent : elle esthésie le sensible, nous plonge dans cette esthèse qui ne tient qu’à son nuancement, contraste sur contraste et gris sur gris sur gris de la lumière sensible, enfin redevenue jeu...

Retrouvez sur le site de Pré Carré — http://precarre.rezo.net/ — les textes de référence avec lesquels nous avons travaillé, dans la rubrique Archives. Les grands textes classiques sont disponibles en binlingue sur le formidable site http://remacle.org/