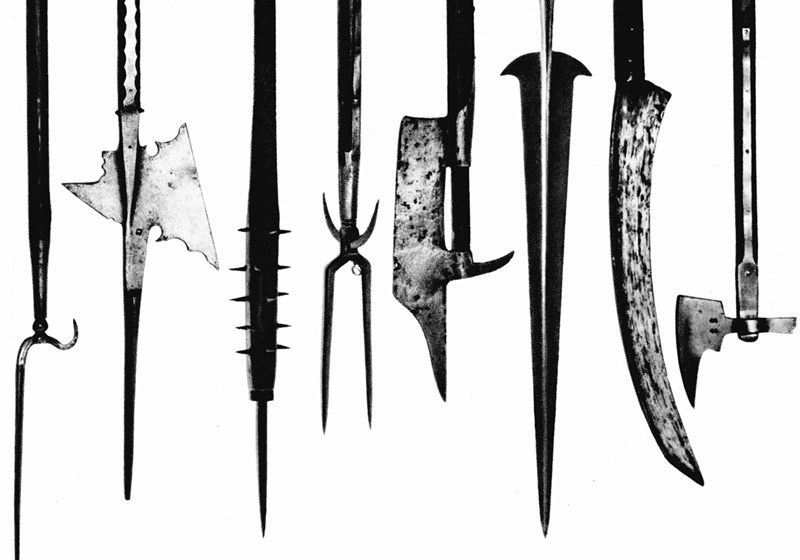Qu’est-ce que la bande dessinée ?
Chrisset Rostian
par Lucas Taïeb
On ne sait jamais quoi penser d’un livre. Le mieux serait de ne pas en parler, tant le bavardage est l’une des plaies de notre époque. Il faut cependant s’atteler à la tâche, en se montrant réceptif aux divers échos qu’il a pu faire éclore en nous. Mais comment retrouver l’écheveau de sensations qui se sont agglutinées autour de notre lecture impromptue, sans cesse interrompue, côtoyant tant d’autres perceptions quotidiennes (un café en terrasse, le souvenir d’un autre livre, d’une autre rencontre, réelle ou fictive) ? Mais il faut s’atteler, donc ; chaque jour, des livres tombent dans la boîte aux lettres, signaux que l’on doit saisir, si ce n’est au vol, du moins à temps, selon leur temps propre, lorsqu’ils auront décidé de nous parler. La sélection mentionnée ici s’est faite au gré du vent, des occasions, des rencontres (la lecture est-elle autre chose qu’une rencontre ?).
Nous avons, par ordre d’apparition — ne sous-entendant aucune hiérarchisation, surtout pas, l’auteur de ces lignes se tenant éloigné de toute propension au classement — : Ah bah ouais mais putain va pisser connard de Ruppert et Mulot, De nouveau la vie de Joann Sfar, Un peintre de cinéma (tome 1) de Catherine Meurisse & Fabien Vehlmann.
Il est difficile de déterminer ce qui nous décide enfin à prendre un livre en main, à le soupeser, l’effeuiller — expression que j’ai toujours préféré à feuilleter, évoquant de façon trop appuyée un feuilleton qui n’est pas toujours au rendez-vous ; en l’occurrence, ce fut un appel : tandis que je reparcourais la biographie de Jacques Millier, travail sans commune mesure qui fut l’œuvre patiente, exigeante, obstinée d’Éric Ribout, le téléphone sonna ; c’était justement Éric, qui m’entretint avec ferveur de sa dernière trouvaille concernant Blassard (autre figure, davantage dans l’ombre, du mouvement Fissure dont on dit que George Herriman entendit parler une fois) ; Blassard, Ribout, le cadre était là, tous deux s’étant fait remarquer en 51 par leur exploration culottée — mais tout en délicatesse, aplats à pas feutrés loin de tout effet spectaculaire — d’un certain argot délaissé : comme en écho à ces éclats qui ont encore aujourd’hui le charme de l’inattendu, c’est avec un intérêt aiguisé que je me plonge dans la nouvelle exploration impertinente de Florent Ruppert et Jérôme Mulot. On ne présente plus les deux comparse, surtout depuis leur dernier « succès » — terme journalistique que je persiste à vouloir détester —, Ah bah carrément tu fais chier, où les innovations formelles s’entremêlaient d’une peinture toute en pudeur et lucidité du petit monde mondain de l’art parisien.
Avec Ah bah ouais mais putain va pisser connard, nous sommes désormais dans d’autres bas-fonds (mais « l’art ne vise t-il jamais que le fond de toutes choses basses ? », comme le répétait souvent Henri Zortiz du temps où Blassard, Ribout et moi le côtoyions) : c’est ici une faune urbaine qui se déploie sous nos yeux, en voie de « clochardisation » comme pourraient le dire certains sociologues. De sociologie, il ne sera pas question ici fort heureusement, mais bien davantage de forme : qu’est-ce en effet que la forme de la rue, de son langage ? Première double page : l’œil est pris dans une succession de petits carrés (sont-ce des cases ?), se perdant progressivement dans une masse de traits et de mots faisant sens (on semble lire « Bah tu sais quoi tu peux aller niquer ta mère sale pédé »). Qui d’autre que nos inséparables jeunes duettistes pouvaient réussir, si ce n’est l’exploit — point de futile « exploit » accompli dans un livre de ce nom, mais une recherche de tous les instants, patiente, obstinée —, du moins la faculté de faire saisir en un même mouvement (traits, mots, figures) les atours et expressions de la cruauté citadine contemporaine ? On pense bien sûr à Riad Sattouf, mais pas seulement, aussi à Marc Tamplert, trop tôt disparu (une anthologie lui sera bientôt consacrée chez Falmel, me confiera peu après Yves Flarx, que je rencontrai chez Klost avec Ribout, sans Blassard cette fois-ci).

Tout écho en annonce un autre : lorsqu’on tire le fil, vient la pelote au complet (une image qui me revient toujours dès que la neuvième note du concerto anonyme entendu pour la première fois chez Hassan Haj résonne — elle coïncida avec ma découverte de l’œuvre de Pouvel !). Tandis que je levais à peine mes yeux du livre précédemment évoqué — mais pourquoi évoqué ? Plutôt cheminé, si je puis dire, comme du bout des lèvres, de loin en loin, sans bavardage ni nostalgie mais certes avec mélancolie —, j’entendis le livreur revenir (bien entendu, ce n’était pas le même, le système postal étant désormais une hydre aux multiples uniformes concurrents, pour le plus grand plaisir de l’auteur de ces lignes, conscient néanmoins que ça ne fait pas celui de la planète !) : surprise, il amenait la dernière production d’un auteur dont je me suis tenu loin depuis quelques années, Joann Sfar. Que dire de De nouveau la vie — car c’est bien cet ouvrage que j’ai extrait de son enveloppe à bulles ? Il n’est pas aisé d’en dire grand-chose, comme il n’est guère aisé de dire grand-chose de quoi que ce soit. Cependant, pour comprendre ce qu’un « journaliste » (ou pire, un « critique » !) aurait tendance à désigner comme un « revival » (sic), il me faut évoquer notre dernière entrevue. Tandis que j’effeuillais avec curiosité le dernier numéro de la revue Critico-BD dans lequel Joann avait eu l’amabilité de me convier à illustrer de mes mots (ou plutôt de mes signes verbaux, se tenant à distance de tout « discours » appuyé, comme se retirant petit à petit, de loin en loin) son dernier conte graphique, il m’avoua (tenant entre ses mains le dernier tome en date de l’anthologie des œuvres de Simon Coquard, dont peu de monde sait qu’il est friand — on n’en jurerait pas !) : « Tu sais, Chrisset (sic, car paraît-il que tel est mon « état civil » !), si je devais revenir à L’Association, je ferai une sorte de confession épique ». Confession épique : cela décrit bien ce qui se joue ici, entre ces pages (mais sont-ce des « pages » ?) ; s’étant émancipé du bavardage cabotin dont il nous avait récemment habitué, J. Sfar — telle est semble-t-il son initiale, apparaissant en relief sur la couverture toilée, expérience tactile en filigrane — nous livre ici son quotidien récent, fait de déceptions institutionnelles et de mésaventures médiatiques. On aurait beau jeu de réduire ce « récit de soi » — mais en est-ce un ? « Récit » sans aucun doute, qui parle bel et bien de « lui », si ces mots ont un sens, mais pourquoi « récit » + « de soi » équivaudrait à « récit de soi » ? — à son « résumé », exercice dont la « presse », bien plus souvent nostalgique que mélancolique, est friande ; or, point besoin de « dire » ici ce qu’il « se passe » ou même « se dessine », tentons à la fois plus modestement et plus profondément d’entre-voir : entrevoir les possibilités qui naissent là, se font sentir avec joie sous le trait, ce trait peu descriptible qui nous avait manqué depuis quelques livres moins incarnés. Nous avons entrevu et cela n’arrive pas si souvent que ça dans la production contemporaine (du moins dans ma boîte aux lettres). Point barre.
Le troisième ouvrage dont je choisis ici-même de traiter est le premier d’une série annoncée comme une trilogie. Certains de mes camarades plus investis dans le « milieu de la BD » — tandis que je ne suis pour ma part d’aucun « milieu », plutôt à la marge, en retrait, de passage, hantant les lieux pour mieux m’en nourrir sans sentiment d’aliénation, comme dirait l’autre — me disent que le scénariste est connu (pour ma part, je ne connais que ce que je reconnais, comme disait à peu près Ribot commentant les carnets de Jean-Yves Ursalle dont j’avais discuté il y a de cela quelques années avec Balousian, à l’époque proche de Forgowski qui nous recevait souvent au milieu de sa collection d’anciens numéros de Métal Hurlant). Quant à la dessinatrice, j’apprécie son trait sensible. Que dire alors sur Un peintre de cinéma ? On pourrait déjà recopier le « pitch » de l’éditeur : « Justin Flaviel fut un réalisateur hautement graphique. Quoi de mieux que la BD pour en célébrer la carrière, hein ? ». On pourrait ensuite « classer » (cette manie contemporaine d’érudits voire d’universitaires, dont je me suis toujours tenu loin) ce livre dans la catégorie des « biographies ». Mais laissons faire le mouvement des mains qui soupèse les feuillets après leur sortie de l’enveloppe : les mains voient des dessins, des textes, des phrases. Il est sans conteste question d’un personnage qui a réellement existé et dont on nous narre les pérégrinations réelles avec émotion et humour. C’est ce que pourrait dire un amateur sans distance, une sorte de « gobeur », comme les appelait de façon polémique François Klotz lorsqu’il tenait les rênes de la maison d’édition qu’il avait héritée du frère d’un ancien collègue de la radio dont j’ai oublié le nom. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Je ne suis pourtant pas nostalgique, loin de là ! Vous l’ai-je dit ? Je serais plutôt mélancolique et c’est ce que j’ai trouvé dans cet opus (voilà, je retrouve le fil !) : le lecteur se rend compte qu’il assiste (mais discrètement, comme de façon réticente, de loin en loin, tout doux tout doux) à une bande dessinée se proposant de raconter comme un film le destin d’un auteur de film qui filmait comme il aurait dessiné ; la boucle en abyme est bouclée, cela laisse une drôle de sensation amère, on se rend compte — ou l’on espère ? — qu’on avait bien fait de ne pas être rebuté par le classicisme apparent mais qu’on ne sait pas ce que l’on est venu chercher en choisissant de se poser dans ce fauteuil, on ne sait pas s’il fallait être convaincu par les quelques amis qui nous disaient que c’était à lire, ça laisse un curieux goût gênant, solitaire. Mais on va se forcer à penser que ça nous a plu, qu’on sait quoi en dire ou à peu près. Mais un livre est-il vraiment fait pour qu’on en parle ?
Les trois sont à L’Association.