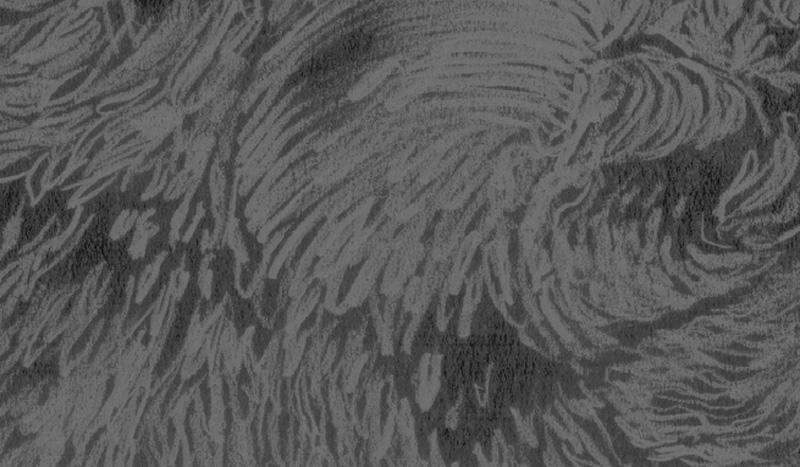
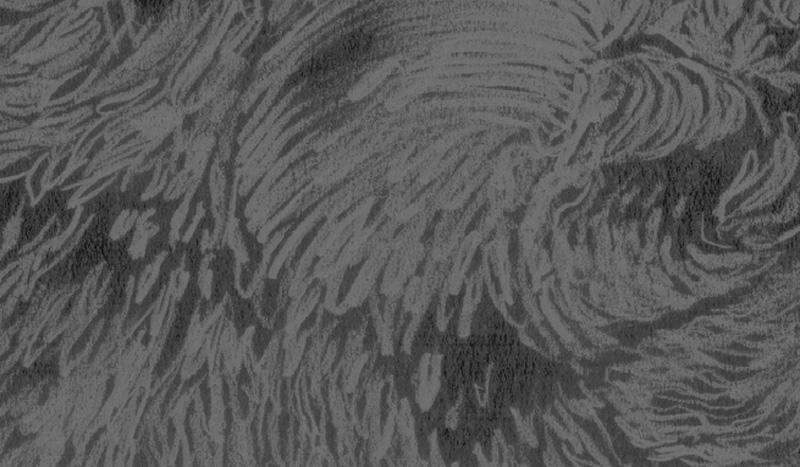
Dessiner — 6) L’instant, l’étendue
par L.L.de Mars
Suivons
dans ses détails le long procès moral de la couleur, et
invitons à se produire devant nous l’invraisemblable
procession des procureurs et les faibles rangs de la défense :
parmi les premières formulations disponibles d’une
accusation multimillénaire, nous trouverions celle par
laquelle le fameux Livre X de la
République
fait exposer à Socrate, pour Glaucon, l’enfantillage et
la fausseté constituant le monde des images peintes ; nous
devrions également écouter la voix du Gorgias
pour la sanction qu’il fait tomber sur la couleur et ses
artifices – cosmétique – et qui voit se raffermir
son couplage théorique ambigu avec le discours : c’est
le nouage du Pharmakon
qui, depuis Empédocle (notamment dans son Fragment
23), tient ensemble théoriquement, politiquement, éthiquement,
le champ sémantique de la peinture et celui de la rhétorique.
Serait évoquée ensuite la pureté imaginaire de l’atticisme : en son nom, Pline s’afflige de la non moins imaginaire décadence de la peinture qu’il appelle asianiste. Les barbarismes qui entraînent sa fureur étaient peints, pourtant, avec la même vigueur que ceux qu’il déplore à Rome dans le palais de Pella en Macédoine. Et l’abondance de décorations qui illustre sa fin d’un monde est généreusement peinte, à la naissance du même monde, dans l’Agora d’Athènes au Ve siècle. Dans le livre XXXV de son Histoire naturelle, opposant colores floridi et colores austeri, il décrit la vulgarité bigarrée du style Alexandrin, ses couleurs impures, ses illusionnismes. Écoutons ses arguments, déjà très largement techniques : « C’est avec quatre couleurs seules, le mélinum pour les blancs, le sil attique pour les jaunes, la sinopis du Pont pour les rouges, l’atrament pour les noirs, qu’Apelle, Échion, Mélanthius, Nicomaque, ont exécuté des œuvres immortelles, peintres si célèbres, dont un seul tableau s’achetait aux prix des trésors des villes. Aujourd’hui que la pourpre est employée à peindre les murailles, et que l’Inde nous envoie le limon de ses fleuves et le sang de ses dragons et de ses éléphants, la peinture ne fait plus de chefs-d’œuvre. Donc tout a été meilleur quand les ressources étaient moindres. » Au VIe siècle, Grégoire défend les images auprès de Serenus, l’évêque iconoclaste de Marseille ; il ne s’en tient pas moins, pour son commentaire sur le Cantique des cantiques, à cette étrange réserve devant la couleur : « Nigaud, celui qui s’attache aux couleurs de la peinture au point d’ignorer les choses qui y sont peintes » (1) ; au même moment Isidore de Séville défend une position enjouée dans ses Étymologies en proposant celle-ci, copieusement glosée jusqu’au XIIIe siècle : « On dit que les couleurs sont un effet de la chaleur du feu ou du soleil » (2). C’est qu’entre une cause lumineuse ou une cause matérielle, qu’il s’agisse d’étymologie ou de métaphysique, les qualités morales de la couleur seront âprement évaluées.
De Claude, évêque carolingien de Turin iconoclaste, à Le Brun, cofondateur de l’Académie Royale (« la couleur dépend tout à fait de la matière », dit-il), les contempteurs de la couleur, qu’il s’agisse de disputer sa présence au temple ou de subordonner son éminence dans la peinture à celle du dessin, la rapporteront à l’empire de la matière. La couleur occupa une large place dans la querelle opposant, au XIIe siècle, Cluny à Cîteaux devant cette axiologie de la pureté régulière qui fit programme pour un joli bout d’histoire monacale ; parmi ceux que Pastoureau divise en chromophiles et chromophobes (qui redoublent, en courant de Léon III à la Réforme, la longue histoire de l’iconoclasme et touchent sans doute à sa vérité substantielle) s’élèvent des voix centrales dans ce procès : Bernard de Clairvaux s’oppose au De consecratione de Suger quand il écrit, dans ses Apologies : « À quoi bon, dans ces endroits, ces singes immondes, ces lions féroces, ces centaures chimériques, ces monstres demi-hommes, ces tigres bariolés » ; il choisit, lui, de relier étymologiquement color à celare – cacher – et ravive l’idée d’une duperie fondamentale de la couleur, se lançant dans de longues harangues sur les couleurs et les étoffes des moines. Dans ses Statuta on lit : « Les vitraux seront blancs, sans croix ni peinture. Pas de sculptures, ni de peintures dans les églises ou autres locaux des monastères : elles gênent trop souvent la méditation et la discipline. Pour les livres liturgiques, ni ornements, ni couvertures recherchées. Pour les manuscrits du scriptorium, les lettres initiales seront d’une seule couleur et sans ornements ». Pastoureau dit de lui : « Cæcitas colorum ! telle est l’extraordinaire originalité de Bernard, qui voit dans la couleur non pas du brillant mais du mat, non pas du clair mais du sombre. La couleur n’éclaire pas, elle obscurcit, elle étend la part des ténèbres, elle est suffocante, elle est diabolique. S’il tolère parfois une certaine harmonie monochrome, éventuellement construite sur un camaïeu, il rejette tout ce qui relève de la varietas colorant, comme les vitraux multicolores, l’enluminure polychrome, l’orfèvrerie et les pierres chatoyantes. » Pour Suger, la couleur est un fragment de lumière divine et sa nature morale est touchée par sa grâce ; dans un de ses vers, il écrit : « Notre pauvre esprit est si faible, que ce n’est qu’à travers les réalités sensibles qu’il s’élève jusqu’au vrai ».

Au XVe, Alberti, à la fin du livre VIIe du De re ædificatoria affirme que les anciens faisaient aux temples des statues de marbre blanc, à même de leur donner la figure de l’éternité ; il entérine par là les marottes idéalisantes de Pline et anticipe les guerres chromatiques de l’archéologie du XIXe jusqu’à leur vocabulaire...
De
la forme prise plus tard par la concurrence théorique et
morale des couleur et dessin qui fissure l’espace pictural et
politique entre Florence et Venise, nous avons le passionnant
commentaire de Dolce, le Dialogue
sur la peinture intitulé l’Arétin
: il y raille les recours expressifs de la généalogie
maniériste, attaque Michel-Ange dans la faiblesse criante de
son chromatisme, sanctifie la puissance du Titien par la couleur et
retrousse les catégories morales et théoriques de
Vasari.
Au XVIIe siècle, autour de la création de l’Académie, notre procès prend un tour rocambolesque et batailleur dans la querelle des coloris, afin d’établir la puissance doctrinale destinée, du dessin ou de la couleur, à emporter l’institution royale. Cette affaire, que je résume ici, est largement commentée :
d’une part, le duc de Richelieu, jusque là important collectionneur et admirateur convaincu de Poussin, se convertit, avec autant de vigueur (et d’investissements) au rubénisme ; en découlent des problèmes de définition théorique pour l’Académie qui enseigne la suprématie du dessin (l’Académie préservait les bases de ses enseignements et craignait toute menace théorique susceptible de fendiller son statut d’Académie d’arts libéraux), et des angoisses pour ses peintres que, jusque là, le duc collectionnait.
D’autre part, Roger de Piles publie – et préface – la traduction d’un poème latin – De arte graphica – par Dufresnoy, et il en fait le socle d’une campagne coloriste pugnace. Ses Conversations sur la connaissance de la Peinture ne sont pas encore publiées que la chicane est déjà en marche. D’ardents échanges d’écriture commencent : lettres, opuscules, placards, agitent et perturbent la marche de l’Académie. Les coloristes engagent les hostilités avec les premières et secondes Lettres d’un Français à un gentilhomme Flamand qui établissent la suprématie absolue de Rubens sur toute peinture ; une seconde lettre se fout copieusement des poussinistes, mettant en scène deux défenseurs du dessin malhabiles tentant d’écorcher le succès de Rubens ; les poussinistes ripostent, évidemment, en moquant la prétention édifiante du cabinet Richelieu, sa valeur, sa centralité ; par d’autres lettres ils s’en prennent directement à Roger de Piles. De son côté, son Dialogue sur le coloris détermine l’expression – physionomies et théâtre gestuel – dans des limites rhétoriques et artificielles : par son bannissement du territoire pictural, il se rapproche de l’analyse de Dolce et ouvre à une réflexion sur une autre puissance expressive, celle de la couleur (expressivité qui deviendra, au XXe siècle, hélas, son tombeau).
En effet, cette guerre de placards par lesquels poussinistes et rubénistes se déchirent, les accule à exposer, par des livres ou par les conférences de l’Académie (prises de paroles pour lesquelles l’Académie avait été créée mais auxquelles jusque là les peintres rechignaient) plus clairement et frontalement leurs lignes théoriques. Même si les comptes-rendus des conférences semblent largement retouchés pour satisfaire la lecture officielle de l’Académie (Guillet, qui rédige les notes, caviarde gaillardement les défenses de la couleur dans l’éloge de la Vierge au lapin du Titien), on peut néanmoins suivre leur cours : un discours de Blanchard, agaçant les poussinistes, secoue assez Le Brun et ses proches pour que soit jugée nécessaire une correction de tir théorique, par un contre-discours de Champaigne dont l’importance est cruciale dans ce procès. Elle va enflammer la querelle : le 12 juin 1671, il tire prétexte d’une lecture de La Vierge à l’Enfant avec saint Jean de Titien pour finir sur un éloge de Poussin : « quoiqu’il ne s’y fût pas abandonné comme à l’unique sujet qui lui échauffait le cœur, néanmoins il fit une course de quelques années dans la carrière des coloristes ; mais s’étant détrompé, il revint d’une telle façon qu’il a dit hautement depuis que cette étude unique n’était qu’un obstacle visible et un écueil inévitable aux jeunes gens pour parvenir au véritable but de la peinture ».

Avant
même que ne soit posé le discours en moyen descriptif et
explicatif de l’image, il précède, déjà,
le regard porté sur le monde des choses par les cadres
noétiques qu’il dessine... Nous voyons comment ces
aménagements sélectifs du regard rendent Champaigne
aveugle à sa propre titianité – lui, l’immense
coloriste des chairs comme des nuées, peintre de la
coexistence des impossibles dans des espaces où l’italien,
le flamand et le français s’agencent sans heurt,
coulissent, se répondent, s’ordonnent pour se faire
saillir respectivement ; il ne voit chez le Titien que la trahison
d’un ensemble de règles auxquelles il n’a pourtant
aucune raison de le soumettre, pour le mettre en défaut.
Comment peut-il ne pas voir qu’il s’y réduit
lui-même ? Son enjeu est stratégique : réorienter
le regard vers Poussin. Il réduit par ce choix même
injustement Poussin à des variables rhétoriques et
architectoniques, à une excellence de l’invisible comme
promesse de la peinture. Poussin qui peignit d’incroyables
bouillons de verdure ténébreuse, arrières-monde
de peinture pour de chétives créatures noyées...
La variable architectonique que compose la solidité du dessin,
rigueur et justesse de son homéostasie, prend la même
place morale et conceptuelle que la variable rhétorique de la
certitude, de la régulation, de l’ordonnancement,
c’est-à-dire celle de l’idea
redéployée en ses formes adéquates. Oui, Poussin
disait « Lisez l’histoire et lisez le tableau ».
Mais jusqu’à quel point devait-il être cru ?
« Je me doutay aussitost, puisque mon Tableau du Titien avoit donné lieu de réveiller la querelle, qu’on avoit parlé du Coloris ».
Roger de Piles, Dialogues sur le coloris
Une petite halte au XVIIIe, juste pour le plaisir d’entendre Rousseau, sans qu’on comprenne bien pourquoi (Essai sur l’origine des langues), donner un écart brusque au dessin dans le champ sentimental, renversant la disqualification en usage de la couleur : « L’intérêt et le sentiment ne tiennent pas aux couleurs ; les traits d’un tableau touchant nous touchent encore dans une estampe : ôtez ces traits dans le tableau, les couleurs ne feront plus rien » (la couleur n’étant rien, après tout, elle peut bien être sa propre contradiction) avant d’aborder sous une autre forme l’exécration de la couleur, au XIXe siècle, ou comment un Pline imaginaire offrit son arbitrage à un siècle déchiré entre la blancheur néoclassique et le bariolage chromiste...
Écaille après écaille, par l’archéologie, les couleurs reviennent aux joues des marbres antiques, les murs grecs se chamarrent. Il devient de plus en plus difficile de contenir le flot de couleurs que charrient les fouilles – à Herculanum, à Pompéi, à Rome où sont reprises celles de la Domus Aurea – et les publications savantes qui les suivent. On ne connaissait jusqu’ici, en fait de peinture antique, que les miettes de figures ailées de la chambre sépulcrale de Cestius, les fantômes picturaux de la tombe des Nasoni et la fresque fragmentaire des Noces Aldobrandini – toujours visible dans les collections vaticanes. Mais à partir du XVIIIe et tout au long du XIXe on sillonne, on sonde, on retourne Athènes, Egine, Bassæ, Délos, Pergame, on excave peintures et mosaïques saturées, mélanges de couleurs aux murs et aux sols des maisons ; devant les demeures privées comme les parties hautes des temples mis à jour, on se dessille : toute la vie grecque était peinte, et pas seulement les panneaux mobiles de bois comme le disait Pline.
Les publications abondent, des Antiquities of Athens de Stuart et Revett – qui font silence sur les polychromies – aux notes de voyages de Fauvel – qui les commentent abondamment. Car ce que les yeux voient, le sanctuaire moral le réfute souvent ; la polychromie est l’enjeu de violentes ruptures théoriques : comment renoncer à l’idéalité sur laquelle repose toute une construction politique, morale, historique, une ontologie historique tracée depuis la pureté des origines jusqu’à son renouveau fantasmatique invariablement rejoué dans les mythes nationaux ? Alors que les livres de Dodwell et Clarke, de Cockerell, font éclater leurs notes de couleurs, les musées restent blancs. Ils le sont encore pour l’essentiel aujourd’hui. Comment ébranler la mauvaise foi d’un Winckelmann ou d’un Hegel qui affirment que les marbres grecs ne peuvent être que blancs si les découvertes ont si peu d’effets sur le regard ? Métopes vierges, statues sans pupilles, ruines immaculées font encore le parcours de l’œil sur l’antiquité et la cartographie de ses règles créatrices, conceptuelles. Les ridicules créatures néoclassiques, baignées d’une blancheur relayant leur fantasme historique, insémineront la fausseté dans l’original par la production des pastiches.
La défense peut inviter Millon : « Avant que ce marbre précieux eût été nettoyé, il conservait des traces, non seulement de la couleur encaustique dont, suivant l’usage des Grecs, on enduisait la sculpture, mais encore d’une véritable peinture » ou Fauvel : « chaque objet a eu sa couleur propre : les chairs, les draperies, les fonds; j’ai remarqué des vêtements pourpres, des pileus ou chapeaux peints en vert; le fond de ces bas-reliefs était azur », ça ne change pas grand-chose, c’est le grand ménage.
Quatremère trouve son étrange voie du milieu : lui qui fut un des premiers à se brûler les yeux aux couleurs antiques révélées, se dégage de la polychromie, dans son Jupiter Olympien, par un centrisme lâche : c’est la polylithie, qui plante un buisson ordonné de matières naturellement colorées pour cacher une forêt de mélanges criards. Limites camouflardes grâce auxquelles la cité grecque, miraculeusement, se désorientalise.
On verra des savants discréditer l’histoire morale dont ils avaient pourtant édifié seuls l’autorité imaginaire, condamnant Athènes révélée au nom d’Athènes imaginée, plus vraie parce que plus pure ; monde nécessairement « blanc parce que c’est la couleur de l’idéal » dit Winckelmann ; pas assez satisfait de cette démonstration rebroussée, il poursuit en toute logique Wincklemannienne dans ses Réflexions sur l’imitation des œuvres grecques en ajoutant que le blanc est la couleur de l’idéal puisqu’il réfléchit le plus de lumière.
Les causes morales du rejet de la couleur trouvent sans doute en tout temps une justification métaphysique au moins aussi certainement que le contraire.
Les idéalistes ravalent à leur tour la couleur au rang de fard, de parerga, et dans le cadre des découvertes archéologiques, à celui d’erreurs de parcours, d’écarts de programme, dérogations malencontreuses à la règle d’un blanc que rien ne vient plus confirmer mais qui emporte l’approbation morale. Les vestiges romains sont compris comme décadence du patrimoine Grec. Le raccord avec leur contemporain désolé, Pline, est établi : la boucle est bouclée.
Winckelmann dans ses Gedanken : « L’unique moyen pour nous de devenir grands et, si possible, inimitables, c’est d’imiter les anciens » mais qu’imiter quand on a perdu son seul modèle possible ? Enjeu moral, siècle dépravé. C’est la ruine qui hante Winckleman comme seule réalité de l’antique, car c’est la ruine qui dit la dépravation d’un monde dont le péché est de n’avoir pas su conserver une origine pure, de l’avoir laissée détruire. Comme Pline, c’est vers une source imaginairement disparue qu’il perd son regard. C’est sa lecture qui contrevérifie le regard, car voir ne sert à rien. C’est le regard qui vérifie l’idea. Force des impensables, qu’aucune réalité ne fera apparaître. Quitte à blanchir un peu histoire et collections.
Les sculptures de Cailloué dans les salons, l’Athéna bariolée de l’exposition universelle de 1855, les tétons peints de la Tinted Venus de Gibson, les architectures polychromes théorisées autant que réalisées de Hittorf, la mode des papiers peints néo pompéiens, les pastiches colorés de temples grecs, Alma Tadema ou Ingres qui bariolent leur hellénisme, sont les effet rares, le plus souvent rabroués, d’un goût pour cette Grèce révélée ; leurs polychromies hasardeuses sont au moins aussi fantasmées que la blancheur idéalisante de leurs opposants. La mise à jour de vestiges colorés n’a pas fait frémir d’un cil l’autorité idéalisante. L’immaculé est avant tout une pureté discursive.
Histoire de la couleur comme histoire de rapports moraux pris dans un seul mouvement : depuis la vision d’un hellénisme classique souillé par le fleuve bariolé se déplore la perte d’une pureté tétrachromiste de la peinture qui n’a jamais existé ; sur la base de cette déploration, sur sa traduction continue, s’est établie la référence tutélaire à l’antique. C’est la même pureté imaginaire qui a constitué la totalité de nos rapports historiques, artistiques, moraux, à la peinture ; plus exactement : à la couleur.
Cette généalogie morale est conditionnelle à la coupure métaphysique entre couleur et tracé, catégories de la peinture et du dessin. Pourtant, il n’y a aucune évidence, à l’établir. Trajet, matière, espace, référent, sont un seul et même mouvement figuratif (car il n’y a que des images figuratives au même sens qu’il n’y a que des discours anthropocentriques). Ils ne peuvent être compris dans un cloisonnement, et moins encore y trouver un argument pour des espaces d’analyses disjoints.
Mais les premiers livres pratiques – le Libro dell’arte de Cennini par exemple – fondent l’art de l’image sur la base de cette dichotomie historique qui ne s’abolit pas dans de nouveaux cadres théoriques ; ce qui fait, nous l’avons vu, du dessin à la fois un moment et une partie de la peinture, fait de la couleur un après. Un toujours après. La notion qui en découle est un dessin sans couleur, atonal, immatériel – une tendance sans solution – définitivement linéant (base doctrinale et technique des arts graphiques).
La couleur sans dessin, elle, est prise dans une insaisissable secondarité. Quelle est sa temporalité propre ? comment aurait-elle une présence sans cause dans la durée ? Zone flottante de possible aberrant... Voilà qui la rapproche, dans les catégories académiques, de cette autre secondarité aberrante par laquelle l’éloquence se rapporte au langage (parallèle étudié en détail par J. Lichtenstein, ou par Marin dans son étude de la logique de Port-Royal). Il s’agit idéalement de réduire la distance – angoisse du communicant –, de faire s’écraser la référence objective sur sa silhouette, dans ce qu’on prend pour les enjeux de cette relation ; tout tendra à réduire à rien l’autoréférence résiduelle du dessin au dessin, de la couleur à la couleur. Pour ce qu’on appelle alors le dessin, sa liquidation passe par le gouvernement du signe et de l’idéation qu’il conduit ou relaie (il disparaît dans l’interprétation). Pour ce qu’on appelle la couleur, c’est par celui de la morale qui, frappant l’indistinction, la réordonne rhétoriquement. L’un s’abolit dans la raison, l’autre se soumet à la morale.
La querelle des coloris, en parachevant le rabattement du dessin sur le signe le soustrait, nous l’avons longuement vu, à la masse pour le subsumer au contour, mais également à la matière en le séparant de la couleur. Ce qui entraîne l’insignifiance de la couleur, « La couleur dépend tout-à fait de la matière et par conséquent est moins noble que le dessin qui ne relève que de l’esprit », écrivait Le Brun. Ou encore : « La couleur satisfait les yeux, le dessin satisfait l’esprit ».
Il
ne faut pas croire que la rationalisation ou la spiritualisation de
la couleur au début du XXe siècle renversent en quoi
que ce soit cet ordre de la couleur ; les gammes spiritualistes d’un
Kandinsky comme les obsessions de systèmes chromatiques qui
jalonnent cette période moderne sont encore et toujours des
régimes du discours qui scientisent ou symbolisent, sans grand
effet sur le regard...
Établir d’un art que plus il est mimétique plus il est descriptible, impose à l’esprit une introuvable nature du regard, conjointe à une introuvable évidence des relations entre les images et leurs référents. Baobab théorique qui cache la forêt des hypothèses inavouables...
Le Brun et ses confrères jouent tout pour le dessin en ce qu’il dirait quelque chose. Mais n’est-ce pas une déclaration d’infortune ? Un renversement de la situation pour éviter l’aveu impuissant que le dessin est la seule chose dont on sache parler ? N’est-ce pas pour cette raison qu’on imagina une ontologie à sa préséance et une morale pour son empire sur la couleur ?
Faute de pouvoir dire quoi que ce soit de la couleur, qui fait abdiquer le vocabulaire de la raison, on l’imagina menacer le langage de ses chatoiements, son insaisissabilité, de ses vacillements. Ce ne serait pas la première fois que l’impuissance théorique déplace la faute dans l’objet qui en est la cause : plus on s’ouvre à la couleur, plus on est dépossédé des analogies langagières, plus se fendille le socle des théories sémiotiques. Les actuelles relégations sentimentales ou expressives de la couleur ne sont que l’ajustement historique d’un vocabulaire moral.
C’est une affaire difficile que de désavouer la belle construction qui s’étirait jusqu’à vous, qui vous ouvrait à votre propre révélation, celle qui avait rendu intelligible pour vous le monde dans l’ampleur de sa construction, celle qui légitimait même votre position surplombante, qui parachevait votre certitude théorique d’avoir complété une lignée par un de ses plus beaux rejetons : car Winckleman ne renonce pas qu’à Phidias blanc et Praxitèle blanc s’il renonce à l’antique blanc de ses prédécesseurs théoriques, il renonce à Winckleman.
Il
ne faut pas négliger le mouvement de défense auquel
incline la dépossession des modes opératoires du
jugement, de l’appareil critique, interrogatif, déictique,
dans lequel on avait jusqu’ici fait rouler regard et parole.
Il fallait ce long détour historique pour éclairer le solide maillage qui paralyse la spéculation au point que, dès qu’apparaît la couleur directe sur les planches, le théoricien de la bande dessinée s’en remet lui aussi aux catégories morales : Grœnsteen et Peeters, traitent donc la couleur, quand elle déborde un peu trop l’illusoire cadre fonctionnel, en maniérisme. Pourtant, c’est contre le maniérisme que Dolce convoquait la supériorité expressive de la couleur ; pour interpréter l’inquiétude de Peeters voyant le pictorialisme gagner la bande dessinée – n’oublions pas qu’il est le scénariste d’un ferronnier – comprenons qu’il reconduit au nom du sens les catégories morales de Pline et la perte si redoutée d’une pureté. D’un signe ici. D’une morale là. Est-il bien certain que la communication soit autre chose qu’une question morale ?
D’une certaine manière la cabale coloriste est venue à bout de Le Brun. Elle a retourné à jamais l’Académie, quelles que fussent les tentatives régulières de dérubéniser la peinture pour repoussiniser sa théorie. Le libertinage – la couleur – ayant remporté la victoire et l’histoire de notre modernité étant plus ou moins superposée à la tumultueuse libération des conditions du plaisir (vers la fin espérée de toute captivité des manifestations érotiques, charnelles) le dessin s’en est trouvé condamné à incarner plus ou moins l’aridité, la tempérance, la raison, puis la communication. Déjà engoncé dans les modalités verbales auxquelles on l’assigne invariablement, il est, depuis le XVIIe siècle, conceptuellement gagné par le puritanisme. C’est la lettre volée de la bible fumeuse des communicants en bande, L’art invisible de Scott McCloud. (3)
Critiques et théoriciens
de la bande dessinée rejouent l’Histoire, écartant parmi
les auteurs ceux qui, jugés un peu trop peintres, trahissent cette fonctionnalité
descriptive qui serait l’argument impérieux du récit, le
nœud de sa bonne conduite. Un grand nombre de dessinateurs de bandes dessinées
participe pleinement à cet entêtement général, comme
participèrent en leur temps les peintres eux-mêmes ; ils alimentent,
pour les uns le malentendu en traitant le dessin comme une sorte de protocole
graphique à destination herméneutique (ils s’en remettent,
par une étrange honte de classe, à tout ce qui théorise
à leur place) ; pour les autres, en enquillant les travaux de peinture
sur le mode mineur d’une modestie ostensible, suivant les aventures de
la grande peinture muséale avec le siècle de retard nécessaire
sur l’horloge spéculative pour ne pas perdre en chemin un lectorat
de bandes dessinées jugé a
priori, par ceux
qui la font, ceux qui en lisent comme ceux qui n’en liraient pour rien
au monde, tout autant ignorant que désireux de le rester.
Quelques lectures :
de Roger de Piles et le De re ædificatoria d’Alberti, et enfin, il n’est pas inutile de s’encombrer du Dialogue sur la peinture intitulé l’Arétin de Ludovico Dolce (Klincksieck), de Théorie du nuage, de Hubert Damisch (Seuil) et de L’Antiquité en couleurs de Marcello Carastro (Millon)