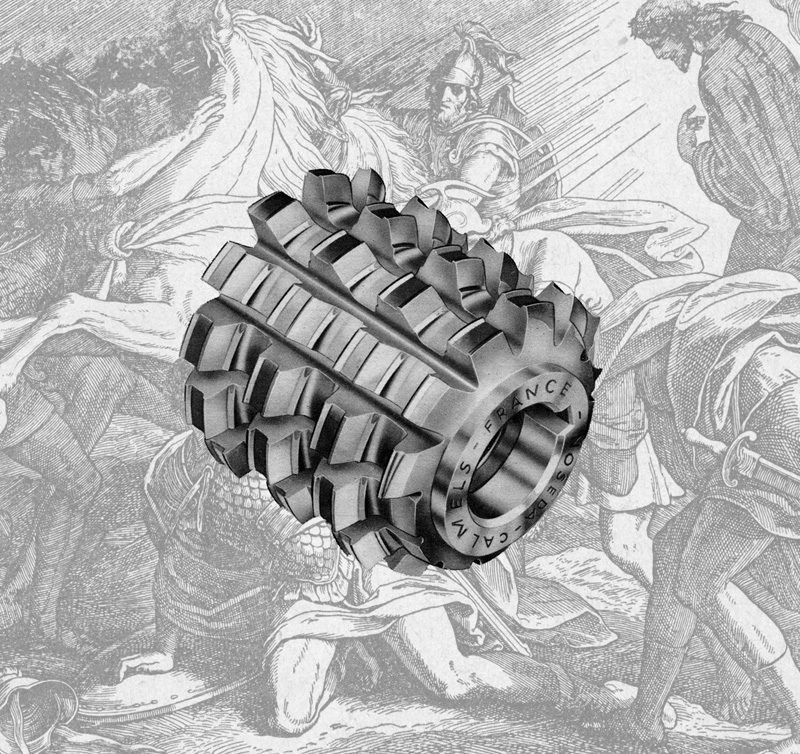
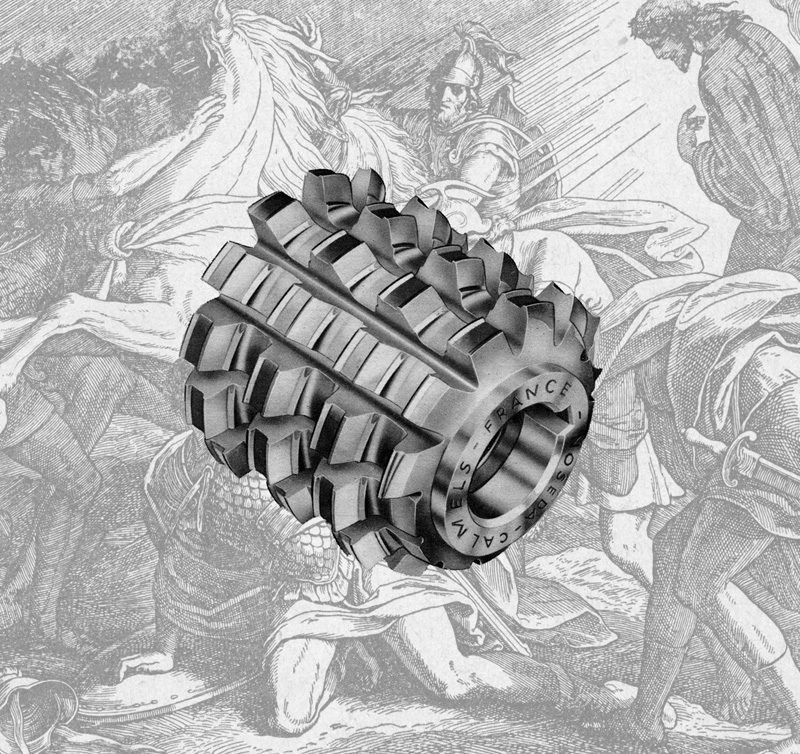
Niklos Koda, À l’arrière des berlines
de Dufaux et Grenson
par L.L.de Mars
La plus grande partie des albums publiés chaque année par les gros éditeurs ne font pas, n’ont aucune raison particulière de faire, l’objet d’un article dans Pré Carré ; comment commencer à construire un regard sans au moins une aspérité pour l’arrimer ? D’une part, les rédacteurs de la revue seraient bien en peine de distinguer un album parmi les quelques milliers de ses semblables dans le ressac de l’industrie éditoriale quand aucune urgence, aucune promesse, aucun tremblement lumineux sur l’horizon ne viennent encourager un mouvement de formation du jugement ni la création de modes de discrimination ; d’autre part, ils peinent déjà à trouver dans les 48 pages de la revue une place suffisante pour parler de ce qui semble à la fois si important et si fragile. Dans ce numéro, nous avons décidé de multiplier les pistes en les serrant dans des formes courtes, fusées théoriques, critiques, pas de côté furtifs, amorces, plans serrés.
C’est
une opportunité de saisir au hasard un ou deux de ces
brimborions répondant si volontairement aux idées
reçues qui les précédent.
Les difficultés visibles que le dessinateur éprouve à visser un chapeau sur une tête font peine à voir ; la logique géométrique de la chose, perceptiblement, le dépasse. Quel volume, de la tête ou de la calotte, est la concrétion de l’autre ? C’est sans solution : l’aile se retrousse comme l’ourlet d’une matière rebelle à toute mémoire de forme et hésite, de case en case, entre le mou, le cartonneux, l’anneau de canotier ayant perdu une dimension et la langue de bœuf encore vivante, dévorant un visage de poupée. Toute chose du monde à dessiner lui est un obstacle infranchissable : l’ombre d’une arcade sourcilière avale trop de repères pour placer un œil dans la découpe absurde dont elle frappe un visage ; une fumée de cigarette passe de la méduse au polochon épluché sans jamais atteindre la légèreté ni la transparence ; un rai de lumière y a la solidité enfantine d’un Mr. Freeze.
Alors, se demande-t-on, quel scenario missionnaire, vital, quelle nécessité peut bien légitimer la torture que s’inflige le pauvre Dufaux (ou Grenson je ne sais pas lequel tient le pinceau) alors qu’il pourrait très profitablement aller aux champignons ? Quel message impérieux lui et son scénariste doivent-il délivrer au monde ? Dois-je les chercher dans des aphorismes de ce genre : « Avec les femmes, mon cher, on n’y comprend jamais rien ou presque » ? Ce livre en est une pépinière. On passe à peine le choc philosophique, que vient la leçon de littérature. Ce mon cher à lui tout seul, glissé dans une habile façon de dialogue, montre à quel degré de raffinement l’écriture s’est déshabillée de tous les degrés possibles, un à un, pour revenir un peu au-dessous du premier, quelque part entre le roman écrit par un javascript et le retroussement comme une peau du poncif par un Pierre la Police schizo se rêvant Marc Levy.
C’est un de ces récits où les moricauds sont superstitieux, leurs femelles lascives jusqu’au fourneau slipal, appelant tous les européens « homme blanc » et souffrant d’un invraisemblable sentiment d’infériorité qui les rend tantôt agressifs tantôt voués corps et âmes à leurs colons.
Dire que c’est misogyne est très au-dessous de la vérité. Le héros est une sorte de garçon coiffeur dont le prestige repose sur une aptitude mythologique à pécho toute caille qui bat un peu des ailes à proximité et.
Et c’est tout. Voilà. C’est la raison pour laquelle le monde entier a besoin de ses services. Pour sauver l’humanité.
Mais qui va nous sauver de ce genre de cochonneries ? Il semble, contre toute apparence, que ça ait été barbouillé par deux adultes et, plus troublant encore, que la lecture en soit également destinée aux grandes personnes.